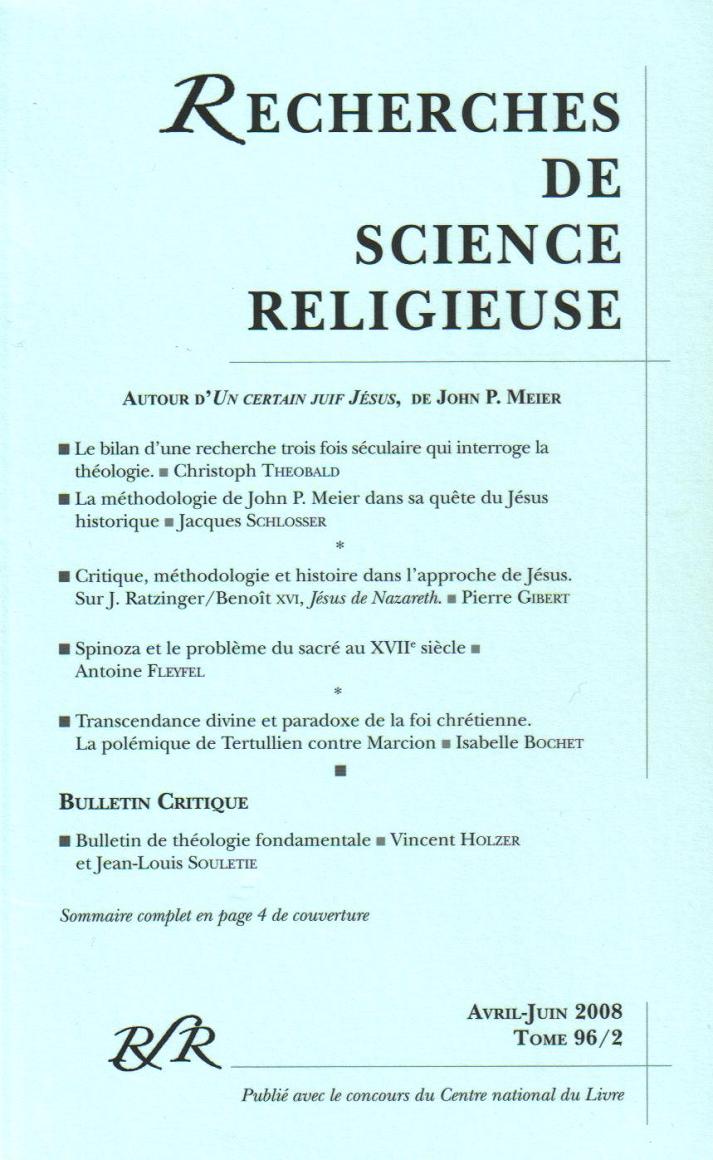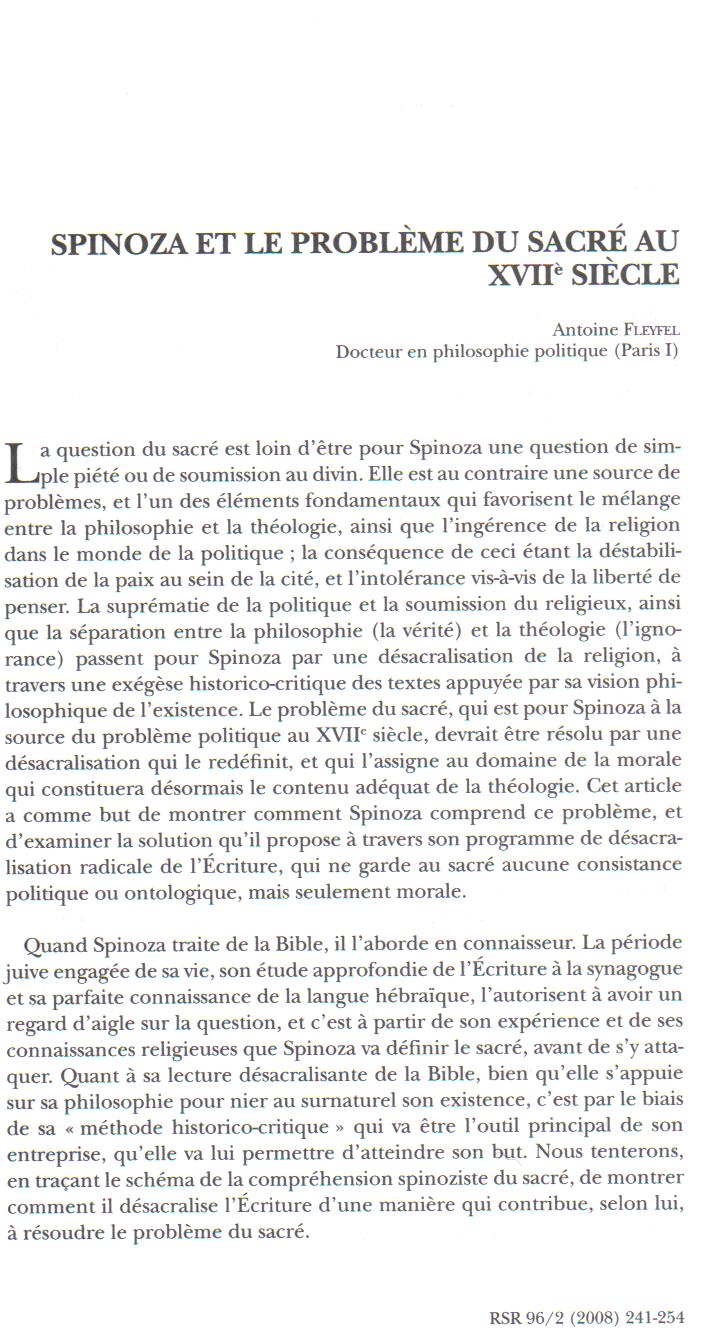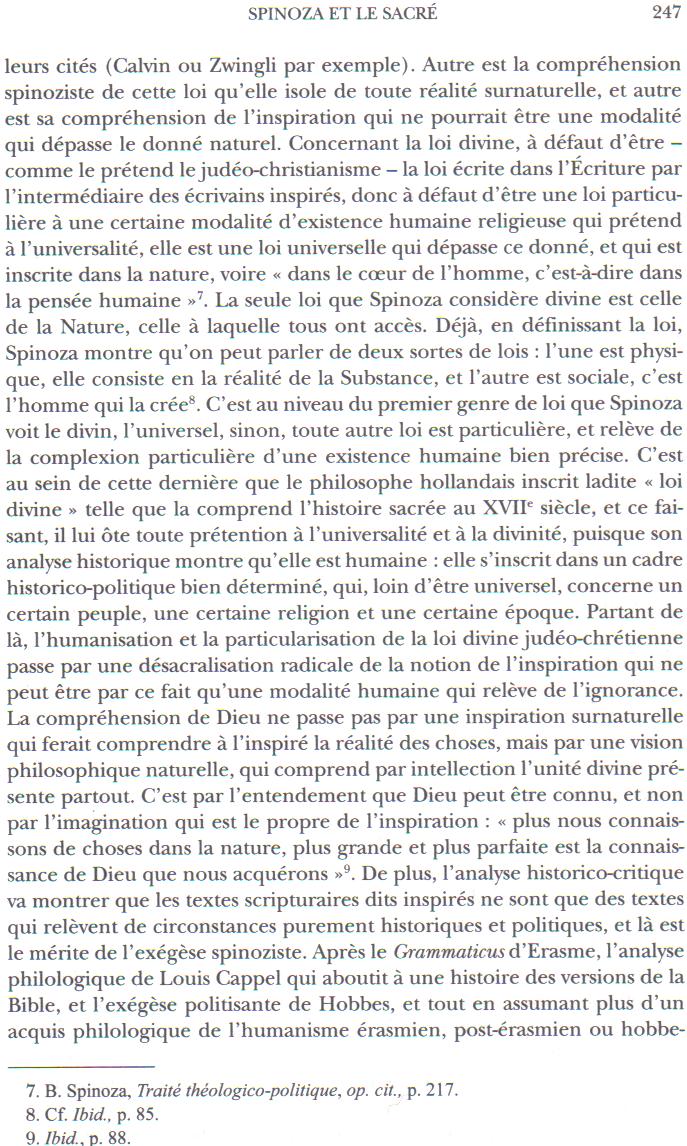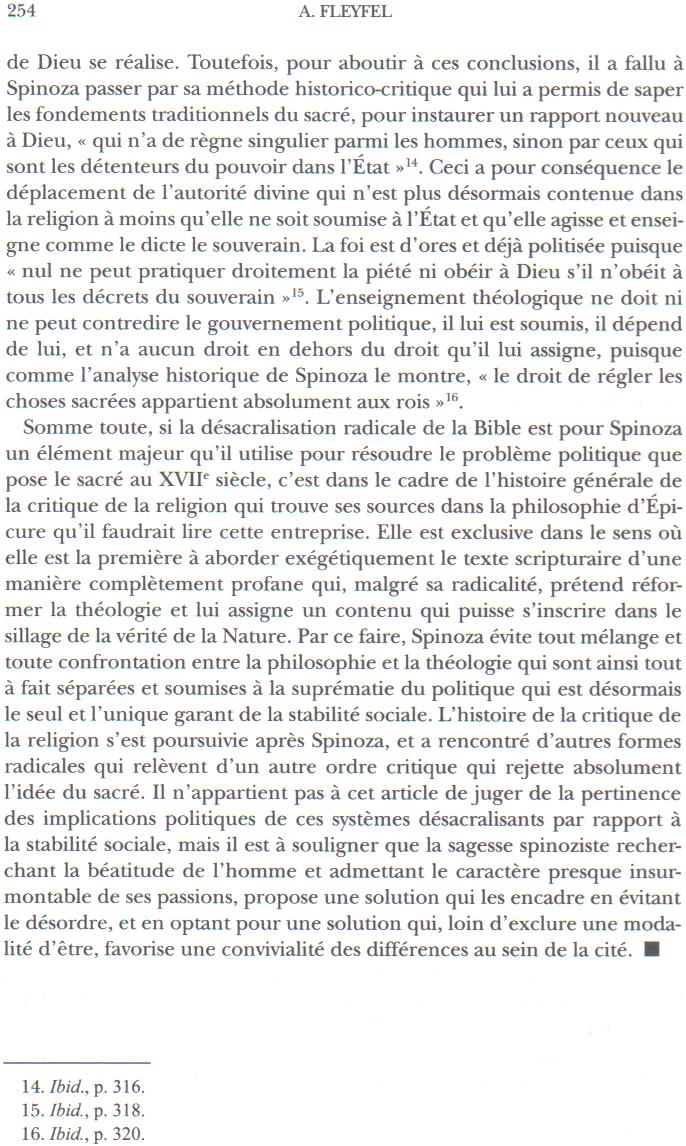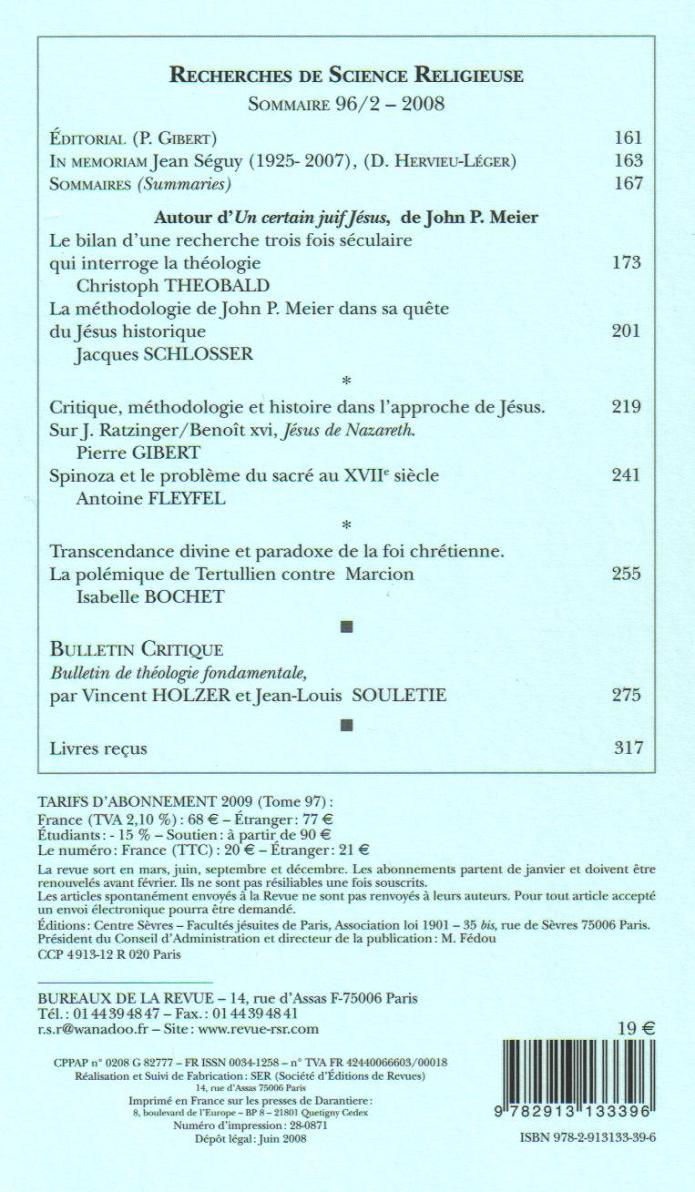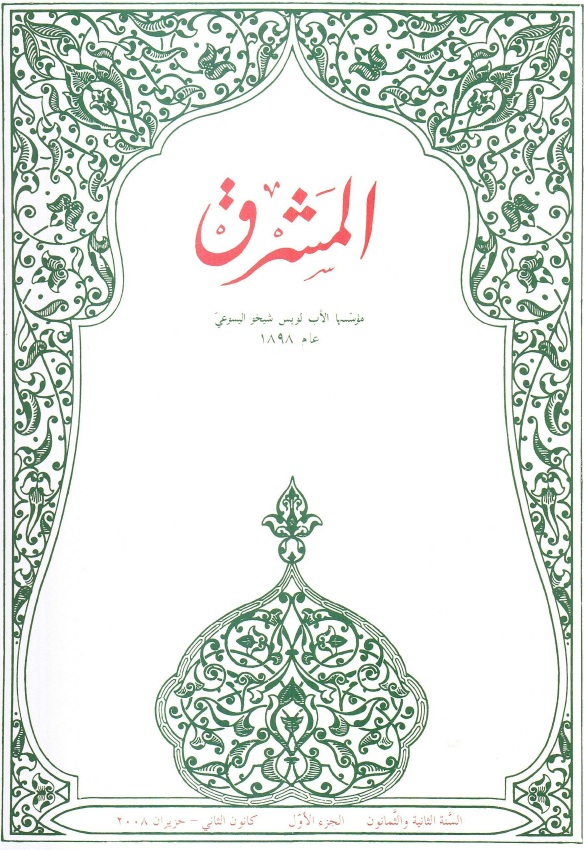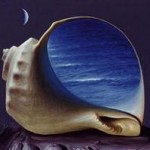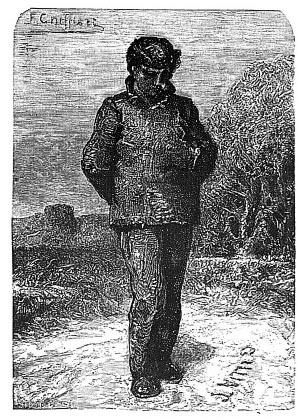|
|
رسالة إلى المصلوب
يا سيّدي الناصري
اعذر قلّة إيماني. لكنّي على رغم شهادة المريمات والتلاميذ ما زلت عاجزاً عن تصديق قيامتك. كنت وما برِحت على حذاء عودك أتأمّلك مسمّراً صارخاً نحو أبيك ولكأنّ الأيس تركك والوجود غاب والعدل استُنفذ والحياة بادت والموت انتصر.
رأيتك مصلوباً في فلسطين
رأيتك مقتولاً برصاصة بين يدي أمّك. رأيتك عائلة تفقد جنى عمرها بلحظة وقد أبادت جرّافة مأوىً كان البارود قد استنزفه. رأيتك محاصرًا في غزّة، باكياً في القدس، فاقداً أرضك، صارخاً نحو سمائك. رأيتك مذلولاً على المعابر، مشرّداً على الطرقات، معذّباً في السجون، راقداً في ظلّ حائط بناه الإنسان ليفصل بينه وبين أخيه. رأيتك جثّة هامدة رفعهتا الأيدي وكفنتها الدموع ودفنها الحقد وابتلعها النسيان.
رأيتك مصلوباً في لبنان
رأيتك واقفاً على باب السفارات تترك مكرهاً أرضك وميراث أجدادك. رأيتك أباً تحسب أموالك وتتساءل كيف تطعم أبناءك. رأيتك متأوّهاً تبكي إخوتك وقد تقاتلوا وتباغضوا من أجل صغار… رأيتك تفقد متجرك إفلاساً. رأيتك تُشتم وتُتّهم بالخيانة لأنّك لم ترفع شعارات مسحاء هذا الوطن الدجّالين. رأيتك أرض الجنوب وحقد الآخرين بذور حقوله. رأيتك الشمال ورائحة البارود ما زالت تفوح من ياسمينه. رأيتك بيروت وقد مزّقت قلبك يداك وهي لا تدري أن موتك هو موتها وحياتك هي حياتها.
رأيتك مصلوباً في العراق
رأيتك في الليل وقد حرمك الخوف من الرقاد. رأيتك مخطوفاً وحياتك تحت رحمة جهّال لا قيمة عندهم لحياة الإنسان. رأيتك تنوح على منزلك وعلى دار عبادتك والمتفجّرات قد صدّعت أساساتها. رأيتك تهجر موطئ أترابك وترحل إلى المجهول. رأيتك وأصحاب البنادق ينكّلون بك والغرباء يدنّسون أرضك والكافرون يقتلون شعبك. أجل هذا أنت رأيتك جائعاً ومضرجاً بالجروح وميتاً على قوارع طرق بغداد.
رأيتك مصلوباً…
…في مصر شابّاً ملؤه الحياة تشحذ الرغيف…
…في إيران امرأة تُرجم باسم قطعة قماش…
…في سوريا وقد حَلِمت بك الحريّة ليل نهار…
أنا الشرق أيّها المصلوب، صليبك صليبي ودماؤك دمائي. لا وجه لي ولا رجاء. لا صوت لي ولا عزاء. في قلبي النازف حنين يصرخ إلى من غاب : “إلهي إلهي لماذا تركتني !!!”. اعذرني أيها المصلوب إن كنت غير قادر عن رؤية قيامتك، فدموع أبنائي ودماؤهم قد أعمت بصيرتي… والليل طال… فيا أيّها الساهر أين النهار؟
الدكتور أنطوان فليفل
جريدة النهار 25.04.2008
Résumé
Dans le chapitre 12 de son TTP, Spinoza définit le sacré de la sorte : « Mérite le nom de sacré et de divin ce qui est destiné à l’exercice de la piété et de la religion et ce caractère sacré demeurera attaché à une chose aussi longtemps seulement que les hommes s’en serviront religieusement ». De par cette définition première qui fait relever le sacré de la religion, Spinoza est en train d’exclure le sacré du domaine de la vérité qui est propre à la philosophie. Quant à sa lecture désacralisante de la Bible, bien qu’elle s’appuie sur sa philosophie pour nier au surnaturel son existence, c’est par le biais de sa « méthode historico-critique », qu’elle va permettre à Spinoza d’atteindre son but. La question du sacré est donc loin d’être pour Spinoza une question de simple piété ou de soumission au divin. Elle est au contraire une source de problèmes. Cet article voudrait montrer comment Spinoza comprend ce problème, et d’examiner la solution qu’il y propose à travers son programme de désacralisation radicale de l’Écriture.
Spinoza and the problem of the sacred in the 17th century
In the 12th chapter of his Tractatus theologico-politicus, Spinoza defines the sacred in this way: “A thing is called sacred and Divine when it is designed for promoting piety, and continues sacred so long as it is religiously used: if the users cease to be pious, the thing ceases to be sacred”. By this first definition that situates the sacred in the realm of religion, Spinoza is excluding the sacred from the domain of the truth proper to philosophy. As for his desacralizing reading of the Bible, though it denies, on the basis of his philosophy, any existence to the supernatural, it is thanks to the “historico-critical method” that this reading will enable Spinoza to attain his goal. For Spinoza, the question of the sacred is therefore far from being a question of simple piety or submission to the divine. On the contrary, it is a source of problems. This article will attempt to show how Spinoza deals with this situation and to examine the solution he proposes through his program of radical desacralisation of the Scriptures.
Extraits
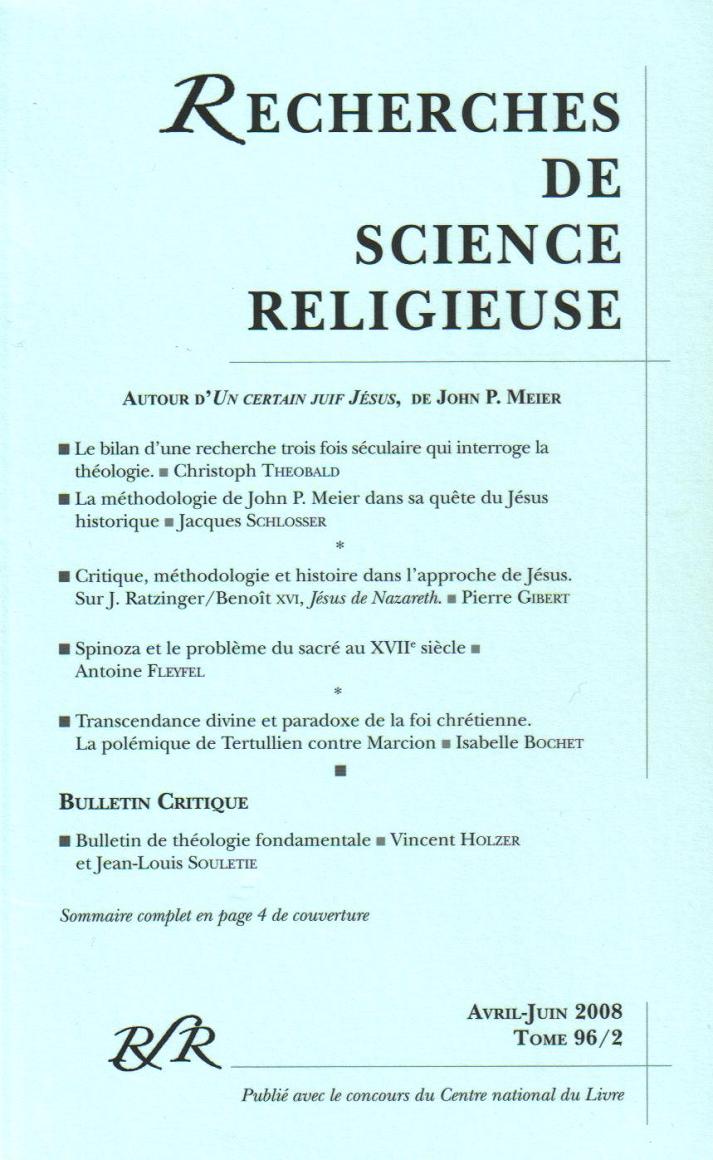 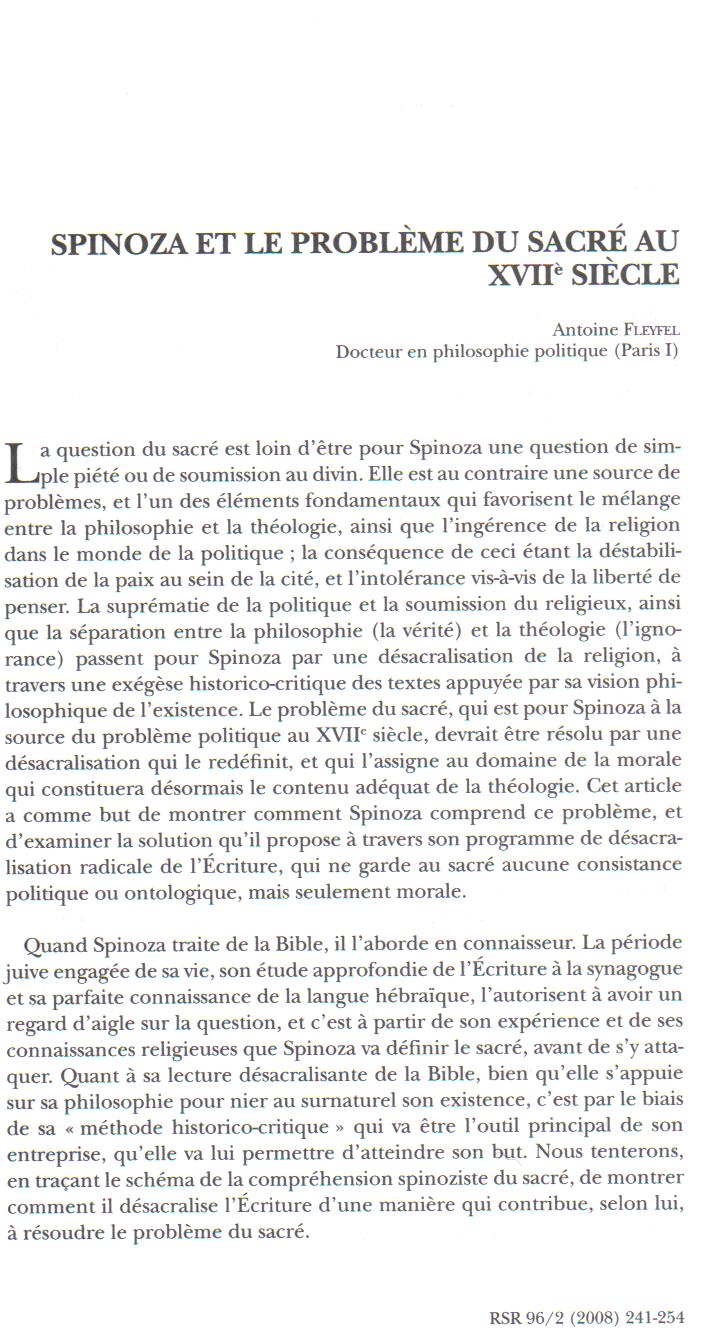 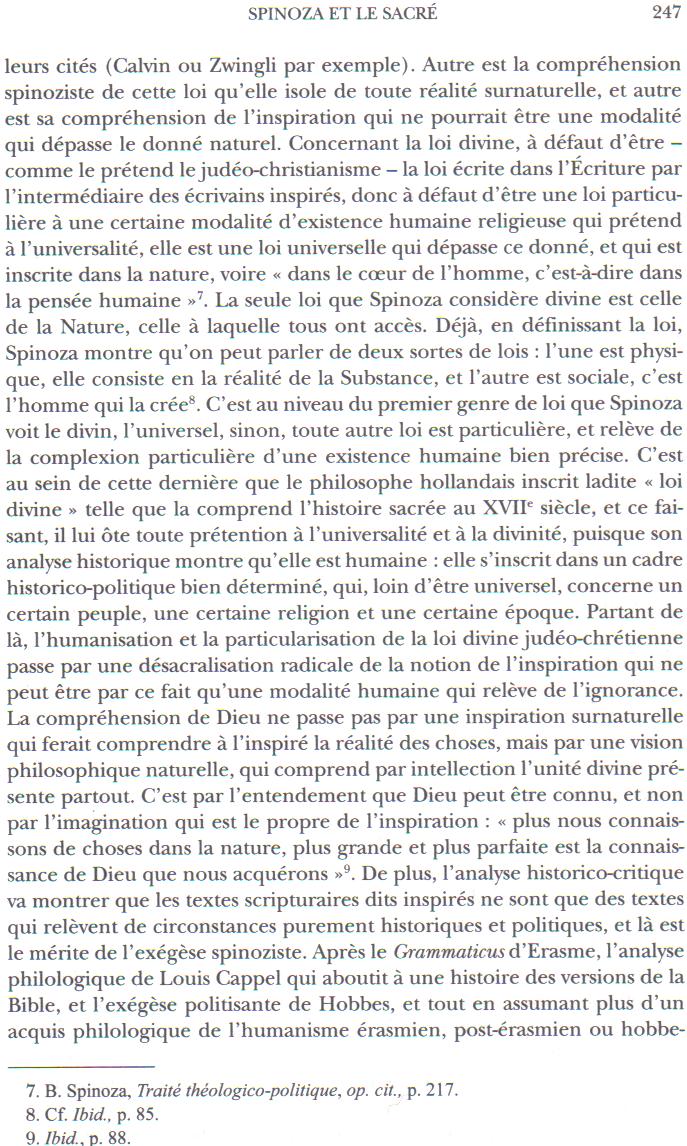 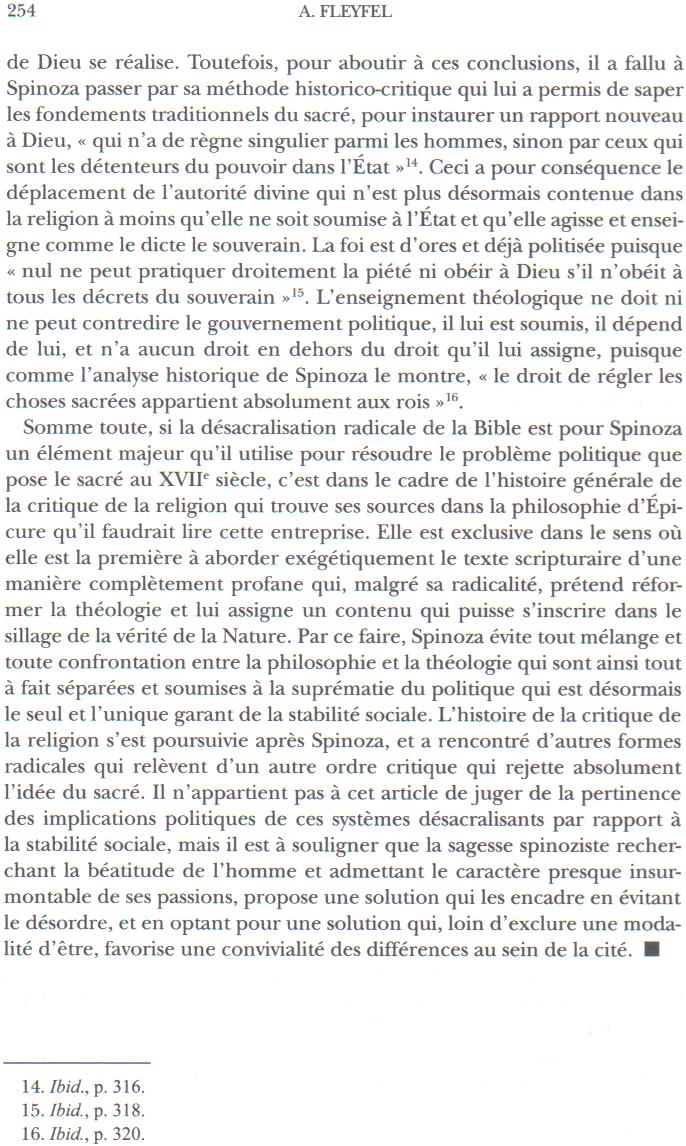 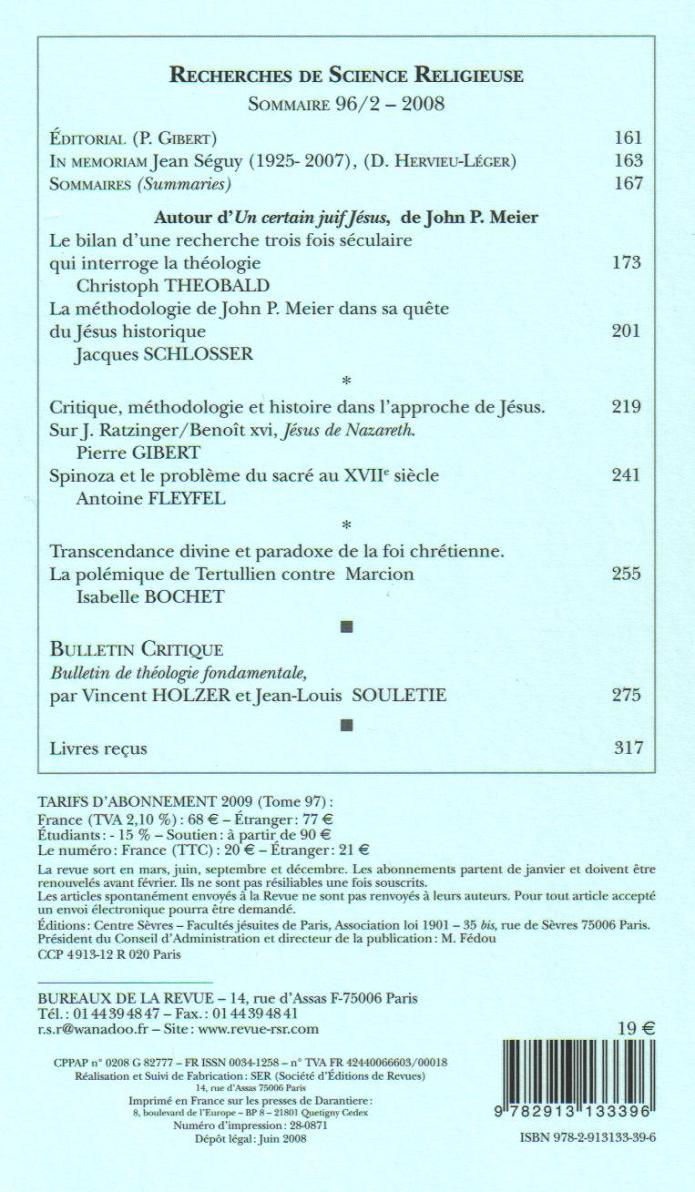
من أجل لاهوت عربي المعاصر
لقرون خلت اعتُبِر اللاهوت المسيحي كعلم إلهيّات خاصّ برجال دين متخصصين وجامعيين متمرّسين بالمفاهيم الصعبة وعارفين بتفاصيل تاريخيّة متشعّبة ومعقّدة… وعلى رغم إيجابيّات هذا الواقع الذي جعل من اللاهوت تعليماً مبيناً رفيع المستوى العلمي، فقد ظلّ علم الإلهيّات هذا بعيداً عن متناول من يسمّون بالعلمانيّين وغير المتخصّصين والمتفرّغين للبحث، رغم أنّه قد وُجِدَ من أجل إيمانهم وتجلّياته المتنوّعة تاريخيّاً ودينيّاً وإجتماعيّاً.
آن الأوان للتخلّص من هذا الواقع وقد فاقت سلبيّاته محاسنه، بحيث بات الإنسان المعاصر راشداً في علوم متنوّعة ودارياً وملمّاً بمواضيع كثيرة علميّة تمسّ واقعه وإطاره المعولم، قاصراً وطفلاً لا بل جاهلاً أحياناً في أمور علمٍ يهدف، عبر التكلّم في الله، إلى البحث والنقد ومحاولة الإجابة عن عمق التساؤل الإنساني الوجودي.
لا شك أنّ لكلّ امرئٍ طبيعة تفرض عليه مقدار مساهمته اللاهوتيّة : فهذا صاحب التعبير المبسّط وذاك الذي يتفكّر بشكل علمي جامعي… وفي كلتا الحالتين أو حتّى في حالات أخرى ممكنة، على علم اللاهوت أن يضحي شأن كل مؤمن يروم تفكير إيمانه على ضوء واقعه الوجودي والتعبير عنه وأن يبتعد كامل الابتعاد عن أن يكون معرفةً تحتكرها نخبة رجال دين أو متخصصين. فاللاهوت الذي هو كلام في الله مسألة تخصّ كل مؤمن وهي تغتني بقدر ما تعكس الخبرات الوجوديّة الإنسانيّة المتجلّية في التاريخ والجغرافيا.
آن الأوان وقد برح الشرق العربي بأغلبيّة أقطاره خالياً من أغلب المقوّمات الأساسيّة لبناء إنسانيّة صحّة بتجليّاتها الدينيّة أو العلمانيّة، السياسيّة والحضاريّة… آن الأوان أن يعي كل مؤمن إلى أيّ جماعة مسيحيّة انتمى أنّه معنيّ باللاهوت بشكل فعليّ وخلاق ليس فقط من باب الترداد أوالتبعيّة العمياء لأهل السلطة المختصّة، بل أنّ علم اللاهوت شأن يمكنه من خلاله أن يُفعّل انتماءه الكنسي بشكل نقدي وفاعل يسهم بإنهاض مجتمع أوثانه التحزّب والجهل والطائفيّة والعنصريّة وحب السلطة والمال والذات…
الوعي اللاهوتي على مستوى عام يخرج هذا العلم من المخالطه الإكليريكيّة ويجعل منه أداة تسهم في بناء إنسان ومواطن جديدين في بلد ومنطقة يفتقر جسدهما كامل الافتقار إلى روحٍ وفكر ينعشان يجددان، يصلحان ويبنيان. وعلى ذاك الوعي السلوك عبر منعطفين : الأول يقضي بأن يعكف أهل اللاهوت الحاليين عن التربّص بهذا العلم وكأنّه ملك لصنف من البشر، وأن يسهموا بتوسيع نطاق التفكّر اللاهوتي بعيداً عن الترداد والنقل والببّغائيّة وبروح نقديّ وعلميّ لا يخشى التساؤل البنّاء؛ والثاني يقضي على المؤمنين بشكل عام أن يعوا أنّ اللاهوت شأن يعنيهم لا فقط من باب التثقيف الديني البحت أو من أجل العمل الرعاويّ ولكن أيضاً من باب الإسهام في بناء فكري يعبّر عن خبرتهم الإيمانية الوجودية ويحدّد سبل مستقبل حياتهم الاجتماعّية والسياسية. هذا الوعي يحتّم على الكلّ الإجحاف عن توكيل مصير الفكر اللاهوتي إلى طبقة من المجتمع، ممّا يدفع المؤمن إلى الاستقالة من التفكّر اللاهوتي. لا شكّ أنّ لأهل الاختصاص رأي صائب وجدير بالتصديق، وأنّه على المؤمن أن يحترم السلطات التعليميّة وأن يستقي منها أو ربّما يطيعها. لكنّه يبقى في كل الاحوال قادرًا على الإسهام المبتكر من منطلقه الوجودي، وعليه فعل ذلك بالرغم من التوتّر الذي قد يولد من تفكّره.
الفكر اللاهوتي النقدي ليس حقيقة أثيريّة ولكنّه واقع يمكن لأي كان بلوغه عبر انقلاب وجوديّ فكريّ، أعني تغييراً في الرؤية يخرج اللاهوت العربيّ من تجرّده النظري ومن برجه الإكليريكي، ويضعه في خضّم وجود تاريخي لا يبلغ ملؤه إلا من خلال تجلّيات الإنسان الأساسيّة، أي الدين والسياسة، العلم والاقتصاد، الحضارة والتاريخ، والحاضر والمستقبل… إنّ تغييرًا مماثلاً في الرؤية يتجلّى عبر الإسهام في بناء لاهوت عربي حديث له تجلّيات محلّية، منها اللاهوت السياقيّ اللبناني، وقد غُرست بذوره وما زالت، منها ما قد نما وما زال ينمو… لكن الحصاد كثير والفعلة قليلون… فيا ربّ الحصاد أرسل فعلة لحصادك !!!
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة النهار 16.03.2008
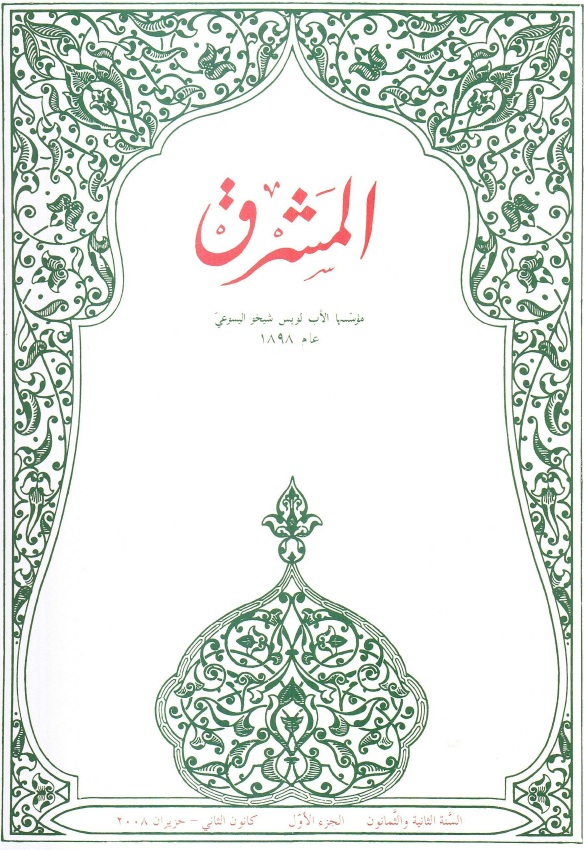
Cet article écrit en langue arabe a paru dans les pages 51-71 du n° 1 / LXXXIIe année / janvier – juin 2008, de la revue de théologie semestrielle Al-Machriq (fondée en 1898 et éditée par les jésuites).
Avec l’aimable autorisation du P. Camille Hechaymi, s.j., directeur des éditions “Dar Al-Machriq” lors de la parution de l’article, il possible de lire ou télécharger (Pdf) cet article en cliquant ICI.
Pour toute information sur la revue et pour les abonnements, vous pouvez les contacter par téléphone au + 961 1 20 24 24.
Antoine Fleyfel
05.03.2008

1. Introduction
Ce travail liturgique à comme but de faire une comparaison entre deux « rites de couronnement » maronites, l’un manuscrit datant de 1306, et l’autre imprimé à Bkerké et datant de 1942.
La motivation d’un tel travail est la recherche des origines les plus lointaines du rituel de couronnement maronite. Par le biais du rituel de 1306 (qui est le plus ancien manuscrit de couronnement maronite que l’Eglise maronite possède) il est en effet possible de retrouver une forme théologico-liturgique bien ancienne qui se rapproche plus de la source liturgique syro-antiochienne que le rituel de 1942. De plus que le manuscrit est exempt de toute latinisation qui ne s’est faite systématique dans l’Église maronite qu’à partir du XVIe siècle. Quant au rituel de 1942, c’était le dernier rituel officiel qui fut imprimé XXe siècle, et qui ait obtenu l’aval du patriarche maronite.
Ce travail comparatif permettra aussi de pouvoir observer certains éléments latinisants dans le rite de 1942, ce qui pourrait être intéressant pour un travail de réforme liturgique ; comme par exemple la caractéristique orientale de l’onction avec l’huile lors du couronnement, qui a disparu avec l’influence latine.
Après avoir brièvement présenté les deux rituels et établi leurs structures, les comparaisons des différentes parties seront effectuées.
2. Rite du couronnement maronite selon le manuscrit de Bkerké (1306 A.D.).
2.1. Aperçu
Le manuscrit de Bkerké du rite de couronnement maronite qui date de l’année 1306 est écrit en langue syriaque. Son état est quelque peu dégradé à cause de l’humidité et d’autres facteurs naturels qui attaquent et détériorent parfois les manuscrits. Beaucoup de feuilles et de mots manquent. Le rite du couronnement est suivi par un rite de bénédiction des habits sacerdotaux et des nappes qui couvrent l’autel. Le nombre de ses pages est de 53.
2.2. Structure
I- Rite des fiançailles
a- Le prêtre s’assure du consentement des deux sujets.
b- Prière
b’- Autre prière
c- Prière sur l’huile
d- L’onction des fiancés et de tous les présents
II- Rite de la bénédiction des anneaux
a- Prière de la bénédiction des anneaux et des ceintures
b- Trisagion
c- Credo
d- Hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre
e- Hymne chantée par le diacre
f- Mazmouro (chant) des lectures
g- Korouzouto
h- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière
i- Le prêtre ceinture les fiancés en récitant une prière
j- Pater
k- Prière Finale
III- Rite du couronnement
a- Prière proclamée par le diacre (Hlof chayno)
b- Bo’outo de saint Jacques chantée par le prêtre portant les couronnes de sa main droite
c- Trisagion
d- Mazmouro (chant) des lectures
e- Lecture d’Ep 5, 22-27
f- Lecture de Mt 19 3-6
g- Korouzouto
h- Chant de louange (w léh léychou’ mchiho)
i- Hymne (Fchito)
j- Le diacre proclame: prions
k- Le prêtre joint les mains des époux et proclame trois fois une doxologie trinitaire
l- Prière
l’- Autre prière
m- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’époux en récitant une prière
n- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’épouse en récitant une prière
o- Prière
p- Le prêtre encense en chantant une hymne de saint Ephrem
q- Prière sur la tête de l’époux
r- Prière sur la tête de l’épouse
s- Prière sur les deux ensembles
s’- Autre prière
s’’- Autre prière
t- Le prêtre met sa main sur la tête de l’époux en récitant une prière, et puis lui ôte la couronne.
u- Le prêtre met sa main sur la tête de l’épouse en récitant une prière, et
puis lui ôte la couronne.
v- Prière sur les paranymphes
v’- Prière
w- Prière proclamée par le diacre
IV- Prières finales
a- Prière finale
b- Homélie ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux
c- Tous proclament trois fois : Amour dans le Christ, Kyrie eleison
3. Rite du couronnement maronite selon le livre des rites de Bkerké datant de 1942 A. D.
3.1. Aperçu
Le livre des « Rites maronites » de Bkerké fut édité l’an 1942 sous le mandat de sa béatitude le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient Antoun Boutros Arida. Il est composé de 374 pages. Tout ce qui a rapport au rite du couronnement se trouve entre les pages 231-268. Ce livre est en langues syriaque et arabe (la transcription est en Karchouni). Un petit appendice indiquant la manière de la célébration des rites précède les rites des fiançailles et du couronnement.
3.2. Structure
I- Rite des fiançailles (qui selon les indications de livre doit se dérouler dans la maison de la fiancée).
a- Le prêtre s’assure du consentement des deux sujets
b- Les deux sujets répondent affirmativement
c- Le prêtre dit trois fois : “regardez, je suis par le témoignage des présents innocent de votre engagement”
d- Les deux se tiennent de la main droite, et le prêtre voile leurs mains par son étole et récite une prière
e- Ils se lâchent les mains et le prêtre récite une autre prière
II- Rite de la bénédiction des anneaux
a- Prière de la bénédiction des anneaux
b- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière
c- S’il y a des ceintures et d’autres habits, le prêtre y récite une prière
d- S’il le veut, le prêtre ceinture les fiancés
e- Prière finale
III – Rite du couronnement (qui se déroule dans l’Eglise)
a- Avant de commencer le rite, le prêtre récite les prières qui précèdent le couronnement, telles les prières qui précèdent l’office.
b- Doxologie
c- Prière initiale
d- Tous récitent le psaume 128
e- Froumiyoun (avec encensement)
f- Sédro
g- Hymne
h- Prière de l’encens
i- Mazmouro (chant) des lectures
j- Lecture d’Eph 5, 22-27
k- Fétgamo
l- Lecture de Mt 19 3-6
m- Chant de louange
n- Homélie, ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux
o- Korouzouto
p- Hymne (Fchito)
q- Prise du consentement des deux époux
r- L’épouse et l’épouse se prennent par leurs mains droites, et le prêtre met le bout de son étole et sa main droite au-dessus de leurs et récite une prière
s- Le prêtre bénit les deux anneaux
t- Le prêtre leur met les anneaux dans leurs mains gauches et récite une prière
u- Prière de la bénédiction des couronnes
v- Couronnement de l’époux avec la récitation d’une hymne puis d’une prière
w- Couronnement de l’épouse avec la récitation d’une hymne puis d’une prière
x- Couronnement des paranymphes et prière
y- Tous chantent une hymne de saint Ephrem (Mchiho dadnah men maryam)
z- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’époux et puis lui ôte la couronne
aa- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’épouse et puis lui ôte la couronne
bb- Le prêtre récite une prière sur la tête des paranymphes et puis leur ôte leurs couronnes
cc-Prière
IV- Prière finale
a- Prière finale
4. Comparaison entre le rite de 1306 et celui de 1942
4.1. Comparaison entre les deux rites des fiançailles
| Rite de 1306 |
Rite de 1942 |
| a- Consentement |
a- Consentement |
|
b- Réponses affirmatives |
|
c- Proclamation du prêtre |
| b- Prière |
d- Les deux fiancés se tiennent par la main droite, et le prêtre voile leurs mains par son étole et récite une prière |
| c- Autre prière |
e- Ils se lâchent les mains et le prêtre récite une autre prière |
| d- Prière sur l’huile |
|
| e- Onction des fiancés et des présents |
|
Ce tableau comparatif montre une divergence dans la structure des deux rites des fiançailles. Certains éléments ont été préservés dans le rite de 1942, alors que d’autres ont été soit transformés, soit éliminés.
Le premier élément qui est celui de la prise du consentement des deux fiancés a été préservé par le nouveau rite, aucun changement n’est à souligner à ce niveau. Quant aux points “b” et “c” du rite de 1942, ils sont inexistants dans le manuscrit du 1306. Il se peut que la réponse des futurs fiancés soit comprise implicitement après la prise du consentement dans le rite de 1306. Une telle hypothèse pourrait être appuyée par la proclamation “c” du prêtre qui supposerait un consentement explicite : “regardez, je suis par le témoignage des présents innocent de votre engagement”.
Les prières “b” et “c” de 1306, et les prières “d” et “e” de 1942, sont presque les mêmes (cf. l’appendice). Mais ce qui est à noter est le nouveau cachet sacramentaire qu’a revêtu le rite : le prêtre utilise désormais son étole et prie sur les mains des fiancés. Cette procédure est inexistante dans l’ancien rite. Il est probable que cette coutume soit d’influence latine, puisque la théologie sacramentaire orientale antique utilise en général l’huile comme signe sacramentel.
La prière sur l’huile ainsi que l’onction sont inexistantes dans l’ancien rite : le “d” et le “e” de 1306 sont une spécificité de ce dernier. Il appert que l’onction était utilisée naguère, non seulement pour le baptême, la confirmation, l’onction des malades et le sacerdoce, mais aussi pour le mariage. La remise d’une telle pratique à jour inscrirait davantage le rite du mariage maronite dans le sillage d’une théologie syro-antiochienne antique.
Un autre fait est à souligner : les présents sont aussi oints par l’huile bénie. Ceci est peut-être un signe qui étend la responsabilité des fiançailles à toute la communauté (qui a offert les cadeaux).
4.2. Comparaison entre les deux rites de la bénédiction des anneaux
| Rite de 1306 |
Rite de 1942 |
| a- Prière de la bénédiction des anneaux et des ceintures |
a- Prière de la bénédiction des anneaux |
| b- Trisagion |
|
| c- Credo |
|
| d- Hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre |
|
| e- Hymne chantée par le diacre |
|
| f- Mazmouro (chant) des lectures |
|
g- Korouzouto h- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prièreb- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière c- S’il y a des ceintures et d’autres habits, le prêtre y récite une prièrei- Le prêtre ceinture les fiancés en récitant une prièred- S’il veut, le prêtre ceinture les fiancésj- Pater k- Prière finalee- Prière finale
Dans le rite de 1942, il s’agit dans “a” d’une bénédiction des anneaux, tandis que dans le rite de 1306, il s’agit dans “a” d’une bénédiction des anneaux et des ceintures. La bénédiction des ceintures pourrait évoquer tout un symbolisme de la pureté, de l’abstinence et de la virginité conjugale. Alors que même si la bénédiction des ceintures est mentionnée dans le nouveau rite, elle est désormais facultative et non essentielle comme dans le rite de 1306.
Entre les deux rites de la bénédiction des anneaux se trouve une divergence majeure. Toute une partie est omise dans le rite de 1942, à savoir: “b” Trisagion, “c” Credo, “d” hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre, “e” hymne chantée par le diacre, “f” mazmouro (chant) des lectures, et “g” korouzouto. Beaucoup d’hypothèses peuvent être dites sur cette partie. On remarque cependant que la partie omise ressemble quelque peu à la structure de la première partie de la messe (la partie de la parole).
En ce qui concerne le Trisagion, sa présence peut être qualifiée d’ordinaire puisqu’il se trouve dans la messe et dans tous les offices liturgiques. Quant au Credo, il est de coutume orientale de le réciter dans la messe et à chaque prière liturgique (office).
Le manuscrit n’indique pas des lectures bibliques, mais le Mazmouro des lectures le suppose, bien qu’il puisse être parfois présent sans qu’il n’y ait des lectures à faire (comme dans certains offices nocturnes par exemple). Cependant le Korouzouto vient souvent se placer après les lectures bibliques.
Si dans l’ancien rite, il y a une bénédiction des anneaux et des ceintures dès la première prière, dans le nouveau rite, la bénédiction -facultative- des ceintures et des autres habits (inexistants dans 1306) vient se placer presque à la fin comme si elle n’était pas d’une très grande importance. La bénédiction des ceintures est facultative du moment qu’elle est obligatoire dans l’ancien rite.
La prière du Pater est omise du nouveau rite, alors que la prière finale est la même pour les deux rites.
Pourquoi y a-t-il eu tant d’omissions dans le nouveau rite ? Est-ce par ce que le rituel devenait trop long pour certains ? Ou est-ce un changement de mentalité sur certaines pratiques qui l’a entraîné ? Et la latinisation n’est-elle pas à l’œuvre ? Une recherche reste à faire à ce niveau.
4.3. Comparaison entre les deux rites de couronnement
|
a- Avant de commencer le rite, le prêtre récite les prières qui précèdent le couronnement, telles les prières qui précèdent l’office. |
|
b- Doxologie |
|
c- Prière initiale |
|
d- Tous récitent le psaume 128 |
|
e- Froumiyoun (avec encensement) |
|
f- Sédro |
|
g- Hymne (‘afifo) |
|
h- Prière de l’encens |
| a- Prière proclamée par le diacre (hlof chayno) |
|
| b- Bo’outo de saint Jacques chanté par le prêtre portant les couronnes de sa main droite |
|
| c- Trisagion |
|
| d- Mazmouro (chant) des lectures |
i- Mazmouro (chant) des lectures |
| e- Lecture d’Ep 5, 20-27 |
j- Lecture d’Ep 5, 22-27 |
|
k- Fétgamo |
| f- Lecture de Mt 19, 1-11 |
l- Lecture de Mt 19, 3-6 |
| g- Korouzouto |
m- Chant de louange (wleh leychou’ mchiho…) |
|
n- Homélie, ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux |
| h- Chant de louange (wleh leychou’ mchiho) |
o- Korouzouto |
| i- Hymne (Fchito) |
p- Hymne (Fchito) |
| j- Le diacre proclame: prions |
|
|
q- Prise du consentement des deux époux |
| k- Le prêtre joint les mains des époux et proclame trois fois une doxologie trinitaire |
r- L’épouse et l’épouse se prennent par leurs mains droites, et le prêtre met le bout de son étole et sa main droite au-dessus des leurs et récite une prière s- Le prêtre bénit les deux anneaux t- Le prêtre leur met les anneaux dans leurs mains gauches et récite une prièrel- Prière de la bénédiction des couronnesu- Prière de la bénédiction des couronnesl’- Autre prière m- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’époux en récitant une prièrev- Couronnement de l’époux avec la récitation d’une hymne puis d’une prièren- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’épouse en récitant une prièrew- Couronnement de l’épouse avec la récitation d’une hymne puis d’une prièreo- Autre prière sur l’épouse
x- Couronnement des paranymphes et prièrep- Le prêtre encense en chantant une hymne de saint Ephremy- Tous chantent une hymne de saint Ephrem (Mchiho dadnah)q- Prière sur la tête de l’époux r- Prière sur la tête de l’épouse s- Prière sur les deux ensemble s’- Autre prière S’’- Autre prière t- Le prêtre met sa main sur la tête de l’époux en récitant une prière, et puis
lui ôte la couronnez- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’époux et puis lui ôte la couronneu – Le prêtre met sa main sur la tête de l’épouse en récitant une prière, et puis lui ôte la couronneaa- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’épouse et puis lui ôte la couronnev- Prière sur les paranymphes
bb- Le prêtre récite une prière sur la tête des paranymphes et puis leur ôte leurs couronnesv’- Prièrecc- Prièrew- Prière proclamée par le diacre
Le premier fait très important à constater est la structure “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” du rite de 1942. C’est une structure très proche de celle de l’office et de la messe ; elle comprend une doxologie, une prière initiale, un psaume, un “houssoyo”, ce qui est inexistant dans l’ancien rite.
Depuis son début, le rite de 1306 diverge avec celui de 1942. La première prière (hlof chayno) proclamée par le diacre est inexistante dans le nouveau rite. Ceux qui précèdent, à savoir “b” et “c” sont aussi inexistants dans le rite de 1942. Il est à mentionner que le chant “b” chanté par le prêtre seul (portant les couronnes) est long. Et en ce qui concerne le Trisagion, c’est la deuxième fois qu’il apparaît dans la totalité du rite.
Les deux rites se rejoignent pour la première fois dans le Mazmouro des lectures: “d” dans 1306, et “I” dans 1942. Les textes des deux Mazmouro sont les mêmes.
Comme dans presque tous les rites maronites, les Mazmouro précèdent les lectures. La première lecture de saint Paul est presque similaire dans les deux rites, sauf que dans le rite de 1306 la lecture commence d’Ep 5, 20 et non d’Ep 5, 22 comme dans le nouveau rite.
Après la lecture de l’épître paulinienne, il est d’habitude de réciter dans l’Eglise maronite le Fétgamo, ce qui est le cas pour le rite de 1942 (k), et non pour celui de 1306. On ne récitait peut-être pas de Fétgamo naguère, ou sa récitation était tellement évidente qu’elle n’a pas été mentionnée ?
En ce qui concerne la lecture de l’Evangile (Mathieu) elle est presque la même dans les deux rites, sauf que celle de 1306 est plus longue. Dans l’ancien rite on lisait Mt 19, 1-11, tandis que dans celui de 1942, on ne lit que Mt 19, 3-6.
A la suite des lectures bibliques se trouvent deux éléments communs aux deux rites. Mais ce qui diffère est le Kourouzoto de 1306 qui est parallèle au chant de louange de 1942 et vice-versa. Quant à l’homélie, elle se dit dans le rite de 1942 après l’Evangile (n), alors qu’elle se situe dans le rite de 1306 à la fin, avec les prières finales.
Les deux rites se rejoignent à nouveau dans le chant Fchito, “h” pour 1306 et “p” pour 1942. Les paroles du chant sont les mêmes pour les deux rites.
La proclamation du diacre “prions” “j” dans 1306 est inexistante dans le rite de 1942.
La prise du consentement des deux époux (“q” dans 1942) est inexistante dans le rite de 1306. En effet, la prise de consentement est latine, et dans tous les rites orientaux originaires, il n’y a pas de prise de consentement pour le mariage. Le seul consentement que nous trouvons dans le rite est celui du rite des fiançailles, et il n’est pas tellement formel (il s’agit d’un simple consensus familial que le prêtre dirige).
L’acte de joindre les mains des deux époux existe dans les deux rites. Cependant, sa forme diffère un peu d’un rite à l’autre. Dans le nouveau rite, s’ajoute l’insertion de l’étole, et la doxologie primitive est développée.
Dans le nouveau rite se trouve une prière de la bénédiction des anneaux, et puis une mise des anneaux dans les mains gauches des époux (“s” et “t”). Cet acte liturgique est inexistant dans l’ancien rite. La seule mention des anneaux dans l’ancien rite se trouve dans la partie de la bénédiction des anneaux.
Les deux rites se rejoignent à nouveau dans une prière de la bénédiction des couronnes. Cette prière est la même dans les deux rites. Cependant, elle est précédée par une autre prière qui a le même thème et qui est plus longue dans l’ancien rite (l’).
Le couronnement de l’époux est le même dans les deux rites, sauf que dans celui de 1942 il y a un ajout d’une hymne. Le couronnement de l’épouse est le même dans les deux rites, sauf que le prêtre récite en premier lieu une prière “n” qui est chantée dans le nouveau rite “w”. Puis il récite une autre prière “o” qui est la même prière de “w” dans le nouveau rite.
Dans l’ancien rite, il n’y a pas de couronnement des paranymphes (“x” dans 1942). Les anciens considéraient seulement les époux roi et reine dans ce rite.
Derechef, les deux rites se rejoignent dans une hymne éphrémienne (“p” dans 1306 et “y” dans 1942). Les différences relevées à cet endroit sont : l’absence d’encensement dans le rite de 1942, ainsi que la disparition de quelques strophes du chant qui est désormais chanté par toutes l’assemblée, alors qu’il était chanté par le prêtre seul dans le rite de 1306.
La structure “q”, “r”, “s”, “s’”, “s’’” de l’ancien rite sont inexistant dans celui de 1942 qui ne fait aucune allusion à ce moment liturgique, ni aux prières récitées.
Les prières “t”, “u” et “v” de l’ancien rite, à savoir celles où le prêtre ôte les couronnes, et celles où il prie sur les paranymphes trouvent leurs parallèles dans “z”, “aa” et “bb” du nouveau rite. Sauf que dans l’ancien rite, l’action du découronnement des paranymphes est inexistante puisqu’ils n’ont pas été couronnés auparavant. Il existe aussi une légère différence dans l’action liturgique qui accompagne ces prières : dans l’ancien rite, le prêtre posait sa main sur la tête de l’époux ou de l’épouse, tandis que dans le nouveau, il se contente de lever sa main droite.
La prière “v’” de l’ancien rite est la même que l’autre “cc” du nouveau rite.
Avec la prière “cc”, le rite de couronnement de 1942 se clôt. Cependant, il existe un élément en plus dans le rite de 1306: la prière “w” proclamée par le diacre.
4.4. Comparaison entre les deux prières finales des rites
| Rite de 1306 |
Rite de 1942 |
| a- Prière finale |
a- Prière finale |
| b- Homélie ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux |
|
| c- Tous proclament trois fois: Amour dans le Christ, Kyrie eleison |
|
L’une des différences essentielles qui se trouvent dans ce rite se situe au niveau des prières finales. Le seul point commun est la prière “a” qui est la même dans les deux rites. Par la suite, l’homélie se situe à la fin du rite de 1306 qui s’achève par une triple proclamation de tous : Amour dans le Christ, Kyrie eleison.
5. Conclusion
Par le biais de cette étude comparative, il est possible de pendre conscience de la problématique liturgique du rite de couronnement maronite. Toute réforme de ce rite gagnerait beaucoup à s’inspirer de l’ancien rituel qui garde des formes liturgiques syro-antiochiennes bien anciennes. L’un des éléments liturgiques orientaux les plus importants est celui de l’utilisation de l’huile sacrée lors du sacrement. De plus qu’une telle comparaison permet de mettre en exergue les nouveautés et les influences subies du rite de 1942.
6. Références
– Le livre des rites maronites (en syriaque et arabe), Bkerké 1942, p. 231-268.
– Baissari Françis (Mgr), Rite ancien du couronnement maronite, Publications de l’institut de liturgie à l’université Saint Esprit n° 19, Kaslik 1994, p. 7-34.
Dr Antoine Fleyfel
Travail effectué en 1999 au Liban et modifié le 28 janvier 2008 à Paris.

Il y’a presque deux ans, mon manque d’informations précises sur la sépulture de Spinoza m’avait mené à Amsterdam, là où je n’ai même pas pu trouver la maison où il est né (maison qui a disparu, et qui se situait au niveau du « marché aux puces » actuel). À mon retour de ce premier voyage dans cette belle ville où il fait bon vivre, je me suis bien renseigné, et j’ai attendu le moment opportun afin de mener en bonne et due forme le pèlerinage spinoziste que je comptais effectuer avant la soutenance de ma thèse.
La période est celle du Réveillon 2008, et le chemin menant de Paris à Den Haag passe par Aachen, Köln, Antwerpen et Rotterdam. Ce ne sont pas les gloires de Charlemagne ou l’impressionnante cathédrale colonaise, ni même l’éclat des diamants ou les croisements du port et du pont qui vont se mesurer à la puissance de l’humble sépulture située au dos d’une église, et presque ignorée dans son Eden…
Spinoza meurt jeune en 1677, et sa philosophie lui avait valu beaucoup d’ennemis. En plus de la synagogue juive qui l’avait excommunié en 1657, il était considéré impie par les chrétiens (surtout les calvinistes) et était rejeté par les cartésiens. Cet homme libre qui a fréquenté les milieux les plus libéraux, et qui a trouvé autour de lui un cercle d’amis fidèles, est mort dans une presque exclusion. Personne n’a voulu de la sépulture de celui qui est considéré par l’opinion publique comme païen et anti-religieux, et c’est dans le jardin d’une église protestante qu’il a été enseveli, la « Nieuwe Kerk » à Den Haag.
D’aucun pourrait s’étonner que la majorité des habitants de cette belle ville connaissent bien ses centres commerciaux et ses restaurants, mais ignorent l’existence de la sépulture du grand philosophe dans leur ville ; piètre image du vrai de ce monde…
J’étais pressé d’arriver à cette église qui n’était pas difficile à trouver, et ma joie était presque à son paroxysme lorsque j’ai aperçu ce temple protestant dont l’architecture oscille entre celle de la renaissance et du romantisme. Après une très brève halte qui m’a permis de lire à son entrée les inscriptions bibliques en néerlandais, je me précipite à l’arrière du bâtiment, et une puissante émotion ne tarde pas à s’emparer de ma raison et de mes larmes, lorsque la sépulture du grand maître se présente à ma vision.
L’éternité s’est emparée des mes instants, et je me suis trouvé immobile au sein d’un moment qui ne coule qu’en transcendant l’espace et le temps. L’humble sépulture était encore plus belle que ce que j’imaginais, Spinoza était au rendez-vous…
Mon existence était intense durant cette rencontre, qui est loin d’être la première, mais qui est exclusive en ce qu’elle porte de symbolique et d’humain. J’ai dit beaucoup de choses au philosophe, comme s’il était présent devant moi. J’ai causé de Dieu (en qui il existe comme il l’a bien pensé) et de l’homme, de la sagesse et de la politique, des passions et de la béatitude. Et dans un esprit de recueillement presque religieux, j’ai remercié le grand maître d’avoir été mon guide en philosophie, de m’avoir appris à penser, et de m’avoir montré la voie de la puissance de l’Intellect… Si Spinoza est incontournable pour l’histoire de la philosophie, il l’est aussi pour moi d’une manière personnelle. La présence de sa pensée renforce la vocation et la responsabilité du philosophe… et combien notre monde actuel a besoin de philosophes vertueux tel Baruch Spinoza.
Après d’ultimes paroles affectives prononcées à l’écoute de l’éternité de Dieu, je dépose un bouquet de fleur, témoin de ma gratitude, de mon hommage, de mon respect et de ma profonde affection.
Ce pèlerinage philosophique qui contourne légèrement la raison, mais qui participe à la Nature par ses affects, n’est qu’un moment esthétique, qui s’inscrit dans une réflexion vivante qui dépasse tout lieu et tout temps, et qui dépasse même les personnes les plus grandes en rejoignant l’infinité, et en se concrétisant par la tentative de la concrétisation de la béatitude de l’homme dans des cités de paix et de libre pensée. Là est la responsabilité du philosophe, et là est le mérite de Spinoza qui ne cesse d’interpeller et de responsabiliser à ce niveau.
Maître, merci !
Antoine Fleyfel
04.01.2008
Le Traité théologico-politique est-il un traité de tolérance religieuse en plus d’être un traité sur la liberté de philosopher ? Cette question est importante dans la mesure où la « liberté de philosopher » est au centre de la pensée spinoziste. Elle figure parmi les raisons qui ont poussé Spinoza à rédiger son traité. Mais est-ce que faire du Traité théologico-politique un traité de la liberté du philosophe et de la pensée implique la tolérance religieuse ? Cette question est posée à partir d’une constatation de l’importance de la notion de « tolérance religieuse » durant l’époque de Spinoza. Celle-là est débattue, (en raison surtout de questions d’ordre théologico-politique), et les traités sur la « tolérance » sont loin de manquer. Avant d’examiner la pensée de certains auteurs représentant cette vague de la tolérance religieuse, il serait opportun, pour plus d’éclaircissement, d’examiner la définition du terme « tolérance ».
Le « Dictionnaire de la langue philosophique », définit « Tolérance » de la sorte : « Lat. tolerentia, der. de tolerare, supporter (au propre et surtout au fig.). A. Dans un sens très large : action de tolérer, c.-à-d. d’admettre sans réaction défensive. Tolérance de l’organisme à des conditions anormales. Tolérance en ce qui concerne le poids ou les dimensions… […]. B. Dans l’acception la plus usuelle (morale, politique) : attitude concédant aux autres la liberté d’exprimer des opinions que l’on juge fausses et de vivre conformément à ces opinions. Syn. : permission, concession, autorisation, liberté, faculté, licence […] ».[1] Cette définition pourrait poser problème en raison de la parenté, sinon de l’adéquation qui est faite entre la liberté et la tolérance. Or, si tolérance est synonyme de liberté, la question de savoir si le Traité théologico-politique est un traité de tolérance ou de liberté est résolue. Mais, est-ce bien le cas ?
A partir du XVIe siècle[2], la tolérance commence à jouer le rôle d’une vertu[3]. Au moment de la Réforme et de la Contre-réforme, plusieurs vicissitudes politiques et religieuses (surtout des édits), ainsi que la croissance du pouvoir des Etats pousse d’aucuns à penser cette question. C’est aussi le problème de la cohabitation entre différentes confessions (des Eglises rivales surtout) qui rend urgent la recherche d’un système favorisant la coexistence.
Sébastien Castellion (1515-1563) fait partie des gens qui ont pensé cette question au XVIe siècle. Ce protestant et humaniste français se brouille avec Calvin et devient professeur de grec à Bâle. Il est très gêné par le supplice de Michel Servet[4] à Genève, et rédige une œuvre qui n’est que la riposte à ce supplice, et qui s’intitule : « Le traité des hérétiques, à savoir si on les doit persécuter, et comme on se doit conduire avec eux, selon l’advis, opinion et sentence de plusieurs auteurs » (1554). Cette œuvre apparaît comme une œuvre de tolérance dans le sens où il y invite à l’acceptation de l’autre. Il y a une norme commune voire une limite que personne n’a le droit de transgresser, et cette limite, Castellion la restreint tellement que presque toutes les communautés qui s’entretuent (notamment les réformés et les catholiques) peuvent s’y conformer. Après avoir formulé une définition de ce que le terme hérétique pourrait signifier : « nous estimons hérétiques tous ceux qui ne s’accordent avec nous en notre opinion »[5], il donne la définition de cette norme qui serait un principe de tolérance, de paix, et d’acceptation de l’autre : « Hors de ces deux articles fondamentaux : « un seul Dieu et Jésus-Christ son fils », tous les autres points de doctrine sur lesquels les chrétiens se séparent, tel que le baptême, l’âme, le libre arbitre, etc., sont déclarés indifférents »[6]. Pour appuyer sa thèse, il fait référence à certains Pères de l’Eglise, à Luther, à Brenz, à Erasme, à Calvin, et à lui-même. Pratiquement, cette norme théorique pouvait être à l’origine du dénouement du problème que vivaient catholiques et protestants au siècle de la Réforme, puisque les problèmes principaux au sujet desquels ils s’affrontaient étaient d’ordre institutionnel, sacramentaire, théologique, et ne portaient pas sur la question de l’unicité de Dieu, ou sur la filiation divine de Jésus (bien que Luther ait quelques restrictions sur certaines formulations christologiques, notamment chalcédoniennes, il reste fidèle à la tradition christologique dogmatique traditionnelle).
Le traité de Castellion envisage la tolérance de diverses manières. Il est possible d’y lire : « qu’un chacun retourne à soi-même, et soit soigneux de corriger sa vie, et non de condamner les autres »[7]. Il invite aussi à une conversion intérieure et personnelle qui favoriserait la tolérance et l’acceptation de l’autre. Les réactions contre cette forme de pensée pousse Bèze à dire que la charité telle que la comprend Castellion est une charité diabolique et non chrétienne ; quant à Calvin, il le traite de monstre qui a autant de venin que d’audace[8].
En bref, les causes qui ont poussé Castellion à rédiger son traité, et bien avant, à se séparer de Calvin, sont au nombre de deux : premièrement, l’absolutisme de Calvin qu’il qualifiait de tyrannique (dans un manuscrit de Castellion intitulé : « Contra libellum Calvini » on lit : « Jean Calvin jouit aujourd’hui d’une très grande autorité, et je lui souhaiterais plus grande encore si je le voyais animé de sentiments plus doux »[9]) ; deuxièmement, l’intolérance vis-à-vis de ceux qui pensent différemment (cas Servet), ce qui pousse à considérer son courage comme un plaidoyer pour la tolérance. Sa tolérance a cependant ses limites, puisqu’elle se borne à la seule religion chrétienne (cf., la norme évoquée supra), et ne peut impliquer le judaïsme par exemple où Jésus-Christ n’est point reconnu comme fils de Dieu ou comme Christ. Mais il est possible de dire que son traité est d’une certaine manière un traité de la liberté du chrétien, puisqu’une fois le Dieu Un, ainsi que son Fils Jésus-Christ confessés, le chrétien a la liberté de suivre le chemin qu’il veut pour vivre cette confession, ou en d’autres termes, sa religion chrétienne. Nous pouvons qualifier cette liberté de liberté religieuse (chrétienne). Il faut toutefois être conscient que la véritable motivation de Castellion n’est pas cette exigence de liberté religieuse, mais la nécessité de lutter contre l’intolérance qu’il vit autour de lui, et qu’il ne put supporter, ce qui le poussa à réagir, et à rédiger son traité de tolérance.
John Locke (1632-1704), contemporain de Spinoza, est le principal initiateur de l’empirisme anglo-saxon. En 1689, il rédige une « Lettre sur la tolérance » (Epistola de tolerentia ad clarissimum virum). Comme tous les philosophes qui ont pensé la question de la tolérance, Locke n’écrit pas pour le plaisir de spéculer ; ce sont plusieurs circonstances politiques qui l’ont poussé à rédiger sa Lettre, entre autres, la persécution religieuse dans l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Cette persécution toucha même la personne de Locke qui fut contraint de fuir l’Angleterre vers les Pays-Bas pour des raisons politiques et religieuses.
Avant sa « Lettre sur la tolérance », Locke avait déjà composé en 1667 un « Essay concerning toleration ». Il y défendait la tolérance envers les non-anglicans, mais non envers les catholiques, qu’il dénomme papistes et qui font des confusions entre le spirituel et le politique. Il rédige aussi, entre 1673 et 1674 : « On the difference between civil and ecclesiastical power, indorsed excommunication », et en 1679 : « Tolerentio ».
Dans sa « Lettre sur la tolérance », Locke établit une distinction très claire entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. L’Etat jouit d’un pouvoir purement temporel, et n’a rien à voir dans le domaine rituel ou spirituel. Son devoir consiste « à veiller à la paix, à la sécurité et à l’intérêt publics, qui sont des biens terrestres »[10]. Ainsi, la liberté de jugement de chacun est sauvegardée. Pour qu’il y ait tolérance, il faut qu’il y ait séparation entre l’Eglise et l’Etat parce que l’intolérance n’est que la conséquence de la confusion entre ces deux domaines. Les Eglises (Locke les mentionne au pluriel) ne sont que des institutions privées qui n’ont rien à voir avec la collectivité (ou en d’autres termes avec tout ce qui a rapport au pouvoir civil, ou à la communauté civile ou politique).
Avec Locke, c’est un principe de laïcité de l’Etat qui prévaut. La question du culte est une question personnelle, et tout le monde a des droits égaux. A la différence de Castellion, sa tolérance s’étend aux païens, aux mahométans et aux Juifs. Il émet toutefois des réserves à l’égard des catholiques (les papistes) puisque par principe, ils sont une source d’instabilité sociale et politique du fait de reconnaître le pape comme souverain, c’est-à-dire comme autorité suprême, qui dépasse le spirituel et s’étend au temporel. Et puisque cette autorité que les catholiques revendiquent entre en conflit avec celle de l’Etat (ou du roi), Locke ne peut l’admettre.
Reste à noter que l’analyse de la tolérance chez Locke « se limite à la tolérance spécifiquement religieuse »[11]. Il cherche dans sa Lettre à donner des raisons philosophiques pour prouver qu’il ne faut point recourir à la persécution religieuse. Il tente de prouver l’irrationalité de la persécution religieuse.
En bref, la raison qui a poussé Locke à rédiger sa Lettre est le manque de tolérance religieuse. De par sa vision érastienne, la question du pouvoir relève de l’Etat, tandis que la question religieuse est une question personnelle. Est seulement rejetée la confession ou religion qui introduit une confusion entre ces deux domaines (à savoir les catholiques).
Pierre Bayle (1647-1706) est aussi un contemporain de Spinoza. C’est un auteur complexe qui est l’un des inspirateurs des Lumières. L’ouvrage de Bayle qui intéresse cet article est celui intitulé : « Commentaire philosophique sur ces paroles : Contrains-les d’entrer »[12]. C’est un des ouvrages fondateurs en matière de tolérance religieuse, mais qui, à la différence du texte de Locke, n’est pas un ouvrage de politique mais de controverse religieuse, notamment une critique de la justification augustinienne politique, laquelle, en se basant sur des textes d’Augustin, veut justifier la persécution des dissidents (en identifiant les donatistes qu’Augustin combattait et les protestants).
Bayle réfute dans son ouvrage toute conception et toute justification de la persécution religieuse. Il tente de prouver que la persécution est contraire à la lumière naturelle, à l’esprit de l’Evangile, qu’elle est chaotique, qu’elle s’oppose à l’Eglise pré-augustinienne, et surtout, qu’elle cause des guerres de religions infinies[13]. Il essaie aussi de montrer que ce n’est pas l’augustinisme politique qui est universel, mais la conscience morale. Il propose contre la persécution religieuse, la tolérance, qui est liée à l’affirmation des droits de la conscience, même si elle est erronée. « Dans la tolérance, pour Bayle, il est question fondamentalement d’une conscience morale « détachable » de l’entendement ou de la conscience religieuse »[14], ce qui le conduit à promouvoir une tolérance plus étendue que chez Locke, qui inclut même les athées. Dans ses « Pensées diverses sur la comète », l’idée de la vertu et du sens de l’honneur n’est pas exclue de l’athéisme, ce qui le mène à parler des athées vertueux, tels les épicuriens ou Spinoza.
Somme toute, Bayle avance deux arguments contre l’intolérance. Premièrement, il s’agit d’une falsification philosophique (de la lumière naturelle) et théologique (notamment biblique) pour appuyer les arguments de la persécution. Deuxièmement, cette persécution ne favorise point la paix, mais met les différentes parties en état de guerre perpétuelle.
Le dernier auteur qui intéresse cette réflexion est Voltaire (1694-1778). Bien qu’il soit d’une époque postérieure à celle de Spinoza, Voltaire s’inscrit dans ce mouvement de la tolérance et de la lutte contre la persécution religieuse. Il reprend par exemple, à sa façon, la critique de la théorie augustinienne que Bayle développe avant lui. Voltaire mène en outre plusieurs campagnes contre l’injustice et l’intolérance, notamment dans des affaires comme celles de Calas, de Sirvey et de Lally. En 1763, il publie une « Traité sur la tolérance ». Cet ouvrage est un traité de réhabilitation du protestant Callas qui a été injustement accusé d’avoir tué son fils (qui selon ses accusateurs, voulait se convertir au catholicisme), et fut supplicié sur la roue.
Ce traité dénonce le fanatisme, et Voltaire y plaide pour une attitude différente envers les protestants (il évoque aussi certaines injustices commises par les protestants contre les catholiques). Il y trace une histoire de la tolérance, et prend comme exemple Jésus-Christ, surtout contre la prétention chrétienne d’imposer le dogme ou la foi par la force, la contrainte ou la violence. Il est surtout frappé par le fait que certains veulent imposer aux autres des dogmes qui sont incertains et discutables. Il se moque des personnes qui croient que seule une religion est vraie, la leur. Voltaire apparaît dans cet ouvrage comme exaltant la fraternité avec toute l’humanité.
De la réflexion de Voltaire sur la tolérance dans ce traité, il est à retenir que Voltaire réagit d’une part contre une injustice, un fanatisme et une persécution religieuse, et qu’il réagit d’autre part contre une compréhension erronée du religieux (concernant les dogmes, l’exclusivité de la vérité, etc.). Son aspiration à la fraternité entre les être humains (en d’autres termes à la paix) est à souligner.
Ce parcours d’auteurs montre une progression de la réflexion sur la tolérance et sur l’acceptation de l’autre : de Castellion chez qui la tolérance se limite au domaine chrétien, à Locke qui l’admet pour les autres religions, à Bayle qui étend son acception aux athées, jusqu’à Voltaire qui prêche une fraternité universelle. Cette tolérance, nous la retrouvons chez Spinoza qui la développe à l’extrême. Le système spinoziste est en effet un système qui fait place à tous les types de personnes. Le sage qui vit selon la raison comme l’ignorant qui mène une vie passionnelle font tous deux partie de Dieu. Un retour à la théorie du droit naturel chez Spinoza permet de clarifier cette idée. Le conatus du sage qui suit les voies de la vérité, de la philosophie, est autant participant à la nature divine que le conatus de l’ignorant, celui qui est régi par ses passions plutôt que par sa raison. Spinoza arrive même à dire que les valeurs des sages sont équivalentes aux valeurs des ignorants. Ceci est évident du fait que pour le philosophe, il ne peut exister dans la Nature quelque chose qui soit contraire à la Nature. La Nature est une, univoque, moniste, et toutes les personnes jouissent du même droit de nature. L’égalité des hommes et l’admission de leurs diversités font partie des axiomes du système spinoziste. Même les passions font partie de la Nature, puisqu’il ne peut exister dans la Nature quelque chose d’autre que la Nature.
Cependant, trouver chez Spinoza cette ouverture à l’autre, et son acceptation extrême au point d’en faire un égal ne signifie pas que son traité ou sa pensée aient comme centre la tolérance. L’idée de tolérance est en effet présente, mais ce n’est pas elle qui prime dans le spinozisme. Déjà, les causes qui ont poussé les autres auteurs sus traités à rédiger leurs ouvrages sont assez différentes des causes qui ont poussé Spinoza à écrire. Il se trouve chez les quatre auteurs précédemment cités une réaction contre une persécution religieuse insoutenable. Le cas Servet chez Castellion, les persécutions religieuses en Angleterre chez Locke, la justification de la persécution chez Bayle, et les différents cas chez Voltaire. Bien que Spinoza ait été affecté par la mort d’une des personnes faisant partie de son cercle (Adrian Koerbagh), qui fut jugée pour avoir professé des opinions spinozistes, et qui périt en prison quinze mois après sa détention, et bien qu’il traite ouvertement de la question religieuse, c’est le problème de la liberté de pensée qui le préoccupe. Déjà, le cas de Koerbagh est un cas de philosophie et non de religion, puisqu’il a été jugé à cause de ses opinions philosophiques, et non à causes de ses opinions religieuses (bien que la procédure judiciaire ait été imprégnée de notions religieuses). Dans la préface du Traité théologico-politique, Spinoza affirme : « Si tel était le droit public que seuls les actes puissent être poursuivis, les paroles n’étant jamais punies, de semblables séditions ne pourraient se parer d’une apparence de droit, et les controverses ne se tourneraient pas en sédition. Puis donc que ce rare bonheur nous est échu de vivre dans une République, où une entière liberté de juger et d’honorer Dieu selon sa complexion propre est donnée à chacun, et où tous tiennent la liberté pour le plus cher et le plus doux des biens, j’ai cru ne pas entreprendre une œuvre d’ingratitude ou sans utilité, en montrant que non seulement cette liberté peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l’Etat, mais que même on ne pourrait la supprimer sans détruire la paix de l’Etat et la piété. Telle est la thèse que mon principal objet a été de démontrer dans ce Traité »[15]. Il ajoute aussi plus loin : « cette liberté peut et même doit être accordée sans danger pour la paix de l’Etat et le droit du souverain, elle ne peut être enlevée sans grand danger pour la paix et grand dommage pour l’Etat »[16]. Et de conclure : « ma conclusion est enfin que pour maintenir ce droit le mieux possible et assurer la sûreté de l’Etat, il faut laisser chacun libre de penser ce qu’il voudra et de dire ce qu’il pense »[17].
Ces trois citations poussent à conclure que le Traité théologico-politique est un traité sur la liberté de penser et non sur la tolérance. Bien qu’il est possible de parler d’une certaine tolérance et d’une acceptation de l’autre dans ce traité, c’est la liberté de penser qui prime, et Spinoza n’hésite pas à affirmer que ce fut la principale thèse qu’il voulait démontrer (selon sa célèbre lettre à Oldenburg). Mais, parvenu à ce stade, quelle différence faire entre un traité de tolérance et un traité de la liberté de philosopher ? A se borner à la définition du terme tolérance citée plus haut, il n’y aurait pas de différence. Cependant, cette analyse montre que les deux diffèrent. Dans les traités qui défendent la thèse de la tolérance, la tolérance est proposée comme solution au désordre social et politique causé par l’abus de pouvoir religieux, ou par l’insertion du religieux dans le politique, tandis que dans le cas de Spinoza, c’est la liberté de penser, ou plutôt le respect de la liberté de penser qui est proposé comme solution à l’impasse politico-religieuse.
Toutefois, les solutions proposées dans les deux cas (celui de la liberté et celui de la tolérance) mènent ou pourraient mener aux mêmes solutions. Dans le cas d’une tolérance poussée telle celle de Bayle ou celle de Voltaire, où tous les courants peuvent être inclus, y compris les athées, nous sommes très proches du spinozisme qui admet tout le monde (à une seule exception : que l’appartenance religieuse n’entre pas en contradiction ou en opposition au politique. Le système spinoziste est clair sur la question de la suprématie du politique, et en dehors de ce que le politique approuve, en dehors de la religion ou des religions que le politique approuve, aucune tolérance religieuse n’est possible, car une instance non approuvée par l’Etat est hors la loi). Ainsi, la différence qui peut être relevée est une différence de procédure et une différence de réflexion, et il est possible que des systèmes de pensée mènent aux mêmes résultats sans que leurs procédures soient forcément identiques. Même si un traité de la liberté de philosopher et un autre de tolérance mènent à des résultats qui se ressemblent et à des buts qui se rejoignent, l’exclusivité et l’originalité d’une œuvre ou d’une forme de réflexion ne peut être niée, surtout dans le cas de Spinoza, chez qui cette question de la liberté n’est pas liée à sa vision politique seule, mais à son ontologie.
En somme, le Traité théologico-politique est un traité sur la liberté du philosophe de philosopher, et en même temps sur la liberté de tous de vivre selon leur conatus, sous l’égide du politique bien sûr. Il était important de faire la distinction entre le traité de Spinoza et les traités de tolérance religieuse, puisque la confusion entre les deux est facile, et parce que la liberté est une notion qui occupe une place essentielle dans tout le système spinoziste. Cette nuance permettra de mieux comprendre la conception qu’a Spinoza de l’Etat, et sa compréhension du problème théologico-politique.
Dr Antoine Fleyfel
Paris 19.12.2007
————————————————-
[1] FOULQUIE Paul, Dictionnaire de la langue philosophique, PUF, Paris 1978, p. 729.
[2] La question de la tolérance est présente bien avant cette date, entre autres chez les Romains, et a pu avoir des sens bien différents. Il se produit cependant au XVIe siècle, un éclatement de cette notion.
[3] Cf., GUILLEMAIN Bernard, in Encyclopædia Universalis, Paris 1992, p. 713.
[4] Michel Servet (1511-1553) fut un médecin espagnol et un théologien protestant qui nia le dogme de la Trinité et la divinité du Christ. Fuyant l’Inquisition à Genève, il y fut brûlé suite à un procès où Calvin joua le rôle déterminant.
[5] In Encyclopédie philosophique universelle, les œuvres philosophiques, dictionnaire t. I, PUF, Paris 1992, p. 468
[6] Idem.
[7] Cité dans l’article Castellion Sébastien in Encyclopædia Universalis 2000 sur CD-ROM.
[8] Idem.
[9] Idem.
[10] In Encyclopédie philosophique universelle, op. cit., p. 1298
[11] Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, sous la direction de Monique CANTO-SPERBER, PUF, Paris 1996, p. 1537
[12] « Contrains-les d’y entrer » est une citation de l’Evangile selon Luc, 14, 23
[13] In Encyclopédie philosophique universelle, les œuvres philosophiques, dictionnaire t. I, PUF, Paris 1992, p. 962
[14] In Encyclopédie philosophique universelle, les notions philosophiques, dictionnaire t. II, PUF, Paris 1990, p. 2611
[15] SPINOZA B., Traité théologico-politique, GF Flammarion, Paris, 1965, p. 22
[16] Ibid., p. 26
[17] Ibid., p. 27
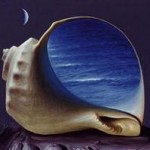
Mon regard me fixe de ton horizon,
Navigue sur tes eaux en traçant des mots,
Derrière tes pluies se mouille ma vision,
Et nage d’une grâce soupirant un souvenir.
Antan m’immisçant dans tes profondeurs,
Je dansais avec les lumières que l’Éternel m’envoyait,
Et quand comblé par tes courants je sommeillais,
Sur tes eaux je dormais couvert par tes vagues.
Je cherchais l’étoile du matin pour naviguer sur toi,
Bien que pirate et parfois requin tu m’étais loi,
L’aurore par toi est perpétuel commencement,
Témoignant de l’enfantement de l’Astre de toi.
Mes yeux cherchent en vain mon regard,
Ne trouvant que sables sans tes poissons,
Bien que le désert de toi donne hallucination,
Sans ta vie, Mer, dépérit la raison.
Antoine Fleyfel
08.11.2007
Publié sur le site Fumeur de pipe
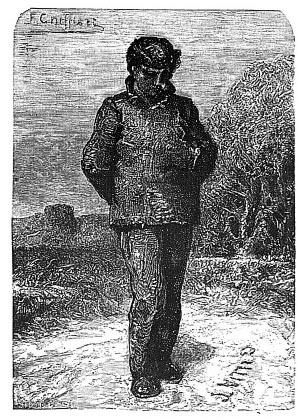
Penser requiert toujours un cadre nécessaire pour l’épanouissement de l’intelligence qui peut difficilement s’échapper des conditions d’existence imposées par la corporéité. Sans en faire une “insoutenable légèreté” ni “une prison de l’âme”, étant à l’aise et se voyant provoquer par un plaisir subtil, le corps réagit parfois des manières les plus surprenantes et les plus fructueuses, au niveau de son muscle le plus complexe qu’est le cerveau.
Tous les philosophes, les théologiens, les penseurs ou les artistes n’ont pas eu la chance d’avoir un cadre idéal de pensée. Que de prisons ont été les témoins de la naissance de puissantes et profondes pensées qui ont parfois façonné l’histoire de l’humanité. Le corps, aidé par une puissante volonté réagit dans ce cas, d’une attitude d’autodéfense se manifestant par une affirmation de soi, signe d’une pulsion de vie refusant la disparition.
Même si j’ai connu des moments d’adversité qui ont poussé ma créativité artistique et poétique à son apogée, j’ai eu l’heur de me trouver des cadres agréables, permettant son épanouissement à ma raison. Et pour souligner la continuité historique de l’élément essentiel de ce cadre, je profitais de mes pauses de travail pour regarder, voire même communiquer avec les trois personnes dont les portraits étaient accrochés au dessus de mon bureau.
Spinoza, mon sage et mon saint : je l’imaginais à la suite de ma lecture de sa biographie, en train de préparer sa pipe et de la fumer, l’après-midi, tout en observant une lutte d’araignées… Bach, mon coup de foudre musical et mon inspirateur : combien ma joie était grande lorsque j’avais appris qu’il fumait la pipe, et qu’il avait même composé la musique d’un poème ayant comme titre “So oft ich meine Tobacks-Pfeife”. Et Bultmann, ce théologien qui m’a tellement fasciné, et qui n’a toujours pas fini de provoquer en moi des tempêtes. Sa photo était là devant moi, pipe à la main.
L’un de mes cadres de travail intellectuel premier était centré autour de la pipe. Il ne s’agissait pas tout simplement de singer les grands de l’histoire, bien que je n’y vois aucun mal, mais davantage, le rituel presque liturgique de la préparation de ma pipe est comme un Introït qui m’initie à un monde où le souffle traverse comme au travers d’un instrument chantant une hymne cosmique, et la fumée s’élève comme de l’encens, odeur délicieuse à la gloire de l’Idée. Toutes les pipes ne se ressemblent pas, et toutes ne correspondent pas à tous les moments. Il y en a pour la pluie et il y en a pour le beau temps. Il y en pour les problèmes difficiles à résoudre, et il y en a pour les lectures ayant la détente comme but. Et encore, le jeu ne se complète que par un choix adéquat de tabac. Un jour ensoleillé tolère difficilement un tabac rude, et un jour d’été nécessite quelques arômes fruités pour décorer l’Arbre de vie. Alors que les moments de froid et de tempêtes (idéaux pour la pensée) imposent un tabac sur, amer et puissant, comme les passions de ceux qui ne traversent l’histoire qu’en la changeant.
Si cette pipe est l’instrument du chant cosmique, son rythme danse sur les pas de la musique dite classique. Celle-ci est de même tributaire du sujet à aborder. Un écriture poétique s’enfante volontiers par un piano jouant les Etudes de Chopin, alors qu’un sobre texte philosophique prend bien vie en étant pénétré par les “Picture at an exhibition” de Mussorgsy. De même qu’en théologie, rien de tel que les “Passions” de Bach ou le “Requiem” de Mozart pour marier la mélodie avec la fumée.
Les problèmes les moins ardus seront traités durant la journée. Et si la lumière est de la vie créant, c’est la nuit que les sujets qui nécessitent un enfantement devraient être abordés. La nuit de l’esprit n’est qu’un moment de délicieuse attente qui prépare la venue de la contemplation. Cette nuit intellectuelle se décore volontiers par des bougies, élégantes et bien disposées dans un salle qui, à la mesure du possible, reflète une architecture parfaire frôlant la perfection des idées.
Et à l’ivresse de la Vérité rationnelle recherchée, s’ajoute la touche d’un bon alcool, arrosant le muscle à tendance bien vicieuse, porte parole et organe de communication. Rien de tel qu’un bon armagnac, sec et fort, qui vieilli dans les fût de chênes, préfigure la maturation des idées et leur aboutissement au bout de longues années de labeur.
En bref, un pipe, un morceau de musique classique, une ambiance chaleureuse par sa sobriété et un livre d’idées arrosé par l’alcool, rien de tel pour s’oublier dans le monde de la pensée, là où l’absolu prend une forme intellectuelle et s’incarne dans la Pensée. Là où le chemin vers l’éternité est l’un des plus puissants possibles, buttant vers une connaissance du tout, qui découle sur un interminable travail sur soi.
Antoine Fleyfel
05.11.2007
05.11.2007

Chère absence,
Je t’écris cette lettre parce que tu comptes pour moi.
Quand tu étais là, je ne te fuyais au début qu’en jouant, mais par la suite, malgré tous les orages que j’étais de toi provoquant, je craignais tes joies.
Nos balades ne me manquent pas, mais combien de nos belles escapades marquent toujours mon soleil et mon vent. Et je te promets, que si tu es là, ne serait-ce que pour un instant, nous irions aux terres des astres naissants.
Je constate parfois ton ombre sur mes jours passés ; tu me cours après en fuyant, et je t’étreins lorsque la présence s’esquive.
Maintenant que tu n’es plus là présente, je m’inquiète de ton absence.
Mon corps sens toujours le baume de tes caresses, et je te sens là, las de ce que tu ne sois qu’illusion d’un passé traînant ses pieds sur des chemins incertains.
Je t’imagine perdue là où la lumière est chantée par le coq, là où les étoiles dansent aux rythmes du chant du loup.
Je pense à toi tellement tu manques, à une présence qui jaillit, du partage de l’oubli, entre le diable et l’existence.
Le jour où tu verras, mon étonnement se créer de notre rencontre, cache toi sous mes doigts, que je risque le prélude d’un parfum.
Je te prie de croire en ma profonde compassion.
Une connaissance de toi…
Antoine Fleyfel
14.10.2007
|
|