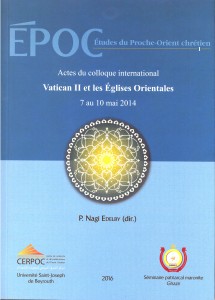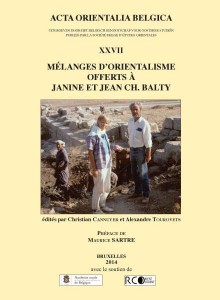|
|
Le patrimoine des chrétiens d’Orient et le monde arabe
Éditorial du n. 5/2017

De l’encens, des bougies et des iconostases de type byzantin ; des ornements liturgiques « exotiques », des langues qui rappellent l’aube du christianisme et une multitude d’Églises dont la complexité échappe souvent aux amoureux de ce christianisme. Il n’est pas rare que ces « clichés » soient évoqués lorsqu’il est question de parler des chrétiens d’Orient.
Cependant, la contribution civilisationnelle de ces derniers dépasse de loin ces simples lieux, car il est impossible de comprendre la culture arabe dans toute son étendue, et surtout (supprimer à) sa genèse, sans se pencher sur le patrimoine chrétien oriental. Celui-ci est déterminant à bien des égards, que ce soit sur le plan de la religion musulmane et son livre sacré, des sciences, de l’architecture, de l’économie, de la politique, de l’art, de la mystique ou des relations avec l’Occident.
Sans la langue syriaque par exemple, il est impossible de comprendre d’une manière pertinente du vocabulaire coranique et même l’évolution des lettres de l’alphabet arabe. Sans l’architecture des édifices syriaques antiques, il est impossible de saisir une partie de l’origine de l’architecture des mosquées et de leurs minarets. Sans la contribution scientifique et linguistique des savants chrétiens, syriaques, byzantins, coptes ou « nestoriens », il est impossible de comprendre la richesse et la grandeur de plus d’un califat musulman, notamment celui des Abbassides.
Parler donc du patrimoine des chrétiens d’Orient implique l’évocation d’un élément clef de la culture arabe, une dimension qui n’appartient pas aux communautés chrétiennes seules, mais au patrimoine de l’humanité ! Évoquer cet héritage rappelle la richesse de la rencontre des cultures et des civilisations, une rencontre qui est parfois positive, et qui produit à ce titre beaucoup de grandeur et de profondeur humaine. L’islam politique, quant à lui, veut faire fi de tout cela en pensant un monde à coloration unique, fondé sur des principes divins anhistoriques et fantasmés, faisant abstraction de toute contribution plurielle et diverse. Ses avatars les plus perfides, Daech, Al-Qaïda, les Talibans ou Boko Haram, détruisent physiquement et idéellement tout ce qui ne leur ressemble pas, tout ce qui indique que l’histoire de l’islam dans ses origines et son évolution leur échappe absolument.
Déployer le patrimoine des chrétiens d’Orient est une entreprise encyclopédique à laquelle ne prétend pas ce fascicule. Néanmoins, nous avons choisi d’exposer certains aspects de la chose à travers différents angles. Alors qu’Emmanuel Pataq Siman nous informe sur « Les emprunts lexicographiques au syriaque dans la langue arabe », Jean-Jacques Pérennès soulève la complexité qui entoure les Lieux saints en Terre sainte. Par ailleurs, vu la guerre ravageuse qui touche les chrétiens d’Irak et de Syrie de plein fouet, il nous a semblé de bon ton de demander à Christian Lochon de nous faire l’inventaire des destructions dont Daech est responsable, et de compter sur deux Aleppins, Sami Hallak et Abdallah Haddjar pour nous parler de « La présence des chrétiens à Alep ». Enfin, Abdo Badwi nous parle des iconographies non byzantines – réalité bien méconnue en Occident – et Samir Arbache de l’interdit de l’image dans l’islam, l’aniconisme.
Au nom de l’Œuvre d’Orient je sais gré à ces auteurs de leurs précieuses contributions qui permettent de comprendre davantage, de nuancer encore et de penser l’avenir d’une manière plus pertinente.
Souligner l’importance du patrimoine des chrétiens d’Orient c’est dire que nous croyons en un monde pluriel, c’est insister sur le fait que la rencontre des cultures n’est pas forcément un clash, mais un enrichissement mutuel, c’est faire de l’autre celui qui me complète !
Antoine Fleyfel
Perspectives & Réflexions
Rédacteur en chef
Mai 2017
Critiques maronites de Vatican II ? Les travaux de Hayek et de Moubarac sur l’islam, in Actes du colloque international Vatican II et les Eglises orientales du 7 au 10 mai 2014, 2016, p. 233-242.
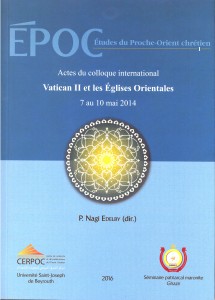
Introduction
Les contributions des maronites Youakim Moubarac (1924-1995) et Michel Hayek (1928-2005) à l’islamologie constituent un phénomène particulier dans l’univers théologique de l’histoire maronite récente. Cet article voudrait examiner leurs réflexions à ce sujet dans la perspective de ce que dit le Concile Vatican II à propos des musulmans.
Moubarac, membre de la délégation maronite, assista aux sessions de Vatican II et formula, dans plusieurs de ses écrits, des critiques de la lecture conciliaire concernant la religion musulmane. Sa réflexion autour de l’islam laisse croire que Vatican II ne serait pas allé suffisamment loin à son goût. Quant à Hayek, non convoqué à cet événement, il proposa une lecture de l’islam qui va bien au-delà des textes conciliaires. Cet article voudrait mettre en lumières ces questions qui restent des pistes très sérieuses pour le dialogue interreligieux et pour bien des domaines.
1- Les textes du Concile portant sur l’islam
Deux brefs textes du Concile nous informent de son abord de l’islam. Comme tous textes, ceux-ci peuvent être sujets à moult herméneutiques. Cependant, cette étude se limitera à une compréhension très basique des passages, tout en ayant comme perspective les islamologies de Moubarac et de Hayek. Il est à souligner que les deux textes ne sont pas de nature égale, car si le premier, Lumen Gentium, écrit central du Concile, est une constitution sur l’Église, le second, Nostra Ætate, n’est qu’une déclaration sur les religions non chrétiennes. Voici ce que nous apprend Vatican II sur la religion musulmane :
Le dessein du salut embrasse aussi ceux qui reconnaissent le Créateur, et en premier lieu, les musulmans qui, professant avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, qui jugera les hommes au dernier jour. (Lumen Gentium, II, 16). Continue reading Critiques maronites de Vatican II ? Les travaux de Hayek et de Moubarac sur l’islam
Le dialogue, malgré tout !
Éditorial du numéro 4, 2016, de la revue universitaire de L’Œuvre d’Orient, Perspectives & Réflexions.

Plus que jamais, la question du dialogue islamo-chrétien se pose. Pour cause, une situation de plus en plus compliquée et violente, où des terroristes, en Orient et en Occident, commettent des crimes au nom de leur version de l’islam. Que faut-il faire face à cette situation ? Si cette haine devrait appeler, selon certains, une haine encore plus grande, d’aucuns sont convaincus que le dialogue est le chemin qu’il faut emprunter. Non qu’il soit la solution magique et immédiate pour contrer le terrorisme, mais parce qu’il est l’antidote auquel il faut avoir recours en amont pour empêcher des idéologies violentes d’émerger et de se concrétiser. Vu de la sorte, le dialogue se constitue en impératif pour bâtir la paix. En outre, force est de souligner qu’il ne relève pas uniquement du champ politique, mais d’une réalité sociale, économique et culturelle où, plus que jamais, les humains doivent trouver les moyens de leur vivre ensemble, respectant la diversité et la différence.
Aujourd’hui, l’on doute de l’efficacité du dialogue et cela peut se comprendre : il est actuellement en crise et la situation mondiale le confirme. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il ne soit pas nécessaire, voire bon, qu’il ne s’y produit plus grand-chose et que nous devions nous en passer. Loin s’en faut ! Nonobstant les failles et les violences, le fanatisme et l’exclusivisme théologique, des chrétiens et des musulmans s’engagent toujours sur les chemins du dialogue, y percevant la voie royale pour l’avenir.
Quelques repères historiques
À l’initiative de chrétiens occidentaux, le dialogue islamo-chrétien commença après la Seconde Guerre mondiale et se développa dans les années 1950. Ses débuts étaient difficiles dans un contexte où l’on confondait Occident et intérêts politiques, où l’Orient souffrait toujours de la colonisation et subissait le choc et les conséquences de la création de l’État d’Israël… appuyé par les Occidentaux.
C’est dans les années 1960 qu’un tournant majeur et historique s’opéra sur le plan du dialogue. À cet égard, les actes du Concile Vatican II jouèrent un rôle important, mais aussi le Conseil mondial des Églises et le Conseil des Églises du Moyen-Orient. De grandes figures du dialogue purent mettre leurs recherches à contribution. Citons à titre d’exemple l’œuvre de Louis Massignon qui eut au moins deux disciples orientaux notoires, les plus importants islamologues de l’Église maronite au XXe siècle, Youakim Moubarac et Michel Hayek. En outre, les orthodoxes et les protestants étaient déjà partenaires d’un dialogue qui, à cette époque, prenait au sérieux les problèmes sociaux et politiques des musulmans, tout en évoquant le partage de la foi en un seul et même Dieu.
Continue reading Antoine Fleyfel, Le dialogue, malgré tout !, Éditorial, Perspectives & Réflexions, Œuvre d’Orient, n° 4, 2016
Article paru en deux parties dans la revue de l’Œuvre d’Orient. N° 780 (2015), n° 781 (2015).

Introduction
En cette année 2015 qui commémore le centenaire du génocide arménien, les concernés et les sympathisants font de leur mieux pour mettre en lumière les circonstances de ce drame, afin de le faire connaître et pour agir dans le sens d’une pleine reconnaissance et d’un dédommagement. À cette occasion, il est du devoir de mémoire de parler de l’une des personnes qui agirent le plus en France en faveur des Arméniens de l’Empire ottoman, sur trois décennies, Mgr Félix Charmetant (1844-1921), directeur de l’Œuvre d’Orient de 1885 jusqu’à sa mort.
S’agissant du sort des Arméniens, Charmetant mena, à partir de 1895, une très vaste campagne pour dénoncer les massacres et les crimes qu’ils subirent. Soldat infatigable, il utilisa tous les moyens possibles pour faire connaître les circonstances des malheurs qu’ils vécurent et pour leur apporter une aide de quelque nature qu’elle fût, financière ou politique. Sa littérature sur la question abonde et informe de l’ampleur de son action : ses éditoriaux et articles dans le bulletin de l’Œuvre, sa correspondance et plusieurs ouvrages dont : Martyrologe arménien : Tableau officiel des massacres d’Arménie, dressé après enquêtes des six ambassades de Constantinople, et statistique dressée par des témoins oculaires grégoriens et protestants des profanations d’églises, assassinats d’ecclésiastiques, apostasies forcées, enlèvements de femmes et jeunes vierges, Paris, Bureau des Œuvres d’Orient, 1896 ; L’Arménie agonisante et l’Europe chrétienne : Appel aux chefs d’État, Paris, Bureau des Œuvres d’Orient, 1897 ; Pitié pour nos pauvres frères d’Arménie !, Paris, Bureau des Œuvres d’Orient, 1910 ; Constantinople, Syrie et Palestine : Lettre ouverte à nos hommes d’État, Paris, Bureau des Œuvres d’Orient, 1915.
Il est impossible de rendre compte et d’analyser dans un article, aussi long qu’il soit, toute l’action de Félix Charmetant en faveur des Arméniens. Cela devrait faire l’objet d’un mémoire de master, voire d’une thèse de doctorat. Cependant, nous avons l’ambition de donner une idée de ce qui se fit en parlant de l’essentiel du combat mené par l’ancien directeur de l’Œuvre d’Orient. Ne pouvant évoquer sa militance pour la cause arménienne sur trois décennie, nous optons pour un examen de son activité durant deux périodes clefs des malheurs des Arméniens de l’Empire ottoman, à savoir les massacres hamidiens (1894-1896) et le génocide (1915-1916).
Continue reading L’action de Mgr Félix Charmetant, directeur de l’Œuvre d’Orient (1885-1921), en faveur de la cause arménienne
Éditorial du numéro 3, 2015, de la revue universitaire de L’Œuvre d’Orient, Perspectives & Réflexions.

« Le gouvernement jeune-turc n’a pu réaliser qu’en partie
son plan de profiter de la Grande Guerre pour établir la
turquification radicale de l’Empire ottoman. Il a toutefois
réussi à détruire environ un million d’Arménien, et des centaines
de milliers de Grecs, de Libanais et d’Assyro-Chaldéens[1]. »
Le troisième numéro de Perspectives & Réflexions paraît dans une année 2015 doublement difficile pour les chrétiens d’Orient : sur le plan de la mémoire, elle fait état de blessures de plus de deux millions de chrétiens qui perdirent la vie, il y a un siècle, à cause de la politique barbare et raciste des Jeunes-Turcs. Cette mémoire est à certains égards reconnue – mais pas suffisamment –, et à d’autres, oubliée ou ignorée. Un long travail reste à faire à ce sujet. Son actualité est marquée par la poursuite des violences criminelles dans le monde arabe, particulièrement en Irak et en Syrie. Des agissements atroces qui consistent à tuer au nom de Dieu, utilisant parfois de viles méthodes, détruisent ce qu’il y a de plus sacré : l’homme ! Citoyens des différents États du monde arabe, les chrétiens souffrent avec leurs partenaires de vie, sunnites, chiites, druzes, alaouites, yézidis et laïcs, des conséquences de la destruction et de la haine aveugle. L’année écoulée fut sinistre pour nombres d’Églises, notamment en Irak dans des foyers historiques comme Mossul ou Qaraqosh.
Pour faire mémoire de la funeste année 1915, mais aussi les conséquences de la Première Guerre mondiale sur les chrétiens d’Orient, nous avons choisi de consacrer cette revue à l’histoire pour rendre compte de plus d’un génocide perpétré contre les chrétiens au Proche-Orient. Sur ce plan, trois dossiers doivent être évoqués : le génocide arménien, ce que nombre de spécialistes dénomment génocide assyro-chaldéo-syriaque et la famine du Mont-Liban.
Le dossier arménien se débite en quatre articles. Il rappelle l’histoire générale de l’Arménie (M. Yévadian), traite des circonstances du génocide (M. Varoujan), met en lumière la situation de l’Église dans l’Arménie soviétique de 1920 à 1938 (P. Sukiasyan) et évoque la présence arménienne dans la Machreq (T. Yégavian). Quant au dossier assyro-chaldéo-syriaque, il est composé de trois articles. Ceux-ci étudient les circonstances de cet autre génocide méconnu de 1915 (J. Alichoran), les drames qui se succédèrent par la suite sur les communautés assyro-chaldéo-syriaques à travers exodes et exactions (J. Yacoub) et les difficultés récentes des chrétiens dans le nord de l’Irak (C. Lochon). Enfin, un dernier article traite de la grande famine du Mont-Liban (1915-1918), provoquée par le blocus ottoman et ayant coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de chrétiens.
Depuis trois ans, nous espérons dans cet éditorial des jours meilleurs pour le Moyen-Orient. Mais depuis trois ans, la situation n’a jamais été aussi meurtrière et critique. Cela ne peut être pour nous que l’occasion d’une activité encore plus intense. En dépit de la haine et de la mort, nous osons espérer, comme le dit saint Paul, contre toute espérance…
Antoine Fleyfel
Rédacteur en chef
[1]André-N. Mandelstam, Le sort de l’Empire ottoman, Payot, Lausanne-Paris, 1917, p. 29.
Éditorial du numéro 2, 2014, de la revue universitaire de L’Œuvre d’Orient, Perspectives & Réflexions.

Un an s’est déjà écoulé, et Perspectives & Réflexions est de retour, fidèle à son rendez-vous annuel, afin de proposer à ses lecteurs de nouvelles études sur les chrétiens d’Orient. Le démarrage de notre revue a été remarquable : presque 2000 fascicules demandés, ce qui est exceptionnel pour une publication de nature universitaire. Nous sommes reconnaissants à nos auteurs pour la qualité exceptionnelle de leurs textes, mais aussi à tous ceux, engagés et sympathisants, qui s’intéressent à la noble mission de l’Œuvre d’Orient.
Ce deuxième numéro met l’accent sur les relations des chrétiens d’Orient avec le monde, arabe et occidental, et les questions qui en découlent, en suivant trois de leurs aspects : la dimension œcuménique, le lien à l’islam et le rapport à l’Occident. Deux articles apportent une vue philosophique, historique et géopolitique sur la présence des chrétiens au Moyen-Orient.
Le premier article parle de la Syrie et de ses chrétiens, un sujet que nous avions choisi d’éviter l’année dernière, en espérant des jours meilleurs et plus de clarté sur la situation. Mais le conflit s’enlisant tous les jours dans une spirale de violence absurde et interminable, nous avons décidé de présenter les réflexions d’un fin connaisseur de la géopolitique du Moyen-Orient, Georges Corm, qui nous fournit une lecture de l’histoire, de l’actualité et des horizons de la présence chrétienne en Syrie. Mouchir Aoun nous livre la suite de son étude sur « Le réveil identitaire arabe et le destin du christianisme oriental contemporain » paru dans le numéro 1. Son texte présent entend « esquisser les grandes lignes d’une réflexion critique sur la condition d’existence individuelle et collective des chrétiens d’Orient ».
Les quatre articles suivants abordent la problématique des relations des chrétiens d’Orient. Gabriel Hachem souligne la grande importance de l’œcuménisme pour l’avenir de la présence chrétienne dans la région, tout en s’appuyant sur l’expérience du Conseil des Églises du Moyen-Orient. La question de la relation avec l’Occident est traitée par Bernard Heyberger. Il s’appuie sur une étude historique qui souligne les influences de l’Occident sur l’identité chrétienne orientale, notamment à travers les protections diplomatiques, l’érudition et la tension vécue entre la tradition et la modernité. Quant à l’islam, sujet qui soulève autant de passion en Orient qu’en Occident, il est abordé à travers deux angles différents. Michel Younès évoque ce qu’il considère être la vocation des chrétiens d’Orient dans leur rapport à l’islam et aux musulmans, et Georges Massouh étudie la place qu’occupent les chrétiens dans l’État islamique prônée par différents courants théologiques « islamistes ».
Je ne puis qu’exprimer une fois encore ma gratitude à l’Œuvre d’Orient qui permet, à travers ce projet, à nombre de lecteurs français et francophones de connaître encore mieux l’Orient et ses chrétiens. Toute ma reconnaissance aussi aux collègues et amis qui ont généreusement accepté d’écrire pour nous leurs précieuses réflexions.
Tout en n’oubliant pas les hommes et les femmes qui souffrent partout dans le monde, notre regard est particulièrement fixé en ce moment sur la Syrie pour laquelle nous espérons la paix, non celle qu’imposent la force, les intérêts politiques et économiques ou la destruction, mais celle qui prend source dans les cœurs des gens de bonne volonté…
Antoine Fleyfel
Rédacteur en chef
Article paru dans Acta Orientalia Belgica, XXVII, 2014, p. 87-95
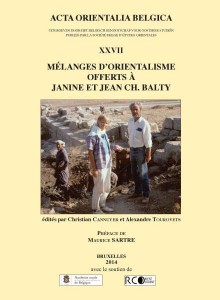
La critique de l’orientalisme par Edward Said
et la théologie contextuelle arabe dans son modèle libanais
Introduction
La comparaison entre la thèse de Said sur l’orientalisme et la pensée théologique contextuelle arabe dans sa version libanaise n’a jamais été effectuée. Pourtant, un grand nombre d’éléments plaide en faveur d’un grand rapprochement entre ces deux mondes qui abordent des questions similaires, mais à partir de disciplines différentes. Si Said s’appuie principalement sur la littérature pour démontrer ses thèses, mais aussi sur des analyses politiques d’actualité, des théologiens libanais fondent leurs démonstrations sur des éléments théologiques et religieux, tout en se versant, eux aussi, sur la chose politique. La cause palestinienne est sans doute le point commun par excellence, mais il est intéressant de constater que des réflexions théologiques sur l’œcuménisme peuvent aussi rejoindre la pensée de Said.
Qu’est-ce que la théologie contextuelle arabe dans son modèle libanais ?
Il s’agit d’une réflexion théologique locale qui se fait au Liban depuis les années 1970. Celle-ci rejoint dans sa logique les mouvements de théologies contextuelles mondiaux, et s’appuie, pour élaborer sa réflexion, sur le contexte libanais et arabe qu’elle considère comme un lieu théologique qui s’ajoute à l’Écriture et aux traditions ecclésiales. La théologie contextuelle libanaise repose sur les éléments suivants : le dialogue islamo-chrétien, l’œcuménisme, la réforme et le renouveau des Églises et de la théologie, ainsi que la théologie politique (arabité, cause palestinienne, sionisme, laïcité, confessionnalisme). C’est à partir de ces lieux théologiques que le rapprochement avec la pensée de Said sur l’orientalisme s’effectuera. Quant aux théologiens sur les travaux desquels ce travail s’appuiera, il s’agit de : Georges Khodr (1923 -), Youakim Moubarac (1924 – 1995), Michel Hayek (1928 – 2005), Jean Corbon (1924 – 2001), Mouchir Aoun (1964 -)[1].
Rappel de la thèse de Said
Il ne s’agit aucunement d’évoquer en ce lieu toute la critique saidienne de l’orientalisme ni d’évaluer sa réflexion dans sa globalité. Cela est un sujet qui fait actuellement tradition et qui est peut-être, à bien des égards, épuisé. L’important pour cette étude consiste à rappeler l’essentiel de la thèse de Said ainsi que les éléments qui convergent avec les données essentielles de la théologie contextuelle libanaise.
Said définit l’orientalisme de diverses manières. Retenons les trois sens principaux qu’il lui donna. Premier sens : « Est orientaliste toute personne qui enseigne, écrit ou fait des recherches sur l’Orient en général ou dans tel domaine particulier – cela vaut aussi bien pour l’ethnologue que pour le sociologue, l’historien, le philologue –, et sa discipline est appelée orientalisme[2]. » Deuxième sens : « Style de pensée fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre ‘‘l’Orient’’ et (le plus souvent) ‘‘l’Occident’’[3]. » C’est toutefois le troisième sens qui intéresse le plus cette recherche, et qui est d’ailleurs au centre de la thèse de Said : « L’orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d’autorité sur l’Orient[4]. » Son but est de « montrer que la culture européenne s’est renforcée et a précisé son identité en se démarquant d’un Orient qu’elle prenait comme une forme d’elle-même inférieure et refoulée[5]. » Cet orientalisme qui est donc domination de l’Occident sur l’Orient changea de main à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale : « Du début du dix-neuvième siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l’Angleterre ont dominé l’Orient et l’orientalisme ; depuis la guerre, l’Amérique a dominé l’Orient et l’aborde comme l’ont fait auparavant la France et l’Angleterre[6]. »
La réflexion de Said autour de l’orientalisme relève de la démythologisation. Celui-ci paraît effectivement comme une création culturelle et politique de l’Occident qui n’a rien à voir avec « l’Orient réel ». La suite de cet article examinera les lieux de convergence de l’orientalisme Saidien avec la théologie contextuelle libanaise.
Une domination politique et culturelle de l’Orient par l’Occident.
L’orientalisme est, selon Said, « une espèce de projection de l’Occident sur l’Orient et de volonté de le gouverner », ayant comme source l’orientaliste qui « est, à ses propres yeux, un héros qui sauve l’Orient de l’obscurité, de l’aliénation et de l’étrangeté qu’il a lui-même convenablement perçues »[7]. La religion fut jadis l’un des véhicules majeurs de ce processus, à travers les institutions missionnaires. Bien que celles-ci eussent contribué largement à bien des épanouissements dans la région (imprimeries, éducation et œuvres sanitaires), « du fait de leur caractère spécifiquement impérial, et parce qu’elles étaient soutenues par le gouvernement des États-Unis, ces institutions n’étaient pas différentes de leurs symétriques anglaises et françaises en Orient »[8].
La théologie contextuelle libanaise évoque ce genre de domination qui se traduit, selon ses perspectives théologiques et ecclésiales par le mouvement uniate évalué à partir des appartenances communautaires des théologiens.
S’agissant des orthodoxes ils le perçoivent d’un très mauvais œil. Khodr est leur porte parole à cet égard : « Il faudrait que Rome opérât un changement majeur dans son comportement avec les Églises orientales pour que celles-ci soient convaincues que la douceur des discours œcuméniques n’est pas une autre façade de l’hégémonie romaine »[9], ou en d’autres termes, un projet de la domination de l’ecclésiologie orientale par une occidentale qui est contraire à la tradition de l’Église en Orient. Le théologien en arrive à parler d’une « invasion catholique » des territoires orthodoxes, même jusqu’en Europe. Cela relève selon lui d’un prosélytisme catholique qui s’effectue sur un territoire patriarcal qui n’est pas du ressort de Rome.
Du côté catholique, les positionnements sur la question ne sont pas forcément plus doux. Jean Corbon, théologien grec-catholique, évoque ce même problème dans son projet d’une Église des Arabes[10]. Il y qualifie les Églises latine et protestantes présentes en Orient de racines adventices, et considère qu’il leur appartient de ne plus y agir pour appuyer leurs propres intérêts, mais pour aider les Églises locales à retrouver leur unité. Quant aux Églises uniates, produits de l’activité missionnaire occidentale, il leur appartient de régulariser leur situation avec leurs Églises mères.
Enfin, Youakim Moubarac, le théologien maronite, prônait le projet d’un synode antiochien qui eût été une éventuelle solution au problème œcuménique au Proche-Orient. Pour que celui-ci fût possible, il faudrait que l’Église maronite prît des distances avec la bureaucratie vaticane, en d’autres termes, avec une certaine forme d’hégémonie ecclésiale occidentale qui compromet, peu ou prou, l’identité orientale de l’Église maronite.
Une dépréciation de la langue arabe
Edward Said considère que « toute l’histoire de l’orientalisme montre qu’il s’est employé à faire, d’insinuations et d’hypothèses, des ‘‘vérités’’ indiscutables. La plus indiscutable et la plus bizarre de ces idées (puisqu’il est difficile de croire qu’on puisse la soutenir pour n’importe quelle autre langue) est peut-être que l’arabe, en tant que langue, est une idéologie dangereuse »[11].
Dans une perspective se rapprochant de celle de Said, la langue arabe revêt une importance majeure pour la théologie contextuelle arabe, d’autant qu’elle est la constituante essentielle d’une notion centrale, celle de l’arabité, en tant que donnée culturelle déterminante pour l’identité de la région.
À l’encontre d’une vision dépréciative et idéologique de la langue arabe, Moubarac considère l’arabité comme une notion profondément humaniste se distinguant de « l’arabisme »[12] qu’il considère « mâle et non dégrossi, sans discernement et à prédominance raciste »[13]. L’arabité, est constituée de deux composantes principales, religieuse et culturelle : les chrétiens et les musulmans. Ensemble, ils doivent répondre « à un certain nombre d’injonctions majeures sur le devenir politique et social des pays de la Révélation »[14], dont : la « désionisation » de la Palestine, la libération de tout confessionnalisme chrétien et musulman, l’instauration d’une justice sociale, l’insistance sur le pluralisme, la résistance à la violence par une politique de non-violence ; enfin, souligner l’importance de la langue arabe qui est la langue culturelle de tous depuis le VIIIe siècle, sans laisser tomber les autres idiomes linguistiques. « Il revient donc à la langue arabe de devenir le véhicule privilégié de la foi et de la culture pour tous, sans refuser les apports des langues locales ou interrégionales pratiquées par telle ou telle fraction de la population[15]. »
Si pour Moubarac, en opposition à la conception que se fait l’orientalisme de la langue arabe, l’arabité est un facteur culturel et politique déterminant pour l’évolution saine de la région, Jean Corbon l’aborde selon une perspective œcuménique en la concevant comme le signe du renouveau des Églises et le motif de leur recherche de l’unité. En devenant l’Église des Arabes, les Églises antiochiennes relèvent le défi de leur rôle et de leur témoignage au Moyen-Orient, car elles ne seraient plus les Églises d’un passé prestigieux, mais celles d’un présent au sein duquel elles sont appelées à la plus grande implication. Les chrétiens jouèrent un rôle déterminant durant la Nahda (Renaissance arabe)[16], surtout pour la modernisation de la langue arabe, ce qui créa des liens étroits entre les chrétiens et l’arabité. Ainsi, « la Nahda préparait l’Église de demain : l’Église des Arabes »[17]. Que le chrétien soit d’origine culturelle syriaque ou byzantine, il est, comme le musulman, « arabe dans la complexité de ses structures et de ses valeurs »[18].
Enfin, Khodr souligne l’importance de l’arabité qui, « sans préjuger d’une solution politique, d’une forme étatique quelconque […] [est] une aire culturelle et géographique, un mouvement de rénovation auquel sont invités dans la diversité, tous les hommes qui vivent dans ce cadre, fussent-ils arabes ou non »[19]. L’arabité est une synthèse de plusieurs époques, cultures, traditions, ethnies et religions, dont la Nahda a montré l’universalité et la diversité[20].
Mais si l’islam donne à l’arabité son impulsion première, l’élément chrétien est très important pour celui-ci puisqu’il lui apporte beaucoup de richesses. Celles-ci ne concernent pas seulement les propres héritages des chrétiens ramenés à l’arabité, mais surtout leur contribution centrale pour la création du mouvement arabe moderne. Les chrétiens ont sorti l’arabité moderne de la sphère purement religieuse à la sphère politique et culturelle, et ont permis de faire la distinction entre l’islam et l’arabité. Khodr pense essentiellement à tout le mouvement de la Nahda arabe qui a montré l’universalité de l’arabité et ses aspects de diversité.
Une diabolisation de l’Arabe et de l’islam
Said décrit sans ambiguïté une vision occidentale diabolisant de l’Arabe et de l’islam. « Le cinéma et la télévision associent l’Arabe soit à la débauche, soit à une malhonnêteté sanguinaire »[21], et « l’islam en est venu à symboliser la terreur, la dévastation, le démoniaque des hordes des barbares détestés. Pour l’Europe, l’islam a été un traumatisme durable. Jusqu’à la fin du dix-septième siècle, il y a eu un ‘‘péril ottoman’’ latent dans toutes l’Europe, représentant un danger constant pour la civilisation chrétienne »[22]. Et Said d’évoquer des caricatures bien communes : « On imagine les Arabes, par exemple, comme montés sur des chameaux, terroristes, comme des débouchés au nez crochu et vénaux dont la richesse imméritée est un affront pour la vraie civilisation[23]. »
Par son insistance sur l’arabité, la théologie contextuelle libanaise rejette de facto toute diabolisation de l’Arabe et s’oppose de même à toute diabolisation de l’islam. Mieux, elle le réhabilite dans l’histoire du salut à travers différentes réflexions théologiques qui appartiennent à deux logiques, l’un relevant d’une théologie inclusive, et l’autre d’une théologie pluraliste.
Le théologien maronite Michel Hayek et Georges Khodr réhabilitent l’islam dans le cadre d’une théologie inclusive. Le premier le réhabilite dans le cadre dans le l’histoire du salut, à travers la figure d’Ismaël. Celui-ci, même dans le désert, reste l’héritier de son père, Abraham. Ainsi, les musulmans que Hayek identifie comme les descendants d’Ismaël font partie de l’histoire du salut. Cependant, leur destinée n’aboutira à son fait que lorsqu’ils rencontreront le Christ, sortie de leur désert. Quant à Khodr, il réhabilite l’islam à partir de la théologie des semences du Verbe de Justin. Celles-ci sont présentes dans toute la création et l’islam ne leur échappe pas. C’est dans cette pespective que Khodr considère que l’islam participe à la vérité de Dieu. Néanmoins, cette participation ne s’effectue que dans la mesure où cette vérité révèle le Christ, puisque Khodr cherche dans l’islam le Christ qui sommeille.
Youakim Moubarac et le philosophe Mouchir Aoun réhabilitent l’islam dans le cadre d’une théologie pluraliste. Moubarac considère l’islam comme un monothéisme authentique, sans pour autant considérer qu’il lui manque quelque chose pour aboutir à sa plénitude. Quant à Mouchir Aoun, il inscrit l’islam dans le cadre d’un dialogue interreligieux qui ne considère aucune religion comme supérieure à l’autre, puisque toutes sont comprises à partir d’une théologie pluraliste qui reconnaît l’authenticité de l’expérience spirituelle de chaque religion.
La cause palestinienne
Enfin, relevons un trait saillant de critique de Said, un élément auquel il est bien sensible, eu égard à ses origines : le sionisme et la Palestine. Said souligne la manière dont la cause palestinienne permit de détériorer l’image de l’Arabe en faveur d’Israël : « Après la guerre de 1973, les Arabes ont partout paru plus menaçants. […] L’animosité antisémite populaire est passée en douceur du juif à l’Arabe, puisque l’image est presque la même. […] On le voit comme l’élément perturbateur de l’existence d’Israël et de l’Occident, ou, sous un autre aspect de la même chose, comme un obstacle, qui a pu être surmonté, à la création de l’État d’Israël en 1948[24]. » Et Said de poursuivre son diagnostique en considérant que même en militant pour sa cause, le Palestinien est déconsidéré : « Dans sa résistance aux colonialistes étrangers, le Palestinien arabe est, ou bien un sauvage stupide, ou bien une quantité négligeable, du point de vue moral et même du point de vue existentiel[25]. »
La théologie contextuelle libanaise s’inscrit dans une opposition radicale à une telle vision, et se constitue en défenseur de la cause palestinienne, de manière à dénoncer les lectures occidentales et de s’opposer d’une manière claire au « sionisme ».
Moubarac, fervent héraut de la Palestine en Occident, estimait que le problème palestinien est central au Moyen-Orient. Il qualifiait même le Liban qu’il disait « malade de la Palestine », comme l’arme principale dans le combat du « sionisme », à travers « la concorde de toutes les croyances qui le composent, cet idéal pluraliste de l’arabité tendanciellement non violente »[26]. Par ailleurs, il insistait sur la différence entre les juifs et les sionistes en considérant le sionisme comme nuisible à la théologie et à la pensée juive : « Le sionisme qui a assassiné l’Espérance d’Israël assassine notre propre Espérance, celle d’une réconciliation judéo-arabe en Palestine, comme vous savez[27]. » Les sionistes commettent des injustices à l’égard des Palestiniens au nom d’une lecture théocratique de la Bible. De plus, ce mode d’action et de pensée exclut autrui et fonde une pensée monolithique qui rejette la diversité.
Quant à Khodr, il fut pendant plusieurs décennies l’un des farouches défenseurs de la cause palestinienne au Liban, notamment à travers un grand nombre d’articles. À des milliers d’années lumières des thèses que prête Said à l’orientalisme, Khodr considère d’abord que la cause palestinienne est essentiellement une question morale. Le chrétien ne peut pas se taire face aux atrocités qui ont lieu en Palestine, blessure au sein du monde arabe qui se trouve mis à l’épreuve, « parce que la résolution juste de ce problème est une épreuve pour la sincérité des Arabes »[28]. Enfin, le Libanais Khodr prend des positions extrêmes que l’Américo-Palestien Said n’aurait probablement pas pu prendre sans se compromettre sérieusement, puisqu’il rejette l’idée même de l’État israélien en considérant Israël comme « conçu dans le mal, et né dans le péché »[29] ; ses agissements sont injustes. Par ailleurs, il s’oppose farouchement à ce qu’il qualifie de « philosophie sioniste », au nom de ces principes d’arabité, en considérant que l’Israélien ne veut pas une égalité citoyenne avec l’Arabe : « Notre guerre avec le sionisme est une guerre contre un complexe de supériorité, de colonisation et d’expansion[30]. » Cette guerre ne touchera à sa fin que lorsque la ségrégation opérée par Israël entre juifs et Arabes finira. C’est à cet égard que Khodr parle de l’importance du modèle libanais de convivialité entre les religions. Le pays du Cèdre est une image de la vie arabe unifiée. Il faut donner cet exemple aux Israéliens et refuser de normaliser les relations avec eux s’ils n’acceptent pas une convivialité similaire entre les religions[31].
Conclusion
La lecture Saidienne de l’orientalisme fut sujette à maintes critiques. Néanmoins, force est de constater que la réflexion de Said n’est pas isolée, et qu’elle est porteuse de bien des éléments de convergence, toujours d’actualité, au sein de la pensée chrétienne contextuelle arabe, dans sa version libanaise. Celle-ci rejette, à partir d’une réflexion théologique, des modes pensée qu’elle considère erronées, et qui touchent à l’islam, à l’arabité, à la Palestine et au rapport avec l’Occident. Cependant, force est de souligner que pour cette pensée chrétienne contextuelle, l’Occident n’est pas toujours abordé sous cet angle, puisqu’il est considéré aussi, comme porteur de beaucoup d’éléments positifs qui ont participé et qui participent toujours à l’épanouissement de bien des communautés chrétiennes au Proche-Orient arabe.
[1] Pour une étude détaillée des pensées de ces théologiens consulter : Antoine Fleyfel, La théologie contextuelle arabe, modèle libanais, L’Harmattan, Paris, 2011.
[2] Edward Said, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2005, p. 14.
[9] Georges Khodr, « Autour de l’unité chrétienne » (حول الوحدة المسيحيّة), in An-Nahar, 25 avril 1998.
[10] Cf. Jean Corbon, L’Église des Arabes, Paris, Cerf, 1977.
[11] Edward Said, op. cit.., p. 345.
[12] Pour plus d’informations sur la notion d’arabisme, se référer à Mahmoud Kamel, L’Arabisme, Le Caire, L’Organisation Égyptienne Générale du Livre, 1977.
[13] Youakim Moubarac, Les Chrétiens et le monde arabe, Pentalogie Islamo-Chrétienne, Tome IV, Beyrouth, Édition du Cénacle Libanais, 1972, p. 242.
[16] Georges Corm rappelle que le mouvement de la Nahda était un effort commun des chrétiens et des musulmans : « La Nahda a présenté deux caractéristiques remarquables : une participation active des chrétiens, qui réaffirmèrent ainsi leur appartenance pleine et entière à la civilisation arabo-islamique contemporaine ; et l’émergence d’un courant réformiste religieux chez les musulmans qui vise à rénover la jurisprudence islamique, figée et rigoriste, pour l’adapter aux exigences de la modernité » (Georges Corm, Le Liban contemporain, histoire et société, Paris, La Découverte, 2005, p. 150).
[17] Jean Corbon, op. cit., p. 44.
[19] Georges Khodr, « L’arabité », in Youakim Moubarac, Palestine et arabité, Pentalogie islamo-chrétienne, Tome V, Beyrouth, éditions du Cénacle Libanais, 1972-1973, p. 186.
[20] C’est à cet égard que Khodr considère le Liban comme un exemple vivant de la diversité dans l’arabité : « Le Liban, malgré sa petite taille […] est une image de la vie arabe unifiée » (Georges Khodr, « Les arabes » (العرب), in An-Nahar, 30 mars 2002).
[21] Edward Said, op. cit.., p. 320.
[26] Youakim Moubarac, Palestine et arabité, Pentalogie islamo-chrétienne, Tome V, Beyrouth, éditions du Cénacle libanais, 1972-1973, p. 138.
[27] Youakim Moubarac, « Lettre à François Mauriac », 20 juin 1967, in Georges Corm, Youakim Moubarac, un homme d’exception, op. cit., p. 294.
[28] Georges Khodr, « Les Arabes » (العرب), in An-Nahar, 30 mars 2002.
[30] Georges Khodr, « L’homme venant de la Palestine » (الإنسان الطالع من فلسطين), in An-Nahar, 20 avril 2002.
Paru dans Actes du colloque international organisé par le Centre d’études et d’interprétation du fait erligieux de la faculté des sciences religieuses à l’université Saint Joseph, Beyrouth, février 2014, p. 11-21.

Comment articuler l’universalité et la particularité des religions ? D’autant que cette question se heurte presque toujours à des prétentions absolutistes, à des théologies exclusives ou inclusives. Dans tous ces cas de figure, le rapport entre le particulier et l’universel reste très problématique, puisque captif de lectures qui se saisissent d’une compréhension de la vérité divine, considérée comme la meilleure, voire la seule adéquate, et excluent ou tolèrent d’autres versions qui ne s’inscriraient que dans l’erreur ou dans l’incomplétude.
Dût cette investigation s’appuyer sur des éléments théologiques, elle est de nature philosophique. Il est effectivement question d’investir ce sujet à partir des pistes philosophiques proposées par John Hick qui, à partir de ses réflexions sur le pluralisme théologique, donne une réponse sérieuse à notre problématique. Mais avant de se verser sur sa réponse, il est de bon ton d’aborder brièvement sa biographie, pour ce qu’elle apporte d’éclairage à notre examen de sa réflexion.
Éléments biographiques[1]
John Hick (1922-2012) est un philosophe et théologien anglais qui enseigna longtemps aux États-Unis dans les domaines de la philosophie de la religion et de la théologie. Sa contribution au sujet du pluralisme théologique est majeure.
Sa pensée s’ancre indubitablement dans un cheminement personnel. Avant d’avoir 20 ans, il se convertit à l’évangélisme dans sa version stricte, et s’inscrivit à l’Université d’Edinburgh pour étudier la philosophie. À cette époque, la philosophie de Kant lui fut d’un attrait qui commença à mettre en question son fondamentalisme religieux. Longtemps membre de l’Église réformée unie en Grande-Bretagne (United Reformed Church), il dut faire face à un procès l’accusant d’hérésie entre 1961 et 1962. Cela concernait la confession de Westminster[2] ; Refusant d’admettre la naissance virginale de Jésus, Hick considérait que la question était ouverte à toute interprétation, et qu’il était agnostique à cet égard.
Le philosophe racontait son expérience de l’immigration en Grande-Bretagne dans les années 1950-1960. Elle le poussa à se poser la question du pluralisme théologique, puisque la grande diversité religieuse qui en découlait ne pouvait pas le laisser indifférent. Sa rencontre avec des réalités nouvelles représentées par des musulmans, des sikhs, des Hindous ou des pentecôtistes le poussait à réévaluer son positionnement théologique et spirituel. En fréquentant des mosquées, des synagogues, des temples et des pagodes, Hick constatait qu’il s’y passait la même chose que dans une église, c’est-à-dire qu’il s’y trouvait « des êtres humains ouvrant leurs esprits à une réalité divine qui les dépasse, reconnue comme personnelle et bonne, et exigeant une droiture et un amour entre les hommes. J’ai pu constater, [dit-il], que la foi sikh, par exemple, est pour le sikh dévoué, ce que la foi chrétienne est pour le chrétien sincère ; mais aussi que chaque foi est, très naturellement, perçue par ceux qui y adhèrent, comme unique et absolue »[3]. C’est ainsi qu’il considéra que l’une de ses vocations consistait à « œuvrer pour la nouvelle pratique de la théologie des religions […]. Il me semblait, [dit-il], que cela engageait une franche reconnaissance qu’il existait une pluralité de révélations divines et de contextes de salut »[4].
Cette pensée reçut maintes critiques, dont celle Joseph Ratzinger, alors préfet de la congrégation pour la Doctrine de la foi. Celui-ci considérait que des théologiens catholiques accusés de relativisme comme Jacques Dupuis, Peter Phan ou Roger Haight, étaient philosophiquement inspirés par lui. Dominus Iesus fut par ailleurs considérée comme une condamnation de la pensée de Hick. Trois ans avant sa mort, en 2009, Hick rejoignit la Société religieuse des Amis (Quakers), ce qui était en adéquation avec sa réflexion et qui révélait les grandes tensions qu’il vécut au sein de son Église.
Pratiques théologiques
Hick considère qu’il existe deux pratiques majeures de la théologie : il dénomme la première « théologie dogmatique » (dogmatic theology) et la seconde « théologie critique » (problematic theology). C’est ainsi qu’il les définit : « Alors que la pratique dogmatique de la théologie assume que ses positionnements de base représentent la vérité finale, la pratique critique de la théologie considère ses conclusions comme des hypothèses, sujettes à révision et toujours en quête d’un discours plus adéquat[5]. » Les deux restent nécessaires à son sens, mais lui s’inscrit franchement dans le sillage de la seconde, tout en reconnaissant adhérer jadis pleinement à la première qu’il disait toujours respecter. Ce sont les a priori de la théologie critique qui servent de fondement à son questionnement philosophique autour de la diversité religieuse, fondés sur une lecture pluridisciplinaire s’appuyant essentiellement sur l’histoire, l’exégèse, l’anthropologie ou la sociologie.
Cela étant, le philosophe considère que la vision traditionnelle qu’a le christianisme des autres religions fut forgée à une période d’ignorance de l’autre et de la vie religieuse de l’humanité. À cet égard, le christianisme n’a rien d’exclusif puisque cette pratique est partagée par toutes les religions. Et Hick de poursuivre sa réflexion en pensant qu’il est évident que sa religion soit une parmi plusieurs : « Nous étions comme un groupe de personnes qui descendait une longue vallée, chantant nos propres chants, développant au cours des siècles nos propres histoires et slogans, sans être conscients que derrière la colline, il y a une autre vallée, avec un autre excellent groupe de gens avançant dans la même direction, mais avec leurs propres langages et chants et histoires et idées[6]. »
Cependant, il constate que la religion chrétienne traverse, à ce sujet, trois phases de développement : commençant par un rejet total, traversant une sotériologie inclusive et finissant par une reconnaissance de la valeur intrinsèque des religions.
Pour illustrer la première phase, Hick cite deux extraits historiques. Le premier du concile de Florence (1439-1441) : « Toute personne restant en dehors de l’Église catholique, non seulement les païens, mais aussi les juifs, les hérétiques ou les schismatiques, ne peut prendre part à la vie éternelle ; Mais ils iront au feu éternel qui a été préparé au diable et à ses anges, sauf s’ils rejoignent l’Église à la fin de leur vie ». Et le second du message du « Congress on World Mission at Chicago » (1960) : « Depuis la guerre, plus d’un milliard d’esprit sont passés dans l’éternité, et plus de la moitié de ceux-là est allée au tourment du feu de l’enfer, sans entendre parler de Jésus Christ, de qui il était, ou de pourquoi il est mort sur la Croix du calvaire[7]. » Enfin, il considère la doctrine excluant le salut en dehors de l’Église ou du christianisme n’est plus acceptée à la lumière de connaissance actuelle de l’autre.
Pour illustrer la deuxième phase, Hick parle d’une acceptation d’un salut des autres mais seulement à travers la religion chrétienne. À ce sujet, il cite la théorie du chrétien anonyme de Rahner qu’il rejette. Considérer que la grâce divine touche les autres mondes de foi à travers le christianisme, c’est-à-dire à travers la personne et la croix du Christ, correspond pour Hick à dire que la lumière du soleil ne peut atteindre les autres planètes que si elle est reflétée en premier lieu par la terre[8].
Pour illustrer la troisième phase, le philosophe évoque la reconnaissance de la valeur salvifique contenue chez les autres. La suite de ce travail s’étendra sur la réflexion de Hick à ce sujet.
Notons que ces trois phases évoquées correspondent aux trois manières de concevoir la théologie du dialogue, c’est-à-dire à partir de l’exclusive, l’inclusivisme et le pluralisme.
La révolution copernicienne de Hick
Hick parle de sa proposition comme d’une révolution copernicienne qui consiste en un passage paradigmatique d’un christianisme centré autour de Jésus (Jesus centered), à une vision qui centrée sur Dieu, fondement de toute sorte de foi religieuse[9]. Cette révolution est supposée avoir des conséquences de taille sur le dogme chrétien au sein duquel il faudra passer d’un christocentrisme à un théocentrisme. Ainsi c’est Dieu qui sera le centre et l’objet de l’adoration de toutes les religions, y compris le christianisme : « Nous devons réaliser que l’univers de la foi est centré autour de Dieu, et non autour du christianisme ou autour d’une autre religion. Il est le soleil, la source originaire de la lumière et de la vie, celui que toutes les religions reflètent à partir de leurs propres manières[10]. »
Ce nouveau paradigme a des implications considérables en christologie. En considérant Jésus comme littéralement le Dieu incarné, la deuxième hypostase de la Trinité, il est impossible de dépasser une vision traditionnelle invitant toute l’humanité à la foi chrétienne. La solution à ce problème consiste ainsi à considérer les notions de l’incarnation et de la divinité du Christ comme métaphoriques, mythiques, comme des expressions poétiques de la dévotion chrétienne au Seigneur, expressions appartenant au langage imaginaire des anciennes cultures[11]. La tradition chrétienne a transformé cette poésie en prose, et par conséquent, le métaphorique Fils de Dieu devint un Fils de Dieu métaphysique, la deuxième hypostase de la Trinité. Néanmoins, en tant que métaphore, le discours sur l’incarnation fournit une manière familière pour exprimer le fait d’être disciple de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Cela permet aussi de dire que « Jésus est notre contact vivant avec le Dieu transcendant »[12].
Concernant la personne du Christ, Hick adopte des résultats exégétiques faisant une distinction, voire une séparation entre le Jésus de l’histoire et celui du dogme. Ainsi il considère que le Jésus pré-pascal ne s’est pas proclamé comme Messie ou Fils de Dieu, ni n’a accepté qu’on le désignât comme tel. Le Jésus historique n’a jamais enseigné qu’il est Dieu. L’idée de l’incarnation n’est que métaphorique et mythique.
En comprenant l’incarnation sous cet angle, Jésus ne sera plus considéré comme le seul moyen d’accès à Dieu. Il pourra être révéré comme celui à travers qui le salut est communiqué, sans devoir nier les autres chemins se déclarant comme une voie de salut. Cela permet de préserver la foi chrétienne sans dévaloriser les autres formes de foi ou les reléguer à un rang inférieur : « Nous pouvons dire qu’il y a salut en Christ sans dire qu’il n’y a pas de salut en dehors du Christ. »
Quelles assises philosophiques à ce pluralisme ?
De prime abord, Hick constate que quelle que soit notre appartenance religieuse, chrétienne, musulmane ou autre, elle dépend presque toujours du monde dans lequel nous sommes nés : « D’un point de vue réaliste, l’engagement religieux de chacun est normalement une question de ‘‘religiosité ethnique’’ plutôt que d’un jugement comparatif délibéré et d’un choix[13]. » Effectivement, « nous avons été formé depuis notre enfance dans notre tradition, absorbant ses valeurs et ses présupposés. Cela est devenu une partie de nous comme notre nationalité, notre langage et notre culture ; les traditions religieuses étrangères peuvent paraître comme étranges, comiques ou bizarres comme un nom étranger, des coutumes ou une nourriture peuvent l’être »[14]. Ainsi, il existe un conditionnement historique des religions : « Dans chaque cas, les expériences de révélation et les traditions religieuses qu’elles ont crées furent conditionnées par l’histoire, la culture, le langage, le climat, et certainement toutes les circonstances concrètes de la vie humaine, dans un espace-temps particulier. Et même si la forme culturelle et philosophique de la révélation du divin était caractéristiquement différente dans chaque cas, nous pouvons croire que le Seul Esprit œuvrait partout, agissant dans l’esprit humain[15]. »
Mais pourquoi cette différence de la perception du divin existe-t-elle ? Pourquoi celui-ci ne se révèle-t-il pas d’une manière similaire partout ? Pour répondre à cette question, Hick s’appuie, entre autres, sur l’adage de Thomas d’Aquin : « Tout ce qui est perçu est perçu selon le mode de celui qui perçoit[16]. » Ainsi, « l’idée générale de la divinité a été concrétisée dans l’expérience juive par l’image de Yahvé comme un être personnel qui existe en interaction avec le peuple juif. Il est une partie de leur histoire et ils sont une partie de la sienne. Mais Yahvé est différent, par exemple, de Krishna, qui est une personnification hindou particulière de l’Éternel, en relation à la communauté Vaishnavite de l’Inde »[17].
Pour inclure toute les religions dans sa réflexion, Hick a recours à des concepts où les différentes expériences du divin peuvent être contenues. Ainsi utilise-t-il, selon ses articles, différents termes pour décrire l’objet des religions : « l’Un Éternel » (Eternal One), ou « Réalité ultime » (Ultimate Reality), voire le « Vrai » (the Real).
L’Un Éternel a toujours cherché à communiquer avec l’esprit humain, cherchant à se faire connaître. Par conséquent, la révélation est forcément plurielle puisqu’elle a lieu dans différents endroits de la culture humaine. Dans le monde sémitique et patriarcal, on pensa Dieu en terme masculin en tant que Dieu le Père. Dans le monde indien, pour des raisons culturelles, Dieu fut pensé comme Mère. Dans tous les cas qu’il cite, il considère qu’il y a une perception authentique du divin, « mais la forme concrète qu’il prend dépend des facteurs culturels »[18]. Ceux-ci peuvent être catégorisés dans deux manières de concevoir l’Un Éternel : la première à partir du concept de la déité, c’est-à-dire l’Un Éternel en tant que personnel (modèle théiste), et la seconde à partir du concept de l’absolu, ou l’Un Éternel comme non personnel (religions non théistes). C’est à ce moment de sa réflexion qu’intervient Kant.
Hick veut faire la différente entre l’Un Éternel en soi, en tant qu’existant en soi, au-delà de toute relation à la création, et l’Un Éternel en relation à l’humanité et tel qu’il a été perçu et connu à partir des différentes cultures et situations humaines. Ainsi, il considère l’Un Éternel comme un noumène ou le Dieu nouménal : celui-ci ne peut pas être connu. Hick trouve dans les religions des enseignements allant dans ce sens. Dans le christianisme, Maître Eckhart distingue entre la déité et Dieu. Dans le taoïsme, le Tao qui peut être exprimé n’est pas le Tao éternel. Dans la cabale juive, il existe une distinction entre En Soph, la réalité divine absolue qui est au-delà de toute description humaine et le Dieu de la Bible. Chez les Soufis, il existe une distinction entre Al Haqq et Allah. Dans l’hindouisme, il s’agit de la distinction entre nirguna Brahman, l’ultime en soi, au-delà de toutes catégorie, et suguna Brahman, l’Ultime en tant que connu comme divinité personnelle, Isvara. Dans le bouddhisme Mahayana, c’est la distinction entre le dharmakaya, l’éternel cosmique Bouddha-nature, qui est aussi le vide infini (sunyata), et la réalité des figures divines du Bouddha (sambhogakaya) et leurs incarnations dans les Bouddha terrestres, (nirmanakaya)[19]. In fine, le Dieu connu par les humains n’est pas Dieu en soi, an sich, mais le Dieu en relation.
Quant au Dieu phénoménal, il est la perception qu’on a du Dieu nouménale à partir d’une culture et d’une histoire. Ainsi, Dieu peut être nommé Yahvé, Adonaï, Allah, le Père de Jésus, Krishna, Shiva, et bien d’autres noms. Cette perception particulière de l’Un Éternel s’inscrit dans un système religieux qui a ses dogmes, ses rites, sa liturgie, son éthique, etc. Mais cela reste phénoménal, puisque « nous n’avons pas conscience de la réalité divine telle qu’elle est en soi, mais seulement comme expérimentée de nos différents points de vue humains »[20]. « Nous sommes tous des peuples élus, mais choisis de différentes manières et pour des vocations différentes[21]. » Shiva et Yahvé ne sont pas des Dieux rivaux, mais des expressions différentes du divin. Donc toutes les religions adorent la même réalité divine, mais chacune à sa manière.
Hick admet que Kant n’aurait pas été d’accord avec cette manière d’utiliser sa théorie, d’autant plus qu’il traite la question de la religion d’une manière différente, à partir de la raison pratique. Il reconnaît que « Kant lui-même n’aurait pas accepté l’idée que nous pouvons, d’une quelconque manière, faire l’expérience de Dieu, même en tant que phénomène divin en distinction d’un noumène divin »[22]. Dieu est dans la morale pour Kant. Néanmoins Hick s’aventure dans cette interprétation de la philosophie de Kant, interprétation qu’il considère utile pour le pluralisme théologique.
Y a-t-il une meilleure religion ?
Considérer que chaque religion a son expérience propre de Dieu, et qu’elles participent toutes à la vérité pousse à la question qui consiste à savoir s’il en existe une qui est meilleure que l’autre. John Hick répond à cette question à partir de plusieurs propositions :
1- Dans l’histoire de toutes les religions, il y a du bon et du mauvais. Dans le christianisme par exemple, il y a François d’Assise et mère Teresa mais la haine exprimée à l’endroit des juifs pendant de longs siècles. Chaque tradition doit distinguer entre ce qui est bien ou moins bien dans son histoire.
2- C’est à partir de quatre grandes traditions religieuses que Hick poursuit sa réflexion autour de cette question : le christianisme, l’islam, l’hindouisme et le bouddhisme. Chacune de ces religions parle à sa manière du caractère mauvais de l’existence humaine présente. Il s’agit d’une vie de déchéance, vécue en aliénation vis-à-vis de Dieu, ou prisonnière de l’illusion du Maya, ou envahie par le dukkha. Mais ces religions proclament aussi, s’appuyant sur leurs bonnes nouvelles, que l’Ultime, le Vrai, le Véritable, sans lequel notre vie est hors de ses gonds, est la réponse à l’homme.
3- Si chaque chrétien et musulman, chaque hindou et bouddhiste, incarnent pleinement leurs idéaux respectifs, ils vivront dans l’acceptation et l’amour des autres humains : « Un monde qui pratique les idéaux éthiques communs de ces traditions réalisera la fraternité humaine sur terre[23]. » Seulement, cela fut accompli par si peu de gens. L’histoire des sociétés dérivées de ces traditions religieuse regorge de violence, de guerre, d’oppression, d’exploitation, d’esclavage, de malhonnêteté, de cruauté, d’une recherche de pouvoir…
4- Chaque religion a ses vices et ses vertus. Il est possible de considérer qu’un phénomène religieux est meilleur en l’inscrivant dans un espace-temps bien précis, mais il est impossible de dire quelle religion, dans sa totalité est meilleure. « Une grande tradition peut constituer dans certaines périodes de son histoire, et dans certaines régions du monde, et dans certaines de ses branches ou sectes, un meilleur contexte de salut/libération que les autres. Ainsi, il serait de meilleur augure de naître dans une religion bien déterminée durant une période bien précise de l’histoire que dans une autre[24]… »
Conclusion
La réflexion de Hick propose une lecture philosophico-théologique qui considère que la relativité de toute religion qui dépend de sa manière de percevoir Dieu, ne constitue guère une enfreinte à son authenticité. Car chacune a de Dieu une expérience authentique qu’elle effectue à sa manière. La diversité des religions n’est guère un problème dans la logique de Hick, au contraire, elle est nécessaire et ancrée dans la diversité humaine et culturelle. Mis à part l’exclusion de toute théologie prétendant à l’absoluité d’une religion, à quoi mènerait une telle réflexion ?
De prime abord, à la reconnaissance de l’autre dans sa différence religieuse. Il est possible d’appartenir à une autre religion et d’être complètement authentique dans sa foi. La particularité ne déforme pas l’universel, au contraire, elle révèle sa richesse.
Mais aussi, à un œcuménisme mondial, croit Hick, où l’engagement spirituel et la fraternité seraient primordiaux, et les différences des traditions religieuses moins significatives. La relation entre elles pourraient se constituer à l’image des relations tissées entre les différentes dénominations chrétiennes, c’est à dire de plus en plus amicales. Celles-ci se rendent visite librement durant leur culte et commencent même à se partager les mêmes édifices. Pour certaines, il existe même des échanges de ministres[25].
Hick considère que le christianisme a subi durant son histoire d’énormes changements, et que son avenir réside dans ce qu’il deviendra grâce aux interactions et influences mutuelles qu’il aura avec le bouddhisme, l’hindouisme et l’islam. Car si chaque religion reste attachée à sa vision comme étant la seule véritable, aucun dialogue en profondeur ne sera possible, mais uniquement des exposés et des comparaisons de systèmes incompatibles.
Enfin, Hick inscrit son système dans une vision qui englobe toute l’humanité, puisqu’il incite au partage des expériences différentes du divin à travers le dialogue interreligieux et les interactions entre les communautés religieuses. Cela ne se fonde pas sur les conversions (même si elles ne seraient jamais exclues), mais sur l’enrichissement mutuel et la coopération pour faire face au problème urgent de la survie humaine dans un monde et une société justes.
Il n’y a pas de doute que la réflexion de Hick peut être critiqué à plus d’un égard, notamment dans son utilisation de la philosophie de Kant (ce qu’il admit) et dans sa relativisation des religion, bien provocante pour bien des sensibilités. Mais il n’y a pas de doute qu’il pose l’une des questions les plus fondamentales en théologie et en philosophie, celle de l’autre, de son authenticité et de la légitimité naturelle de sa différence.
Antoine Fleyfel
Université catholique de Lille
II = John Hick, Problems of religious pluralism, Macmillan, London, 1994
I = John Hick, God has many names, Westminster Press, Philadelphie, 1982
[1] Il est à noter que Hick rédigea une autobiographie dont l’une des raisons était d’expliquer son cheminement intellectuel : John Hick, An autobiography, Oneworld, Oxford, 2005.
[2] La confession de foi de Westminster est une confession de foi calviniste. Établie par l’assemblée de Westminster en 1646 et largement approuvée par l’Église d’Angleterre, elle est le fondement doctrinal de l’Église d’Écosse et exerce une influence prépondérante sur les Églises presbytériennes à travers le monde.
[3] John Hick, God has many names, Westminster Press, Philadelphie, 1982, p. 18.
[4] John Hick, Problems of religious pluralism, Macmillan, London, 1994, p. 11.
[5] Ibid., p. 13.
[6] John Hick, God has many names, op. cit., p. 41.
[7] Cité in John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 51.
[8] Cf., Ibid., p. 53.
[9] Cf., John Hick, God has many names, op. cit., p. 18.
[10] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 71.
[11] Cf., John Hick, God has many names, op. cit., p. 19.
[12] Ibid., p. 74.
[13] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 47.
[14] Ibid., p. 50.
[15] John Hick, God has many names, op. cit., p. 72.
[16] Summa theologica, II/II, Q. 1, art. 2
[17] John Hick, God has many names, op. cit., p. 25.
[18] Ibid., p. 52.
[19] Cf., John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 40.
[20] John Hick, God has many names, op. cit., p. 67.
[21] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 57.
[22] John Hick, God has many names, op. cit., p. 104.
[23] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 83.
[24] Ibid., p. 87.
[25] Cf., Ibid., p. 77.
Laïcités et revendications citoyennes des chrétiens d’Orient.
Le cas libanais.
Antoine Fleyfel, Perspectives & Réflexions, 2013, p.41-52
Publication de L’Œuvre d’Orient
Introduction
Les événements qui bouleversent le monde arabe depuis 2011, ainsi que la tournure islamique que prennent lesdits « printemps arabes » soulignent la nécessité de poser encore une fois la question de la citoyenneté. Garante des droits de tous, abstraction faite de toute appartenance communautaire, celle-ci constitue l’une des revendications majeures des chrétiens d’Orient de divers contextes géopolitiques proche-orientaux. La citoyenneté, liée à l’idée d’un État laïc ou civil, est pour les chrétiens d’Orient l’alternative par excellence d’un État dont la Constitution serait déterminée par une loi religieuse ou confessionnelle. Les communautés chrétiennes du monde arabe ainsi que le Saint-Siège le rappellent d’une manière particulière ces derniers temps, notamment à travers le Synode des Évêques pour le Moyen-Orient (2010).
Néanmoins, cette question n’est pas nouvelle, mais redondante dans l’histoire des chrétiens d’Orient au XXe siècle et même avant. Elle constitue pour eux l’un des plus grands défis relatifs à leur présence, leur témoignage, leur épanouissement et leur avenir. Nombre de théologiens et philosophes chrétiens libanais l’ont pensée de manière très sérieuse, afin de proposer des solutions séantes. Cet article voudrait rendre compte de ces pensées qui, plusieurs décennies avant les révoltes arabes, posaient déjà des questions qui sont actuellement au centre de la problématique géopolitique des chrétiens du monde arabe.
La tendance laïque dans la pensée religieuse chrétienne au Liban
Il existe une tendance claire en faveur de la laïcité dans la pensée religieuse chrétienne au Liban. Cette tendance est fortement diverse et varie d’une timide revendication à une franche demande de l’application d’un régime laïc qui remplacerait le régime confessionnel actuel. Les éléments constitutifs de cette tendance prennent source dans les données fondamentales de la foi chrétienne, et s’élaborent d’une manière contextuelle, à la lumière de la recherche d’une saine convivialité avec les musulmans, et en opposition au confessionnalisme. Par ailleurs, cette tendance répond à deux genres de logique : la première voulant laïciser davantage un régime confessionnel qu’il faut libérer du confessionnalisme, et la seconde voulant remplacer ce régime par un autre laïc. Cependant, avant d’étudier ces deux questions, évoquons pour plus de clarté certains enjeux de la diversité musulmane libanaise, et rappelons les racines proches de la problématique.
Diversité et tensions au sein des communautés musulmanes libanaises
Mise à part certaines lectures médiatiques, rapides ou superficielle, ainsi que des discours de propagande, il est tout à fait inadéquat de concevoir l’islam comme un bloc politique, religieux ou social homogène. Au contraire, celui-là est divers à bien des égards, ce qui est vérifiable à l’endroit de la réflexion autour de la laïcité. Contrairement à beaucoup de préjugés, cette dernière ne se développe pas forcément au sein du monde arabe dans un cadre homogène hostile ou réticent, mais au sein de sociétés constituées d’un grand nombre d’enjeux, de tensions et de contradictions. Tel est le cas du Liban où l’islam, légèrement majoritaire (60%) mais paritaire en principe avec les chrétiens dans la gouvernance, ne constitue absolument pas une unité politique, sociale, religieuse ou idéologique. Force même est de constater que son attitude à l’égard de la laïcité regorge d’évolutions, de changements de bords ou de prises de positions politiques opportunistes effectuées à la lumières des intérêts d’un tel parti ou d’une telle confession. Ainsi, la communauté chiite que d’aucuns pourraient imaginer distante de la laïcité, connut nombre de penseurs qui militèrent en sa faveur dans les années 1970 et 1980, notamment dans le cadre du Parti communiste libanais. Le cas le plus symptomatique est celui du philosophe Mahdi ‘Amel (1936-1987). En outre, il n’est pas rare d’entendre le chef du parti chiite Amal, Nabih Berri, président du Parlement depuis 1992, revendiquer l’application de la laïcité au Liban à travers l’abrogation du confessionnalisme politique comme le stipulent les accords de Taëf (1989). Par contre, la tendance laïque est beaucoup plus timide dans la communauté sunnite, mais est présente et fut même prônée par des religieux, tel Abdullah Al-Alaïli (1914-1996). Quant à la communauté druze, elle trouva à travers l’un de ses représentants historiques, Kamal Joumblat (1917-1977), fondateur du Parti socialiste progressiste, un grand défenseur de la laïcité. Phénomène étrange puisque ce même parti s’impliqua durant la guerre libanaise dans un des combats les plus sectaires.
La laïcité dans le contexte chrétien libanais : racines et problématiques
Malgré la majorité démographique de l’islam au Liban, et l’influence politique affaiblie des chrétiens après les accords de Taëf qui dépossédèrent le président de la République – chrétien – de beaucoup de ses privilèges, le pays du Cèdre est toujours gouverné à partir d’une parité politique, du moins dans l’apparence, entre les chrétiens et les musulmans. Cette parité est fondée sur un régime confessionnel, qui dégénère selon ses détracteurs en un confessionnalisme nuisible à la citoyenneté et à la Cité, qu’ils combattent et auquel ils entendent remédier à travers un régime laïc. C’est dans ce cadre dont les racines plongent dans la création de la République libanaise et dans le mouvement de la Nahda (la Renaissance arabe), qu’il faut situer la tendance laïque dans la pensée religieuse chrétienne libanaise. Car il ne semble pas que la problématique ait énormément varié depuis, une problématique dont le centre moteur demeure la liberté du citoyen dans un État laïc au sein duquel l’identité culturelle est fortement teintée de religion et où les différentes confessions peuvent vivre en paix.
La laïcité n’est pas un phénomène récent dans la pensée chrétienne libanaise. Celle-là eut ses précurseurs au XIXe siècle et lors de la première moitié du XXe siècle durant la période où la Naha livrait au monde arabe ses lettres de noblesse. Cependant, ces précurseurs, influencés pour certains par des critiques de la religion, tels Feuerbach, Marx ou Nietzsche, tissèrent avec la religion des liens bien divers qui varièrent entre critique acerbe et formes de foi laïques multiples. Les trois plus grands représentants de ces tendances furent Boutros Al Boustany (1819-1883), Chibli Choumayel (1850-1917) et Antoun Saadé (1904-1949). Quant à la période contemporaine (de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’aux temps présents), elle est témoin de deux pensées philosophiques qui prônent la laïcité, à travers les œuvres de Nassif Nassar (1940-) et de Adel Daher (1939-). Si ces pensées laïques émergent à partir du contexte chrétien libanais, avec tout ce que peut supposer un contexte comme héritage sociologique, anthropologique, politique et social, elles s’élaborèrent en général à l’écart de la pensée religieuse ou théologique, sans y puiser les éléments de structure de leurs réflexions.
Cependant, la problématique de la laïcité a commencé à être présente dans les réflexions théologiques et/ou philosophiques de certains théologiens ou philosophes de la religion à partir des années 1970. À la différence des pensées évoquées supra, la réflexion de la pensée religieuse chrétienne sur la laïcité prend source dans les données religieuses ou les considère comme une référence majeure pour la réflexion, sans toutefois les considérer forcément comme toujours normatives. Cette pensée religieuse comprend plusieurs courants ou tendances en faveur de la laïcité. Celle-ci pourrait se constituer en laïcité globale, positive ou modérée, comme elle pourrait être une inclinaison timide ou un élément humaniste qui s’ajoute au système religieux. Nous allons illustrer cette pensée à travers deux groupes : le premier représenté par Michel Hayek (1928-2005), Youakim Moubarac (1924-1995) et Georges Khodr (1924-) qui prônent une laïcité ne supposant pas un changement du régime confessionnel ; et le second représenté par Grégoire Haddad (1924 -) et Mouchir Aoun (1964-) qui prônent le remplacement du régime confessionnel par un régime laïc. En outre, il est amusant de constater que même les tendances laïques revêtent un aspect confessionnel au Liban. Est-ce une coïncidence ou une circonstance ? Cela est certainement un fait, car la tendance laïque la plus timide est représentée par des penseurs maronites, donc appartenant à la communauté ayant le plus de pouvoir politique parmi les chrétiens, qui perdra par conséquence le plus de privilèges dans le cas de l’instauration d’un régime laïc. La tendance laïque la plus globale est représentée par des penseurs appartenant à la communauté grec-catholique, celle qui a le moins de privilèges politiques parmi les trois grandes communautés chrétiennes du Liban. Quant à la tendance représentée par Khodr, laquelle se situe à mi-chemin entre les deux, elle est exprimée par une personne qui appartient à la communauté orthodoxe, la deuxième parmi les chrétiens en privilèges politiques.
Les tendances laïques ne supposant pas un changement de régime
Michel Hayek pour un pays areligieux
La pensée du théologien maronite Michel Hayek est sans doute la plus timide à l’endroit de la laïcité. Celui-ci ne la nomme pas d’une manière explicite, et y fait allusion dans le cadre de son apposition au confessionnalisme qui empêche, à son sens, l’être humain de s’épanouir, qui l’affadit et qui est l’un des problèmes majeurs du Liban[1]. Face à cette impasse, Hayek conçoit le Liban comme « une patrie du pardon humain et de la foi divine, un pays areligieux qui s’appuie sur une foi dont les fondements ne sont pas le fanatisme confessionnel, lequel est le plus odieux aspect de la religiosité, mais une confiance que la vérité est victoire, parce qu’il suffit à la vérité d’être pour vaincre, même si les concepts se sont temporairement renversés »[2]. Hayek entend par ces phrases substituer la foi au confessionnalisme. Sa proposition écarte des thèses qui voudraient, en abolissant le confessionnalisme, éradiquer le spirituel et aboutir à une société athée qui serait pour Hayek aussi nuisible à l’être humain tel qu’il le conçoit, que le confessionnalisme. Le théologien maronite écrit d’une manière intransigeante qu’il « n’y a pas de libération possible à l’homme arabe sans une libération de l’hypocrisie de la religiosité confessionnelle »[3].
Les réflexions de Hayek sur une patrie areligieuse et libérée du confessionnalisme ne sont pas à envisager à l’écart de son islamologie qui inscrit l’islam dans l’histoire du salut, à travers la figure d’Ismaël, et le considère comme l’héritier de la foi du premier Abraham, Abram. La patrie qu’envisage Hayek, bâtie sur la foi, attendrait de l’islam une contribution à partir de l’expérience de Dieu qu’il fait dans sa lignée ismaélienne.
Youakim Moubarac : pour un combat laïc
L’autre théologien maronite du XXe siècle, Youakim Moubarac, aborde la laïcité d’une manière plus explicite, en la nommant et en condamnant le confessionnalisme, sans pour autant en arriver à s’opposer au régime confessionnel dans ses écrits, mais juste en proposant un combat laïc pour l’homme arabe. La pensée de Moubarac s’oppose d’une manière « irréductible aux cités sacrales, anciennes ou modernes, qu’elles soient régies par un basileus ou un tsar, un calife ou un sultan, ou qu’elles s’appellent République islamique, État juif ou foyer chrétien »[4]. Par ailleurs, sa revendication d’un combat laïc s’inscrit pleinement dans le sillage de sa théologie pluraliste qui prône la cohabitation saine des trois monothéismes : « Dans la mesure où juifs, chrétiens et musulmans sont ainsi interpellés ensemble au sein du monde arabe, le conflit palestinien les accule au choix de la laïcité[5]. » Moubarac est persuadé que celle-ci est possible pour l’islam qui « est aussi habilité et disposé que la chrétienté à suivre l’évolution des sociétés pluralistes et à promouvoir un régime politique des États où l’élément religieux, loin d’être une entrave au progrès ou un motif de domination des uns par les autres, devient au contraire un facteur puissant d’égalitarisme et de liberté »[6]. C’est dans cette optique qu’il exhorte les chrétiens à s’engager davantage auprès des musulmans, afin de « contribuer à laïciser le combat et à préconiser la lutte de l’homme pour l’homme en faisant appel au besoin aux valeurs humanistes des religions monothéistes pour les défendre contre leurs tentations intégristes »[7]. Le combat laïc et citoyen des chrétiens et des musulmans pour l’homme arabe est une condition incontournable pour la convivialité des religions, et le meilleur antidote contre toute forme de confessionnalisme et de théocratie. L’islam, comme le christianisme avant lui est capable de relever ce défi à partir de ses propres capacités de renouveau.
Georges Khodr : pour un État civil
L’évêque grec-orthodoxe Georges Khodr va encore plus loin dans sa revendication d’une laïcité. Toujours dans le cadre d’une opposition au confessionnalisme, il prône une solution qui inscrit le régime confessionnel dans le cadre d’un État civil. Khodr fonde son point de vue sur la parole du Christ, dans Jn 18, 36 : « Mon Royaume n’est pas de ce monde. » Il en déduit dans le christianisme la séparation des deux domaines politique et religieux : la politique « a ses règles, ses techniques, son langage et son style, et le Royaume de Dieu a ses règles, son langage et son style »[8]. Il est nécessaire d’aboutir à une « libération de la patrie du joug des confessions, et la libération de la foi de l’intrusion de la politique »[9], parce que le mélange des deux domaines provoque au moins deux problèmes majeurs au Liban : 1. Le fait d’avoir deux identités (religieuse et nationale), alors que l’identité politique ne devrait pas se dédoubler, car normalement au sein de l’État, « le citoyen possède une identité citoyenne, c’est-à-dire qu’il est considéré comme appartenant à une unique société nationale qui n’est pas constituée de parties religieuses »[10]. 2. Le confessionnalisme qui est le corollaire du premier problème, et auquel Khodr s’oppose, puisqu’il considère que « tous les confessionnalismes sont des crimes et [que] tous les confessionnalismes sont des discordes et des guerres civiles »[11].
Ainsi, ce n’est pas le régime confessionnel qui est la source du problème, mais le confessionnalisme et l’exploitation des religions par les politiciens. Le régime confessionnel contient au moins un élément positif pour Khodr, celui d’apporter une certaine garantie pour les chrétiens, puisqu’il écarte les méfaits de la majorité numérique, qui leur est de plus en plus défavorable. C’est dans ce cadre qu’il évoque la laïcité, conçue par beaucoup « comme concept synonyme d’athéisme ou de rejet de la loi musulmane »[12]. Il n’est pas question d’appliquer une telle laïcité ou une laïcité à la française au Liban, surtout que « l’Oriental ne supporte pas d’écarter la foi de la sphère publique »[13]. En outre, une ambiguïté linguistique causée par la langue arabe complique davantage la tâche puisque « laïcité » et « sécularisme » se traduisent tous les deux par un seul terme : « ‘almaniyya » (علمانيّة). Or il s’agit de deux concepts différents face auxquels Khodr adopte des attitudes différentes, puisqu’il n’émet pas de réserve sur la « laïcité », synonyme pour lui « d’État civil » (الحكم المدني), mais rejette le « sécularisme » qu’il considère comme une philosophie écartant Dieu et tout ce qui s’y rapporte de la politique et de la vie intellectuelle.
L’État civil prôné par Khodr préserve la diversité spirituelle et lui garantit son rôle au sein d’une patrie laïque. Il en fut ainsi dans l’empire byzantin, qui n’était pas une théocratie et où le gouvernement s’effectuait dans le cadre d’une symphonie entre l’État et la religion. L’empereur ne gouvernait pas l’Église et l’Église ne gouvernait pas l’Empire[14]. Et le théologien orthodoxe de poursuivre : « J’ai appris des historiens musulmans contemporains que les spécialistes de la religion étaient en général à distance de la politique et qu’ils étaient la conscience des califes[15]. » Ainsi, l’État civil, celui dont les lois sont positives, est l’une des solutions qu’il faudrait adopter pour résoudre les problèmes que cause le confessionnalisme au Liban. Mais cela ne reste qu’une mesure extérieure, rappelle Khodr, utile certes, mais insuffisante puisque : « La laïcité est une solution administrative pour les problèmes de l’État, mais elle n’est pas une solution philosophique. Ignorer ce qui existe dans les esprits et ce qui les active ne bâtit pas une société unifiée[16]. »
La tendance laïque supposant un changement de régime
Grégoire Haddad : pour une laïcité globale
Grégoire Haddad, dit l’évêque rouge, milite depuis plusieurs décennies en faveur d’un régime politique laïc au Liban[17]. Il s’agit plus précisément d’une laïcité contextuelle, dite globale en raison de son application dans tous les domaines, positive vis-à-vis des religions et profitant de certains de leurs acquis. Tout au long de ses analyses, Haddad appuie ses réflexions par des références bibliques et coraniques pour prouver l’entière compatibilité entre la laïcité et la foi. Par ailleurs, les problèmes causés par le confessionnalisme sont à la source de sa pensée qui dénonce la substitution des droits des confessions, aux droits de l’homme.
La source du rejet de la laïcité au Liban est fondée pour Haddad sur une mécompréhension de ce qu’elle est, notamment en la considérant comme négative à l’endroit des religions, antireligieuse ou athée. Une « véritable connaissance de la laïcité »[18] ne mènerait pas à son rejet au Liban, car elle regroupe des valeurs fondamentales qui concernent l’épanouissement de l’être humain, dans toutes ses dimensions, notamment religieuses, tout en sachant qu’elle n’est ni chrétienne ni musulmane, ni orientale ni occidentale ; la laïcité est universelle. Ainsi, Haddad s’oppose à de quelconques applications partielles de laïcité au Liban, et prône une laïcité globale qui « affirme l’indépendance du monde dans toutes ses structures, ses dimensions et ses valeurs vis-à-vis de la religion, de ses structures, de ses dimensions et de ses valeurs. Comme par exemple l’indépendance de l’État et de la société, de leurs institutions, de leurs lois, de leurs affaires et de leurs pouvoirs, des institutions, lois et pouvoirs religieux »[19]. Cette indépendance souligne la valeur intrinsèque du monde qui ne relève pas de la donnée religieuse. Toutefois, cette laïcité adopte une neutralité positive et respectueuse vis-à-vis des religions au point même de pouvoir adopter certaines valeurs religieuses qui vont dans le sens du bien temporel de l’être humain (sans pour autant les considérer comme divines, révélées ou immuables). L’enjeu consiste pour Haddad à maintenir la richesse culturelle religieuse libanaise en l’inscrivant dans un cadre non confessionnel, meilleur pour le citoyen, voire purificateur pour les confessions.
L’application de la laïcité globale devrait remédier à beaucoup d’impasses liées au confessionnalisme, à travers la substitution de l’unité nationale qui octroie à l’État une souveraineté sur tout le territoire à l’appartenance confessionnelle et au « fédéralisme des groupes confessionnels »[20]. La question identitaire se trouverait résolue car le Liban ne chercherait plus à être chrétien ou musulman, puisqu’il sera laïc et humaniste. Les partis pourraient être libérés de leurs recroquevillements confessionnels. La vie sociale, économique et politique ne dépendrait plus des équilibres confessionnels : que ce soit au niveau du développement des régions ou à celui des droits des individus et de leurs libertés personnelles. La gouvernance du pays ne s’effectuerait plus au nom des confessions mais au nom du peuple, ce qui rendrait possible le jugement des politiciens corrompus. Quant à l’attitude positive de la laïcité vis-à-vis de la religion, elle permettrait la différenciation entre la foi et ses éléments d’un côté, et les fondements sociaux ou confessionnels de la religion de l’autre. Les croyants pourraient ainsi pratiquer la critique religieuse sans crainte et effectuer un retour aux sources de leur foi. Cette laïcité libérerait Dieu et la religion des défigurations qui découlent du mélange entre le politique et le religieux, et permettrait aux chrétiens et aux musulmans « sociologiques » de se débarrasser de la peur de la disparition puisque l’existence de tout citoyen et sa liberté seraient garanties par l’État, abstraction faite de l’appartenance confessionnelle[21]. Et enfin, la laïcité globale « affirme que l’être humain, tout être humain, est une valeur absolue pour l’État et ses institutions, pour la religion et ses institutions… il est le but final de toutes les institutions religieuses et civiques, et l’échelle absolue pour y opérer des changements… »[22].
Mouchir Aoun : pour une laïcité modérée à neutralité absolue
Mouchir Aoun propose l’abrogation du régime confessionnelle libanais et l’application d’une laïcité modérée à neutralité absolue, garante de la diversité confessionnelle libanaise. Cette proposition qui honore en même temps la composition religieuse de la société libanaise et la citoyenneté, et délivre les chrétiens et tous les Libanais des aliénations du confessionnalisme qui instrumentalise la diversité religieuse libanaise. Le philosophe maintient la ferme conviction que la pensée chrétienne s’épanouit davantage dans la laïcité et ne se plaît pas dans le renfermement confessionnel. Toute sa réflexion sur la question tente de le prouver.
La laïcité modérée trouve ses racines dans les données fondamentales de la foi chrétienne. Le lien entre la foi et la laïcité est profond, puisque celle-ci est « l’autre face de la foi véritable, et puisqu’elle est dans son essence extraite de la capacité critique contenue dans l’essence même de la foi »[23]. Le christianisme formule la laïcité à partir de ses plus profondes convictions de foi, tournant autour de la charité, de l’ouverture à l’autre et de son respect absolu. D’ailleurs l’évangile même est laïc et ne supporte pas le mélange entre le règne de César et celui de Dieu[24]. La laïcité modérée n’adopte certes pas l’ouverture de la foi vers l’absolu divin, mais elle garantit à chacun la possibilité de sa libre recherche de cette voie. Toutefois, les valeurs humaines contenues dans la foi chrétienne trouvent en la laïcité modérée un réceptacle. En séparant le temporel et le spirituel au niveau du pouvoir et en distinguant ces deux domaines au niveau de la vie, la laïcité modérée crée un rapport nouveau entre la pensée évangélique et la réalité plurielle de la convivialité libanaise. Le théologique entretient désormais un lien différent avec le social et le politique, différent de celui proposé par le confessionnalisme. Il ne s’agit plus d’un lien de pouvoir théologico-politique, mais de l’incarnation des valeurs humaines contenues dans les données de la foi chrétienne, au sein de la vie politique et sociale.
Si la laïcité s’est retrouvée faire face à beaucoup d’oppositions au Liban, c’est surtout en raison de l’amalgame qui a été fait entre laïcité et athéisme. La laïcité modérée qui s’oppose à toute forme d’athéisme systématique et idéologique est une laïcité souple et neutre qui sépare le pouvoir politique du pouvoir religieux, mais n’écarte pas les valeurs humaines compatibles avec les enseignements religieux et avec la charte des droits de l’homme. Ainsi, tous les Libanais peuvent profiter d’une valeur religieuse chrétienne ou musulmane. Toutefois, l’aspect pluraliste de la laïcité écarte les aliénations identitaires, le fanatisme et la violence. Face au recroquevillement confessionnel, la laïcité modérée offre aux confessions un espace de rencontre sain. L’instauration au Liban d’un État laïc qui gouverne à partir de la charte des droits de l’homme et des principes de dignité, de liberté, d’égalité et de fraternité, fait de la religion un élément de progrès spirituel et intellectuel[25].
La laïcité modérée suppose ainsi « que le religieux et le politique doivent être définitivement séparés comme deux champs de compétence qui régissent deux types différents de besoins et deux secteurs distincts de la vie humaine. Quant aux valeurs fondamentales de la vie, le politique et le religieux doivent s’inspirer d’une charte commune de principes directeurs qui soient en mesure de donner sens à l’existence humaine tout entière. Une herméneutique consensuelle des principes majeurs de la vie commune, comme la liberté, la justice, la paix, la solidarité, est par conséquent la seule voie de salut offerte aux sociétés plurielles dont le Liban fait partie […]. Si je qualifie cette laïcité de modérée, c’est justement en raison de l’herméneutique consensuelle qui consiste à favoriser, par le débat et l’échange et l’émergence d’un contenu sémantique axiologique propre au contexte libanais et l’élaboration de la meilleure forme possible d’inscription juridique et de réalisation historique appropriée »[26]. La laïcité modérée est le champ politique, éthique et culturel de la rencontre des différentes composantes de la société libanaise, les chrétiens, les musulmans et les laïcs. La foi serait dans ce cadre une instance de renouveau pour la liberté de l’être humain, et la citoyenneté un principe qui permet à chacun d’édifier son humanité comme bon lui semble dans la cité. Diriger la cité relèvera ainsi de la responsabilité de tous les citoyens qui s’inspirent de leurs valeurs religieuses ou culturelles propres. Ce cadre exclut la contradiction qui peut exister entre la diversité des compréhensions de l’existence humaine et la vie dans la cité qui exclut dans sa législation les références métaphysiques et s’appuie sur la charte des droits de l’homme. Cela fera de la cause de l’être humain la cause première à partir de quoi s’élabore la nation, puisque la solidarité humaine dépasse toute appartenance nationaliste et confessionnelle.
Conclusion
Il n’y pas de doute que les questions de la citoyenneté et des droits de l’homme se trouvent, implicitement ou explicitement, au centre des revendications des pensées que nous avions étudiées. En outre, l’établissement de certaines justifications du régime laïc à partir de la théologie ou de l’histoire de la chrétienté orientale prend tout son sens dans un contexte où la religion a toujours un poids, plus ou moins déterminant. La citoyenneté et les droits de l’homme sont, plus que jamais, dans la foulée des « révoltes arabes » et de la montée vertigineuse des fondamentalismes religieux, une nécessité que chrétiens, musulmans et laïcs arabes doivent situer au centre de leurs combats sociaux et politiques. Mon souhait profond de théologien et de philosophe est qu’on défende un jour en Orient arabe, les droits de l’homme, avec au moins le même zèle qu’on utilise pour défendre les droits de Dieu.
Antoine Fleyfel
[1] « Les trois souillures du Liban sont le confessionnalisme, l’irrationalité et l’anarchisme » (Hayek M., « Hérite du Liban celui qui se passionne pour la liberté et la paix » (يرث لبنان من يتعشّق الحرّيّة والسلام), in An-Nahar, 22 mars 2005).
[2] Hayek M., Épître aux fils de notre génération (رسالة إلى بني جيلنا), Beyrouth, publications de l’Imprimerie catholique, 1970 p. 79-80.
[3] Aoun M., « À la source de la pensée religieuse arabe chrétienne contemporaine : Père Michel Hayek, un exemple singulier dans l’existentialisme théologique critique » (من بواكير الفكر العربي الديني المسيحي المعاصر الأب ميشال الحايك مثالا فذا في الوجودية اللاهوتية الناقدة), in An-Nahar, Annexe hebdomadaire, n° 705, 11 septembre 2005, p. 27.
[4] Moubarac Y., « Trois entreprises en Orient arabe », in Libanica, n° 24, 1987, in Corm G., Youakim Moubarac, un homme d’exception, Beyrouth, Librairie Orientale, 2004, p. 114.
[5] Moubarac Y., Palestine et arabité, Pentalogie islamo-chrétienne, Tome V, Beyrouth, éditions du Cénacle Libanais, 1972-1973, p. 205.
[6] Moubarac Y., Les Chrétiens et le monde arabe, Pentalogie islamo-chrétienne, Tome IV, Beyrouth, éditions du Cénacle Libanais, 1972-1973, p. 204.
[7] Moubarac Y., La chambre nuptiale du cœur, Approches spirituelles et questionnements de l’Orient syriani, Paris, Cariscript, 1993, p. 98.
[8] Khodr G., « L’État civil » (الحكم المدني), in An-Nahar, 23 janvier 2010.
[11] Khodr G., « Le confessionnalisme et l’appartenance » (الطائفيّة والانتماء), in An-Nahar, 5 décembre 1992.
[12] Khodr G., « L’abolition du confessionnalisme politique » (إلغاء الطائفية السياسية), in An-Nahar, 04 avril 1998.
[13] Khodr G., « Laïcité, confessions et pays » (علمانية وطوائف وبلد), in An-Nahar, 5 novembre 2002.
[15] Khodr G., « L’Église et la politique » (الكنسية والسياسة), in An-Nahar, 15 août 1992
[16] Khodr G., « Où en sommes-nous du repentir national au Liban ? » (التوبة الوطنيّة في لبنان، أين نحن منها؟), Al Lika’ al Loubnani, Taanail, 31 octobre 1998.
[17] Il est notamment le fondateur du « Mouvement social », l’un des rares rassemblements non confessionnels au Liban, qui milite pour l’application d’un régime laïc au Liban. Pour aller plus loin, consulter : Karam K., Le mouvement civil au Liban : revendications, protestations et mobilisations, Paris, Karthala, 2006.
[18] Haddad G., La laïcité globale (العلمانيّة الشاملة), Mokhtarat, 3e éd., Zalka / Liban, 2005, p. 16.
[21] Force est de constater que les attaques qu’adresse Haddad au confessionnalisme et à ses effets, en parlant de laïcité, clarifient davantage sa critique religieuse radicale des Églises-confessions au Liban.
[23] Aoun M., Religion et politique (بين الدين والسياسة), Beyrouth, Éditions An-Nahar, 2008, p. 293.
[26] Aoun M., « La fragilité libanaise, Paradoxes et malheurs du système confessionnel », article à diffusion restreinte, 2008, p. 6.
Article scientifique paru sur une année, en quatre parties, dans la revue de l’Œuvre d’Orient. N° 768 (2012), n° 769 (2012), n° 770 (2013) et n° 771 (2013).

Introduction
L’œcuménisme est une exigence ecclésiale majeure qui est désormais déterminante pour la théologie chrétienne. Il connut des moments forts lors du XXe siècle, notamment dans les milieux protestants et orthodoxes durant sa première moitié, à travers la création du Conseil Œcuménique des Églises en 1948 (349 Églises membres actuellement), et dans le sillage de l’aggiornamento du concile Vatican II (1962-1965) qui fut un tournant décisif en la matière. Les fruits des dialogues œcuméniques furent nombreux et les frères séparés se sont retrouvés après de longs siècles de rupture. Ainsi, la rencontre du pape Paul VI et du patriarche œcuménique Athénagoras en 1965 eut des conséquences majeures sur les relations entre les Églises catholique et orthodoxes, et le dialogue mené entre l’Église catholique et un grand nombre d’Églises luthériennes durant quatre décennies permit la rédaction, en 1999, d’une déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi. Levées d’excommunications, rapprochements, formulations théologiques nouvelles, visions renouvelées du mystère de l’Église, connaissance et acceptation de l’autre tel qu’il se définit étaient à l’ordre du jour.
Le Moyen-Orient, quant à lui, est largement concerné par le dialogue œcuménique et, peut-être, à un degré encore plus intense qu’en Occident. N’est-ce pas sur cette terre d’origine que les pires divisions des Églises eurent lieu : au concile d’Éphèse (431) par exemple, donnant naissance aux Églises des deux conciles (les Églises assyriennes) ou au concile de Chalcédoine (451) donnant naissance aux Églises orthodoxes orientales (coptes orthodoxes, syriaques orthodoxes, arméniens orthodoxes) ; les exemples historiques sont bien nombreux. Quant à l’activité missionnaire latine aux XVIIe et XVIIIe siècles, forte de sa vision de l’unité chrétienne propre à son époque, elle donna naissance aux Églises orientales catholiques[1], ce qui créa une nouvelle problématique œcuménique que d’aucuns dénommèrent « l’uniatisme ». Celle-ci place les chrétiens d’Orient devant le grand défi du rétablissement de la communion ecclésiale, selon l’esprit de Vatican II et des acquis du dialogue œcuménique mondial, défi qu’ils décidèrent de relever ensemble, toutes Églises confondues, par divers moyens. D’ailleurs, le Moyen-Orient est considéré comme la terre où existe la plus grande densité œcuménique, eu égard au nombre très élevé d’Églises qu’on peut y trouver (on en décompte 29), dont plusieurs apostoliques, et qu’il est possible de classifier en cinq familles ecclésiales.
Cet article voudrait mettre la lumière sur la question de l’œcuménique au Moyen-Orient – bien différente de celle connue en Occident –, évoquer certaines étapes historiques déterminantes, les problèmes et les défis du dialogue, et essayer de poser quelques questions sur l’avenir de l’œcuménisme au Moyen-Orient et sur son sens pour la présence chrétienne.
La problématique moyen-orientale de l’œcuménisme
Il se doit aux habitués des dialogues œcuméniques en Occident d’opérer quelques ajustements pour comprendre l’œcuménisme au Moyen-Orient. Celle-ci n’est pas très concernée par un dialogue, essentiel en Occident, entre les catholiques et les protestants (et anglicans). Non seulement parce que les Églises protestantes y sont très minoritaires, récentes et adventices, mais aussi parce que des questions beaucoup plus larges et anciennes déterminent l’œcuménisme dans la région. Elle est, certes, concernée par le dialogue entre les catholiques et les orthodoxes, mais surtout à partir de problèmes qui sont propres aux Églises orientales, comme celui de l’uniatisme qui est toujours source de malaise, surtout aux orthodoxes, mais moins qu’avant[2], puisque le dialogue fit beaucoup de pas en avant. Il relève enfin de sa problématique des éléments assez étrangers à l’œcuménisme en Occident, c’est-à-dire le défi du dialogue entre les Églises appartenant à la famille orthodoxe, les Églises appartenant à la famille orthodoxe orientale ou l’Église d’Orient, dite aussi assyrienne (voir infra).
En outre, ce dialogue prend place dans un espace géographique chargé d’histoire. En d’autres termes, quatre sièges patriarcaux sur cinq historiques sont concernés, à savoir : Jérusalem, Antioche, Alexandrie et Constantinople. Rome n’est impliqué d’une manière directe qu’à travers les Église catholiques orientales et les latins, minoritaires parmi les chrétiens du Moyen-Orient[3].Tout cela ne veut pas dire que ces derniers ne sont pas engagés dans le dialogue œcuménique mondial, notamment les orientaux catholiques. Au contraire ils le sont au point de dépendre largement du dialogue effectué entre le Saint-Siège et les Églises orthodoxes, sans que cela les empêche d’avoir leur vocation œcuménique propre. Par ailleurs, la différence du contexte social et politique est aussi à prendre en compte. En Occident, le dialogue s’effectue d’une manière générale, dans le cadre de régimes démocratiques, en confrontation avec la modernité et ses acquis, et dans un milieu social à coloration religieuse toujours assez homogène, chrétien ou d’héritage chrétien. Alors qu’il s’effectue en Orient, dans le cadre de régimes totalitaires pour la plupart (il est encore tôt d’évaluer les conséquences desdites révoltes arabes), en confrontation avec une culture bien imprégnée par le religieux, et dans un milieu social à coloration musulmane très majoritaire, le Liban excepté. Tout cela donne à l’œcuménisme des tournures très particulières au Moyen-Orient.
Plusieurs manières de présenter les Églises du Moyen-Orient sont possibles. Nous nous appuierons essentiellement sur la classification du Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO) qui évoque quatre familles membres, et nous y ajouterons la cinquième famille, celle des Églises des deux conciles, dont la candidature n’a jamais été acceptée en raison du refus de l’Église copte orthodoxe qui considère toujours les assyriens comme nestoriens, donc comme hérétiques[4].
- La famille des Églises des deux conciles. Celles-ci naquirent du refus des conclusions du concile d’Éphèse en 431 et furent longtemps qualifiées de « nestoriennes ». Deux Églises en font actuellement partie : l’Église apostolique assyrienne de l’Orient et l’Ancienne Église d’Orient (née d’un schisme avec son Église sœur en 1968).
- La famille des Églises orthodoxes orientales. Celles-ci naquirent du refus des conclusions du concile de Chalcédoine en 451 et furent longtemps qualifiées de « monophysites ». Elle comprend trois Églises : l’Église copte orthodoxe, l’Église syriaque orthodoxe et l’Église apostolique arménienne.
- La famille des Églises orthodoxes. Celles-ci reconnaissent les sept premiers conciles œcuméniques mais ne sont pas en communion avec le pape. Elle se compose de quatre Églises : l’Église orthodoxe d’Antioche, l’Église orthodoxe de Jérusalem, l’Église orthodoxe d’Alexandrie et l’Église orthodoxe de Chypre.
- La famille des Églises catholiques orientales. Sept Églises en font partie : l’Église maronite, l’Église grecque melkite catholique, l’Église syriaque catholique, l’Église arménienne catholique, l’Église copte catholique, l’Église chaldéenne et le patriarcat latin de Jérusalem. Pour leur majorité, celles-ci sont le fruit de l’activité des missionnaires latins (à partir de la fin du XVIe siècle).
- La famille des Églises issues de la Réforme. Celles-ci sont le fruit du mouvement missionnaire protestant, notamment au XIXe siècle. Bien que nombreuses, elles sont numériquement très minoritaires[5]. Treize Églises composent cette famille. Mentionnons parmi elle : l’Église évangélique copte, l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte, l’Église épiscopale de Jérusalem et du Moyen-Orient, l’Union des Églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient et le Synode Évangélique national de la Syrie et du Liban.
C’est à partir de ces données qu’il faudrait comprendre l’œcuménisme au Moyen-Orient, mais aussi, en tenant compte de certains éléments fondamentaux qui se situent au centre de cet œcuménisme, à savoir les questions de l’uniatisme, du témoignage dû et de la présence.
Les problèmes de la division des chrétiens au Moyen-Orient
Le plus grand problème de la division des Églises est le même, en Orient comme en Occident, il se résume par le fait que celle-ci contredit la volonté du Seigneur qui pria à son Père en demandant « qu’ils soient uns ». Cette prière est sans nul doute le fondement premier de tout œcuménisme et l’exigence qui accule toutes les Églises à trouver les solutions adéquates pour rétablir la communion entre elles.
Nul besoin n’est de rappeler les conséquences politiques de la division de la chrétienté orientale. Les manuels d’histoire regorgent de détails soulignant le rôle que jouèrent les divisions intestines des Églises orientales au premier millénaire, lesquels contribuèrent activement à un affaiblissement croissant de cette chrétienté, voire à son tarissement à plusieurs égards, et à la disparition de beaucoup de communautés. Cependant, versons-nous sur les problèmes immédiats et cuisants de l’œcuménisme moyen-oriental.
L’uniatisme est l’un des grands problèmes de cet œcuménisme. Celui-ci est actuellement rejeté par toutes les Églises, mais il semble que ses effets sont toujours présents, du moins dans certains esprits, qui conçoivent l’unité comme un retour des Églises « séparées » au giron de l’Église « romaine », alors qu’une vision œcuménique saine, notamment celle du concile Vatican II, conçoit désormais l’unité de l’Église comme le rétablissement de la « communion » entre les Églises, et la différence est de taille. Mais qu’est-ce que l’uniatisme ? La célèbre déclaration de Balamand (1993)[6], signée par les catholiques et les orthodoxes nous informe que c’est une méthode ancienne de recherche de l’unité, rejetée par les Églises parce qu’opposée à leur tradition commune. Voici comment le point 8 de la déclaration décrit la question :
Durant les quatre derniers siècles, en diverses régions de l’Orient, des initiatives ont été prises, de l’intérieur de certaines Églises et sous l’impulsion d’éléments extérieurs, pour rétablir la communion entre l’Église d’Orient et l’Église d’Occident. Ces initiatives ont conduit à l’union de certaines communautés avec le Siège de Rome et ont entraîné, comme conséquence, la rupture de la communion avec leurs Églises-mères d’Orient. Cela se produisit non sans l’intervention d’intérêts extra-ecclésiaux. Ainsi sont nées des Églises orientales catholiques et s’est créée une situation qui est devenue source de conflit et de souffrances d’abord pour les orthodoxes mais aussi pour les catholiques.
Ainsi, plutôt que de s’appuyer sur une logique « uniate » qui prône « l’union » d’une Église à une autre, l’esprit œcuménique recherche la « communion » entre les Églises. Pour ce faire, la déclaration de Balamand évoque plusieurs fondements ecclésiologiques et établit plusieurs règles censées écarter les problèmes posés naguère par l’uniatisme. Cependant, même si le problème de l’unité de l’Église n’est pas résolu, catholiques et orthodoxes sont désormais d’accord pour s’engager sur les voies d’une recherche du rétablissement de la communion entre leurs Églises.
Cette déclaration fut certes un pas de géant pour l’œcuménisme au Moyen-Orient, et depuis sa promulgation, les partenaires sont conscients de ce problème qu’il ne faut pas esquiver lors de tout dialogue œcuménique au Moyen-Orient, et peuvent s’appuyer sur un document clef reconnu par tous et dénonçant l’uniatisme.
La division de l’Église au Moyen-Orient pose un autre problème, celui du témoignage dû à l’islam. Beaucoup de théologiens locaux le rappellent constamment. Michel Hayek (1928-2005), prêtre et théologien maronite, le formule en parlant de la responsabilité des chrétiens d’Orient « devant Dieu et devant l’histoire du salut du monde islamique »[7]. Non qu’il s’agisse d’un prosélytisme ou d’un appel à la conversion, mais d’un témoignage authentique d’une foi ne pouvant être vécue pleinement dans le cadre de déchirures et d’adversités interchrétiennes. Quant à Jean Corbon (1924-2001), prêtre et théologien grec catholique, il va encore plus loin, et parle d’une « atrophie pneumatique » dont souffrent les Églises orientales à cause de leurs divisions. Celles-ci doivent rendre un témoignage adéquat aux musulmans, « au milieu desquels et pour lesquels elle existe »[8], un témoignage non en tant qu’Églises séparées, mais en tant que l’Église de Dieu dans le monde arabe, l’Église des Arabes : « Si l’Église est le grand don de la communion divine aux hommes, elle ne peut être seulement la communion de Dieu et des melkites, celle de Dieu et des chaldéens, etc. Elle doit être ici dans notre région la communion de Dieu et des Arabes[9]. » Or le problème de la division des Églises est une entrave majeure pour le témoignage, et « il faut bien avouer que le monde musulman ne voit pas au milieu de lui l’Église du Christ, mais une poussière de communautés chrétiennes…»[10]. Face à cet état de division Corbon exprimait son étonnement de ce que les Églises locales ne déploient pas suffisamment d’efforts dans le but de retrouver la communion qui doit être leur exigence première. En témoignent les problèmes de calendriers, de l’absence de traductions communes des textes essentiels (Bible, Pater, Credo), des mentalités confessionnelles, de la peur de l’autre, de la valorisation de l’Occident et de la mésestime de soi, etc.
Uniatisme, communion et témoignage à l’endroit de l’islam sont de réels problèmes qui affectent toujours l’œcuménisme au Moyen-Orient et qui affaiblissent davantage la présence chrétienne, en proie à nombre de difficultés sociales, politiques, migratoires et sécuritaires, difficultés accentuées, depuis l’occupation de l’Irak en 2003, mais surtout lors desdites révoltes arabes. Au niveau de la réflexion théologique, beaucoup de solutions furent proposées, nous en évoquerons deux. Au niveau des tentatives, une entreprise avortée d’union entre les Églises grecque orthodoxe et grecque catholique eut lieu en 1996. Au niveau pratique, une institution œcuménique vit le jour en 1974, portant tous les espoirs des chrétiens d’Orient en un rétablissement de la communion entre leurs Églises, à savoir le Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO).
À la recherche de l’unité perdue
Youakim Moubarac (1924-1995), prêtre et théologien maronite, œuvra durant la fin du XXe siècle pour un projet d’unité des Églises du Moyen-Orient. Il le qualifia de « Restauration de l’unité antiochienne ». Par cela il entendait aboutir à l’unité des Églises de son contexte moyen-oriental à travers un retour à l’héritage commun qui n’est autre que celui du patriarcat d’Antioche, mais aussi des Églises non antiochiennes qui existent sur le territoire historique[11] de ce patriarcat : « Tous les fidèles du Christ qui se trouvent dans le domaine du patriarcat d’Antioche sont des Antiochiens, y compris les Arméniens, les Latins et les Protestants. Ils ont tous donné les preuves […] de leur attachement à la terre antiochienne, de leur enracinement dans cette terre et de leurs potentialités créatrices[12]. » La priorité de cette « restauration », responsabilité de toutes les Églises, n’est autre que l’œcuménisme, exigence majeure de la présence chrétienne en Orient. Par ce projet, Moubarac considérait que les possibilités de l’œcuménisme ne sont pas épuisées par les deux options qu’offrent les mondes grec et latin, et qu’une troisième voie existe, celle d’Antioche. Dans l’attente de la réconciliation entre Rome et Byzance, Moubarac proposait aux Antiochiens, partenaires du dialogue, de ne pas s’asseoir, les uns à côté des Latins, et les autres à côté des Grecs. Si les antiochiens « venaient à s’assoir ensemble au milieu, ce serait un témoignage unitaire antiochien. Il ne faudrait pas priver les Églises de sa symbolique »[13]. Si un tel acte symbolique pouvait avoir lieu, cette présence exclusive d’Antioche au sein du dialogue œcuménique « serait un stimulant, voire un défi pour le projet unitaire œcuménique. Ainsi l’unité antiochienne serait le noyau de l’universelle unité, et il lui appartiendrait d’en devenir l’aiguillon, en commençant par l’unification de la célébration de Pâques »[14]. Cet œcuménisme antiochien, au service de la cause œcuménique globale, n’est ni culturel, ni doctrinal, ni pastoral. Il est spirituel, fondé sur l’héritage commun scripturaire et patristique qui possède une diversité d’expressions culturelles, grecque, syriaque ou arabe. Le théologien maronite appuyait son projet par des exemples concrets d’un retour aux sources ecclésiales de communion existant au premier millénaire[15]. La concrétisation de ce projet devait se faire par la tenue d’un « Concile antiochien » qui n’a malheureusement jamais vu le jour.
Jean Corbon, quant à lui, fit une proposition allant dans le même sens, mais ayant une destinée différente : « l’Église des Arabes ». Celle-ci est de facture ecclésiologique et théologique plus nourrie, et elle est actuellement la proposition œcuménique de référence pour toute entreprise sérieuse de rétablissement de la communion entre les Églises du Moyen-Orient. L’Église des Arabes n’est pas une nouvelle Église, mais la même Église antiochienne, « nouvellement une » et expression de la pluralité des Églises du contexte. L’Église des Arabes ne serait pas une super-Église qui englobe toutes les autres, mais l’Église de Jésus Christ au service du contexte arabe, rendant un témoignage uni de l’amour de Dieu : « Il ne s’agira ni de l’Église […] d’Arabie, ni de l’Église arabe ou antiochienne, ni de l’Église jacobite ou nestorienne, ni de l’Église orthodoxe ou catholique […], mais de l’Église vivante en cette région et dont l’identité inclut les Églises particulières qui la composent[16]. » En devenant l’Église des Arabes, les Églises antiochiennes relèveraient le défi de leur rôle et de leur témoignage au Moyen-Orient, car elles ne seraient plus les Églises d’un passé prestigieux, mais celles d’un présent au sein duquel elles sont appelées à la plus grande implication. Et c’est ainsi que le message de l’Église du Christ aura un sens pour le monde arabe, celui de la communion entre Dieu et les hommes, au-delà des barrières ethniques, culturelles ou religieuses. Cela s’opère à travers une nouvelle prise de conscience des Églises, un renouveau, une redéfinition de soi et de la mission au sein du monde arabe et vis-à-vis des musulmans. Et Corbon de trancher en disant que les Églises antiochiennes « ne seront elles-mêmes qu’en devenant l’Église des Arabes »[17], témoignant de Dieu à partir de leur unité, car leur division « brouille le regard ».
Corbon considère que la problématique œcuménique occidentale est inadéquate en Orient, et propose trois solutions aux Églises dans la perspective de leur unité. Il appartient aux Églises qu’il dénomme adventices (latines ou protestantes) d’arrêter toute activité de récupération, et de « s’abstenir de faire interférer leurs propres divisions dans le contexte antiochien. Les problématiques latine et réformée de l’unité ne concernent pas notre région. […] La réforme du XVIe siècle et le catholicisme post-tridentin n’ont rien à voir ici »[18]. Cependant, ces Églises doivent s’engager auprès de leurs consœurs sur la voie œcuménique et les aider[19]. Quant au problème des Églises dites uniates[20] qui engage aussi bien Rome que les orthodoxes, il devrait être abordé à partir d’un changement de perspective de Rome qui devrait continuer à s’engager dans la logique de « communion ecclésiale » et reconsidérer le statut œcuménique des conciles auxquels les orthodoxes n’ont pas assisté[21]. Cependant, les Églises dites uniates ont un rôle primordial à jouer avec leurs Églises d’origine pour retrouver la communion. Elles ne devraient pas attendre que la solution leur vienne seulement du Saint-Siège, surtout que des relations de tradition, de vie et de langue existent toujours entre elles et leurs Églises d’origine. Enfin, les Églises antiochiennes du premier millénaire[22] devraient continuer leurs efforts pour l’unité, car elles ont fait de grands pas dans ce sens selon Corbon. Somme toute, il appartient aux Églises dites adventices « d’aider », auxdites uniates de « régulariser » leur situation, et aux Églises antiochiennes du premier millénaire de « renouer » leur communion.
Deux décennies après les propositions de Corbon qui suggérait aux Églises séparées à cause de l’uniatisme d’œuvrer pour le rétablissement de la communion entre elles, un projet très intéressant de rétablissement de la communion entre les Églises melkites orthodoxe et catholique fut présenté en juillet 1996[23]. Celui-ci fut le fruit d’un long dialogue, influencé par les avancées œcuméniques du concile Vatican II. Le rétablissement de la communion n’eut pas lieu, car les complications ecclésiologiques et théologiques étaient toujours de taille. Cependant, l’initiation d’un tel projet et le dialogue qui l’avait accompagné montrent que l’unité est possible, et encouragent les partenaires du dialogue à persister dans leurs efforts œcuméniques.
Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, une structure œcuménique salutaire
Problématiques et problèmes œcuméniques moyen-orientaux, réflexions théologiques, projets ou souhaits d’union, trouvent tous dans le Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO) une institution salutaire. Celle-ci est unique parmi les institutions œcuméniques à travers le monde, puisqu’elle est la seule à avoir l’Église catholique en tant que membre[24], mais elle est aussi singulière au Moyen-Orient, de part sa mission et son envergure. Cependant, l’histoire de sa fondation et de son développement ne contient pas que des pages glorieuses, car le CEMO affronte ces dernières années de grandes difficultés qui l’ébranlent. Ce qui a des conséquences directes sur l’œcuménisme au Moyen-Orient.
Le CEMO, fruit d’un long processus œcuménique qui dura plusieurs décennies, fut créé en mai 1974[25], en Nicosie. À cette époque, trois familles ecclésiales le composaient : les orthodoxes orientaux, les orthodoxes et les protestants. Chaque Église devenait membre du Conseil à partir de la famille dont elle fait partie. Une quatrième famille rejoignit le CEMO en 1990, la famille des Églises catholiques.
Basé à Beyrouth et représenté dans plusieurs pays, le CEMO centre son activité autour de quatre objectifs :
- La continuité de la présence chrétienne, en particulier dans la lutte contre les causes d’une émigration tragique.
- Le renouvellement de la qualité spirituelle des Églises à travers et au-delà de leur identité socioculturelle.
- L’unité chrétienne.
- Le témoignage commun des Églises dans des sociétés pluri-religieuses.
Acquis et turbulences au sein du CEMO
Le CEMO joua un rôle incontestable durant plus de trois décennies sur le plan de l’œcuménisme. Le fait que presque toutes les Églises du Moyen-Orient y soient représentées, en plus de l’appui mondial et financier qu’il obtint, lui permirent de bénéficier d’une large manœuvre d’action. Gaby Hachem, prêtre grec catholique, théologien et responsable durant plusieurs années au sein du Conseil, en dresse un bilan. Il nous apprend que le CEMO s’appliqua à promouvoir un esprit nouveau permettant aux différentes Églises de vivre un âge d’or œcuménique. Guidées par ce Conseil, elles cheminèrent vers une forme de synodalité exprimée dans les multiples rencontres, consultations mutuelles et dialogues. Le mouvement œcuménique prit alors racine dans les diocèses, instituts et facultés de théologie et atteignit parfois les fidèles dans les paroisses. La formation œcuménique, proposée aux pasteurs ou promue dans les centres universitaires, donna beaucoup de fruits qui se manifestèrent dans les échanges et la collaboration au sein de l’Association des Instituts et Facultés de Théologie. Ensemble, les Églises témoignèrent de leur charité envers toutes les victimes des catastrophes naturelles survenues et des guerres déclenchées dans la région. Le Conseil cultiva de tout temps une politique de secours et de développement très efficace, car soutenue par l’expérience et la générosité de nombreux partenaires internationaux. Les premières initiatives dans le domaine des rencontres islamo-chrétiennes vinrent également du Conseil. Celui-ci s’empressa de créer une commission spéciale ainsi que le Groupe arabe pour le dialogue islamo-chrétien afin de prêter une attention particulière aux relations entre chrétiens et musulmans[26].
Ainsi, le Conseil fut un exemple d’œcuménisme unique au monde et créa une méthode de travail que nulle autre instance mondiale n’aurait pu fournir, qu’elle fût catholique, orthodoxe ou réformée. Cependant, cela n’aurait pas pu être possible sans l’appui des Églises Occidentales, catholique et réformées.
Toutefois, un grave incident eut lieu le 20 avril 2010. Relaté par les médias, il révéla de grandes turbulences au sein du CEMO. Ce jour-là, lors d’une réunion du conseil exécutif à Amman (Jordanie), le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, jugea que le Secrétaire général (copte orthodoxe) Guirgis Saleh « paralysait l’effort œcuménique » et lui demanda de démissionner. Expliquant que le Conseil était devenu un « club privé » copte, le patriarche accusa de même l’évêque copte orthodoxe Bishoy de manquer de « loyauté et de dévouement » à la cause du CEMO. Saleh rejeta ces accusations et considéra les revendications de Théophile III comme illégales. La conséquence immédiate de cette altercation fut le retrait de l’Église copte orthodoxe du CEMO. Mais heureusement que cela ne dura pas longtemps et que cette Église qui représente les deux tiers des chrétiens du Moyen-Orient retourna au Conseil après des démarches de réconciliation. Cependant, une grande situation de paralysie naquit à la suite de cet incident, et révéla de profonds problèmes qui affectaient sérieusement le Conseil depuis des années, mettant en danger tout l’effort œcuménique au Moyen-Orient.
Mais quelle est la nature de ces problèmes ?
Gabriel Hachem dénombre trois crises majeures[27] qui affectent le CEMO. La première est identitaire : les Églises membres étaient toujours prêtes à recevoir du CEMO, alors qu’en raison de ses difficultés, celui-ci aurait eu besoin d’elles ces dernières années sans pouvoir obtenir de leur part un soutien significatif. La deuxième est administrative : la compétence du personnel du CEMO, presque une centaine d’employés, n’était plus à la hauteur des exigences et responsabilités. La troisième est financière : la crise économique mondiale eut des conséquences directes sur les donateurs de fonds, et cela se ressentit d’une manière fâcheuse au CEMO qui se trouva par ce fait, paralysé et endetté. Les mesures de sauvetage qui furent prises tardèrent à arriver et ne purent résoudre le problème.
Et maintenant, où va-t-on ?
Bien loin des trois décennies qui suivirent la fondation du CEMO, pleines d’espérance et de cheminement vers le rétablissement de la communion entre les Églises du Moyen-Orient, le bilan des quelques dernières années est attristant, et l’on peut se demander s’il s’agit d’une fin de partie pour l’œcuménisme au Moyen-Orient. Une lecture pessimiste s’inscrivant dans le sillage des prophéties de malheur annonçant la disparition des chrétiens d’Orient pourrait le supposer. Cependant, malgré les bémols de l’histoire –et les chrétiens d’Orient sont loin d’en être à leurs premiers–, beaucoup de facteurs d’espérance existent pour un redressement de la situation, et maints signes concrets au sein des communautés, voire dans le CEMO même, nous poussent à espérer en un changement positif de la situation.
Les premiers espoirs concernent le CEMO. Le 30 novembre 2011, le père Paul Rouhana, un grand spécialiste de l’œcuménisme, fut élu Secrétaire général, ce qui permit l’ouverture d’une nouvelle page au Conseil. Cependant, élu évêque au mois de juin 2012, Rouhana dut démissionner quelques mois plus tard à cause des exigences des deux tâches. Le père Michel Jalkh, moine Antonin maronite, œcuméniste avéré lui aussi, assume cette charge depuis avril 2013.
Quant aux volontés des hiérarchies ecclésiastiques, malgré un semblant d’oubli de la question œcuménique chez certaines, beaucoup restent engagées sur les voies de la communion plénière. L’Église catholique ne cesse de le rappeler et l’ancien pape Benoît XVI effectua un acte fort à cet égard en convoquant un Synode pour les Églises du Moyen-Orient en 2010. L’Exhortation qu’il délivra en septembre 2012 au Liban souligna d’une manière claire et nette la nécessité, voire la centralité de l’œcuménisme pour l’avenir des chrétiens d’Orient, de leur témoignage et de leur présence sur les terres de leurs ancêtres.
En outre, les activités œcuméniques, les centres d’études, les rencontres, les colloques, les écrits et publications indiquent toutes[28] que, loin de désespérer de la question, beaucoup de communautés chrétiennes orientales continuent à y croire et s’engagent sur ses chemins, l’une des voies royales du sérieux de leur enracinement dans le sol arabe. Dresser le bilan de tout ce qui se fait serait très long, mais mentionnons à titre d’exemple récent, la fondation du centre Liqaa (rencontre en arabe) par le patriarcat grec catholique en mai 2011. Celui-là s’engage dans de grands projets prometteurs, de dialogue œcuménique et interreligieux. Depuis, plusieurs activités eurent lieu dans ce sens.
Enfin, sans vouloir prétendre épuiser les signes d’espérance, fortes de leur foi en Dieu le Père de Jésus Christ, les Églises du Moyen-Orient croient que l’Esprit souffle toujours en elles, et qu’elles sont amenées par lui à demeurer toujours nouvelles, à s’engager sans arrêt dans leur recherche de la pleine communion ecclésiale, et à espérer là où d’autres n’espèrent plus.
Antoine Fleyfel
2012-2013
[1] Force est de constater que les Églises orientales catholiques font preuve d’un grand dynamisme œcuménique au Moyen-Orient, dans tous les pays où ils existent, et d’un charisme unique en la matière. En témoignent leur grand engagement à travers des œuvres théologiques, leurs nombreux centres de recherches œcuméniques, leurs activités pastorales ininterrompues dans ce sens et une tentative du rétablissement de la communion avec les Églises d’origine (ce qui fut le cas de l’initiative, unique en son genre, de l’Église grecque catholique en 1996). Tout cela s’inscrivant dans le sillage du concile Vatican II et appuyé par l’engagement du Saint-Siège pour le rétablissement de la pleine communion entre les chrétiens. Les pages de cet article rendront compte de cette réalité.
[2] À cet égard, la déclaration de Balamand (1993) est décisive, nous en parlerons infra.
[3] Déjà, deux chrétiens du Moyen-Orient sur trois sont coptes orthodoxes. Quant aux communautés orthodoxes elles sont de même majoritaires en Jordanie et en Syrie. Les catholiques ne sont majoritaires qu’au Liban et en Irak.
[4] Alors que l’Église assyrienne renonça en 1975 à toute référence à Nestorius.
[5] Cependant, force est de constater que les Églises protestantes à travers le monde, surtout celles des Églises scandinaves, sont très investies pour le dialogue œcuménique au Moyen-Orient. Ces Églises fournirent durant de longues années, une grande partie des fonds nécessaires pour le fonctionnement du Conseil des Églises du Moyen-Orient.
[6] Il est possible de consulter le texte de la déclaration de Balamand sur le site Internet du Saint-Siège : http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_19930624_lebanon_fr.html
[7] Michel Hayek, Liturgie Maronite, Histoire et textes eucharistiques, Paris, Mame, 1964, p. xv.
[8] Jean Corbon, L’Église des Arabes, Paris, Cerf, 1977, p. 11.
[11] Le territoire historique du patriarcat d’Antioche couvre la plus grande partie du Moyen-Orient actuel.
[12] Youakim Moubarac, « Maronité, antiochénité, libanité », in Libanica, n° 34, 1992, publié dans : Georges Corm, Youakim Moubarac, un homme d’exception, , Beyrouth, Librairie Orientale, 2004, p. 101.
[15] Pour consulter les détails du projet, consulter : Youakim Moubarac, « Trois entreprises en Orient arabe », in Libanica, n° 24, 1987, publié dans : Georges Corm, Youakim Moubarac, un homme d’exception, op. cit., p. 113.
[16] Jean Corbon, op. cit., p. 9.
[19] Ce qu’elles ne manquent pas de faire lors de ces dernières années, notamment le Saint-Siège et les Églises protestantes engagées pour la cause du Conseil des Églises du Moyen-Orient.
[20] C’est-à-dire les Églises nées à partir d’un schisme dans une Église orthodoxe, comme les grecs catholiques, les syriaques catholiques ou les arméniens catholiques.
[21] Du point de vue orthodoxes, ces conciles considérés œcuméniques par les catholiques, notamment le Vatican I, constituent un grand problème pour le rétablissement de la communion. L’évêque libanais grec orthodoxe Georges Khodr ne cesse de le rappeler lors des rencontres œcuméniques, au sein desquels il est très actif. Il propose de les considérer comme conciles généraux, n’engageant que les catholiques.
[22] C’est-à-dire l’Église grecque orthodoxe, l’Église syriaque orthodoxe, l’Église arménienne orthodoxe, l’Église d’Orient (assyrienne) et l’Église maronite (la seule qui soit catholique dans cette catégorie).
[23] Pour plus de détails sur la question, consulter : Gaby Hachem, « Un projet de communion ecclésiale dans le patriarcat d’Antioche entre les Églises grec-orthodoxe et melkite-catholique », in Irenikon, 1999, vol. 72, n°. 3-4, p. 453-478
[24] L’Église catholique ne fait par exemple pas partie du Conseil œcuménique des Églises, mais y a juste un statut d’observateur.
[25] Par sa création, le CEMO remplaçait le Conseil des Églises du Proche-Orient, fondé dans les années 1960 et ayant comme membres les Églises protestantes moyen-orientales et l’Église syriaques orthodoxe.
[26] Gabriel Hachem, « Les enjeux et les espoirs de la relance du Conseil des Églises du Moyen-Orient », in POC 62, 2012, p. 80-89.
[27] Cf. l’article mentionné à la référence précédente et Antoine Fleyfel, « Chrétiens d’Orient : Œcuménisme, fin de partie ? », in Témoignage chrétien, supplément web n. 3414, 18 octobre 2010.
[28] Force est de constater que l’Œuvre d’Orient joue un rôle important à ce sujet, moyennant son aide et son appui aux Églises orientales catholiques.
|
|