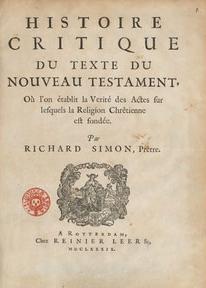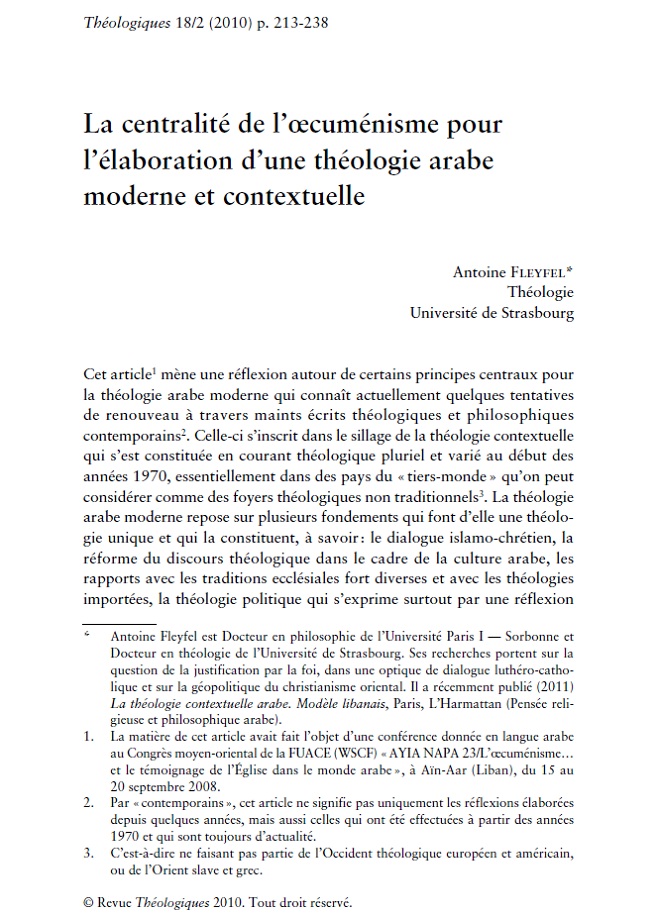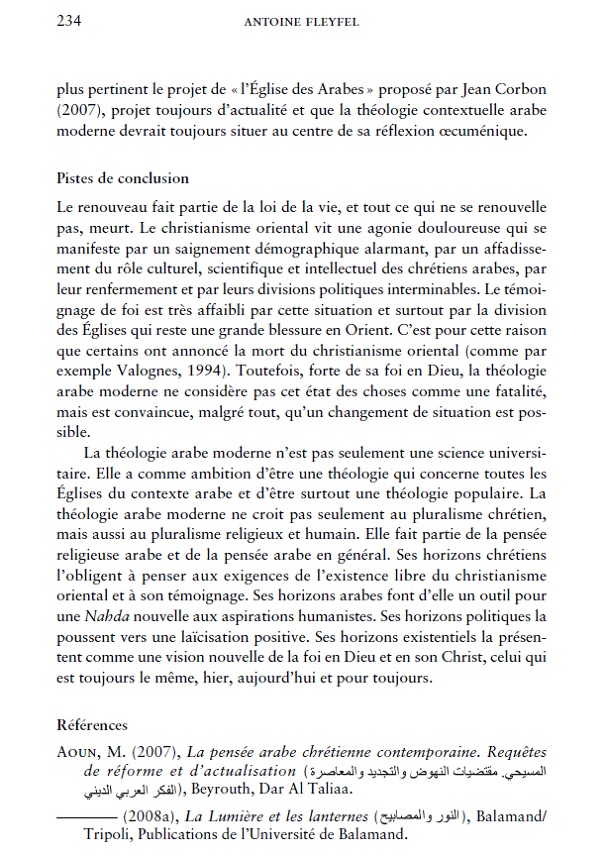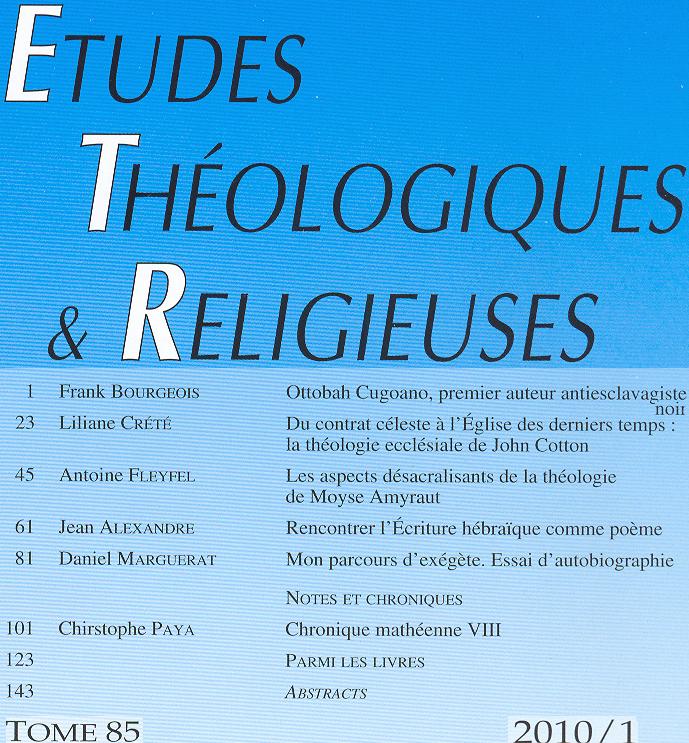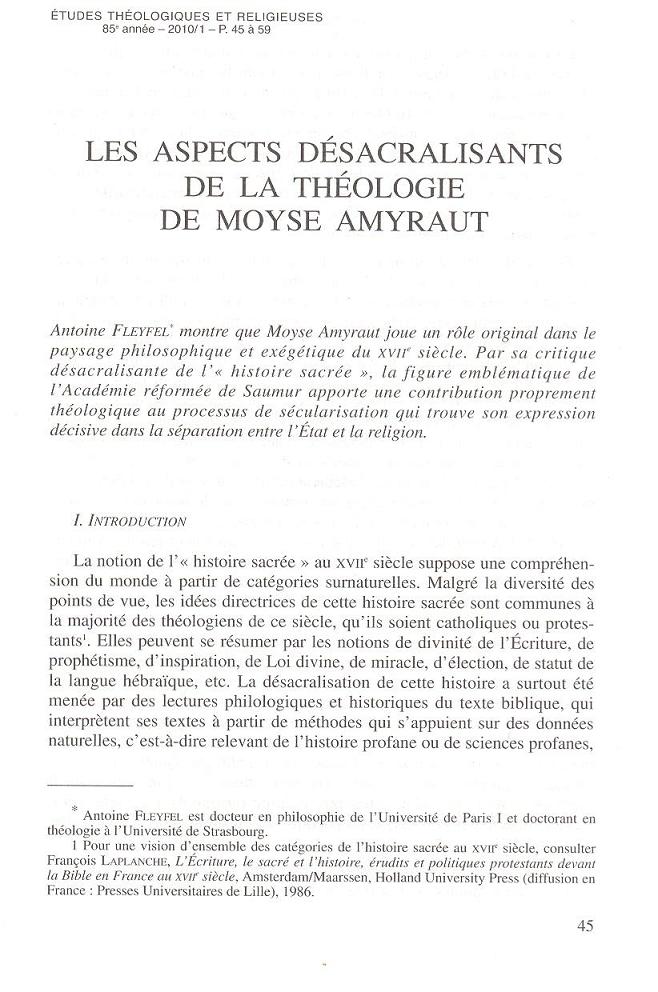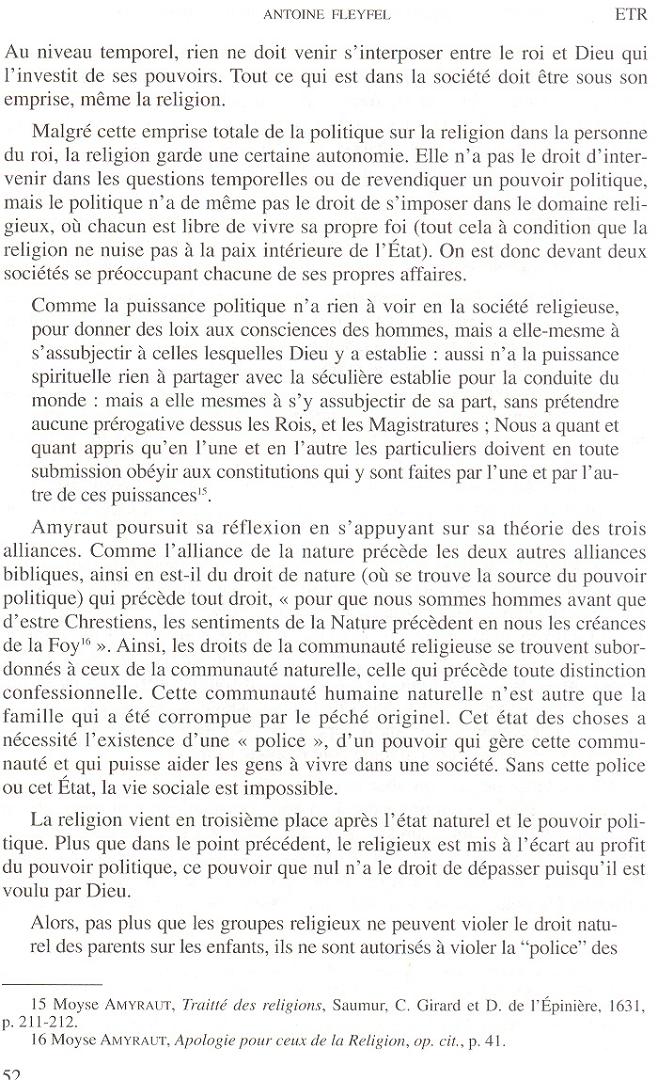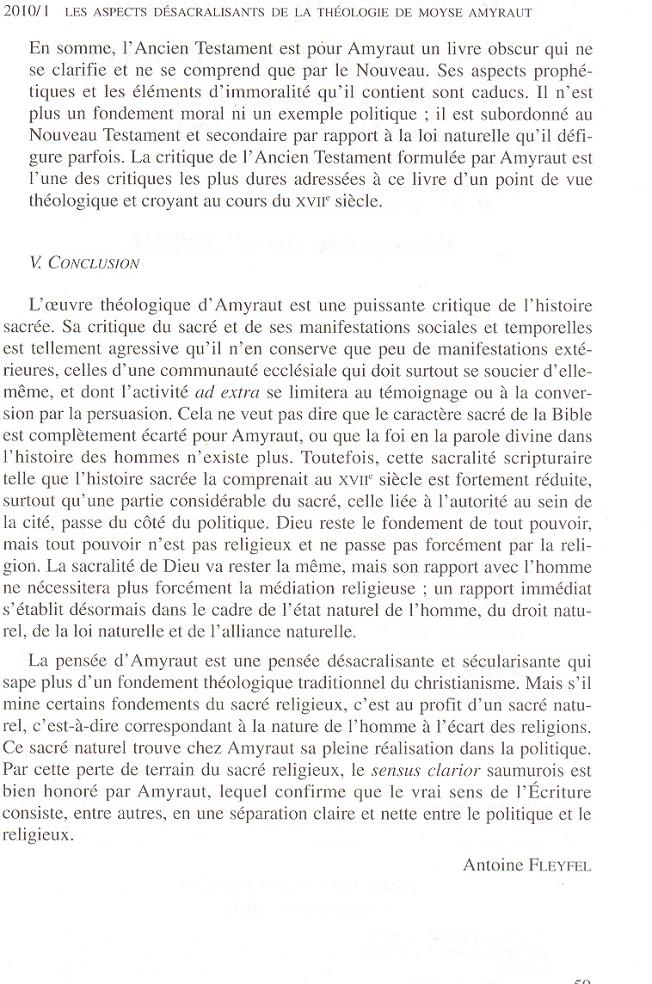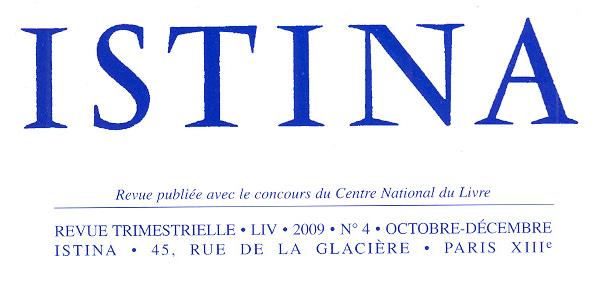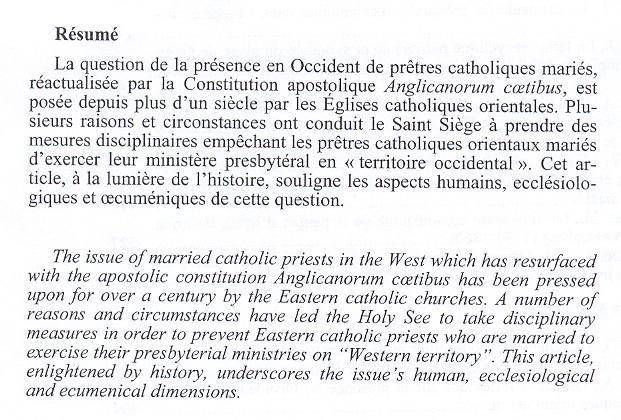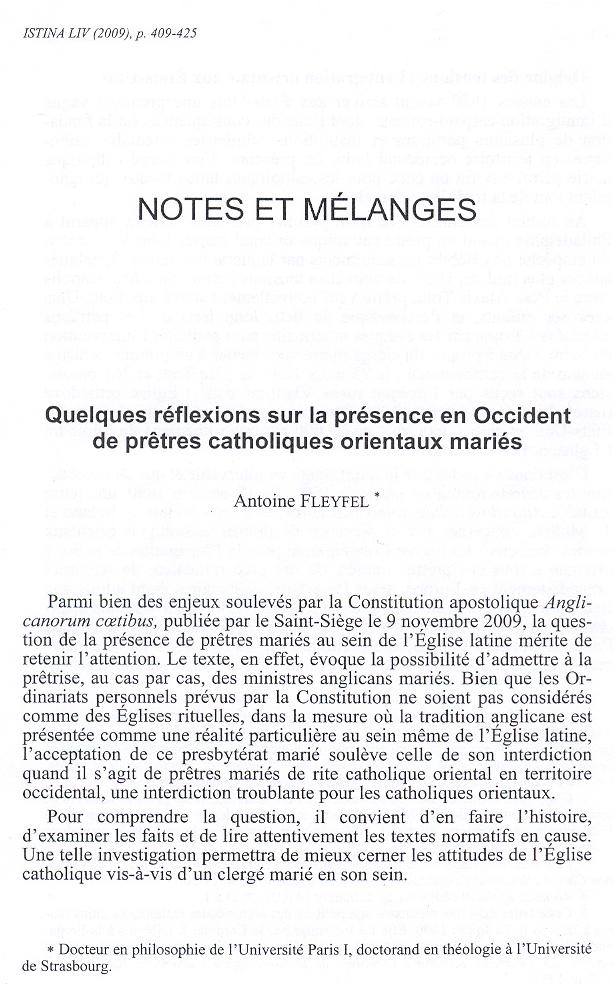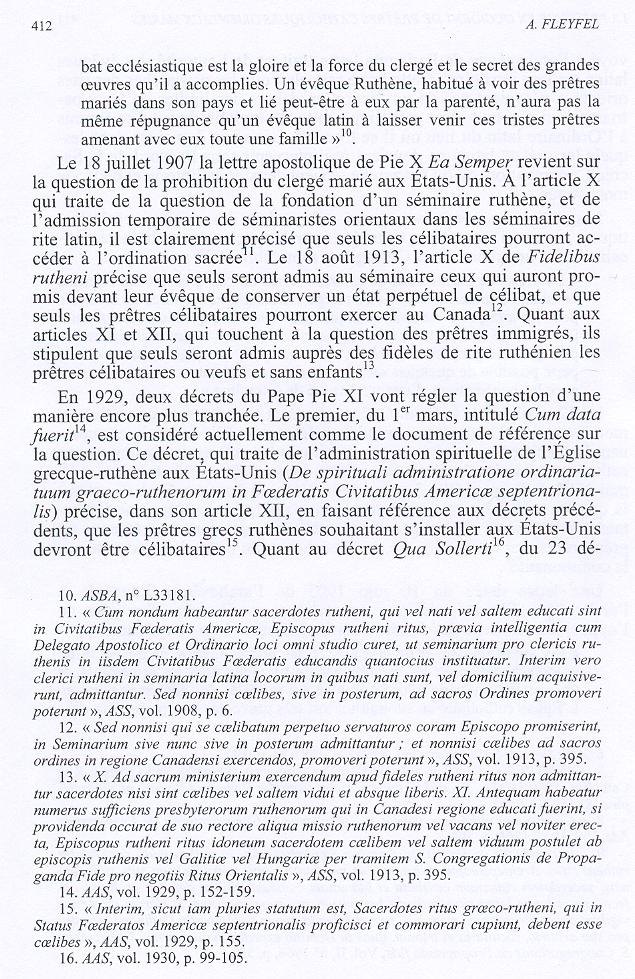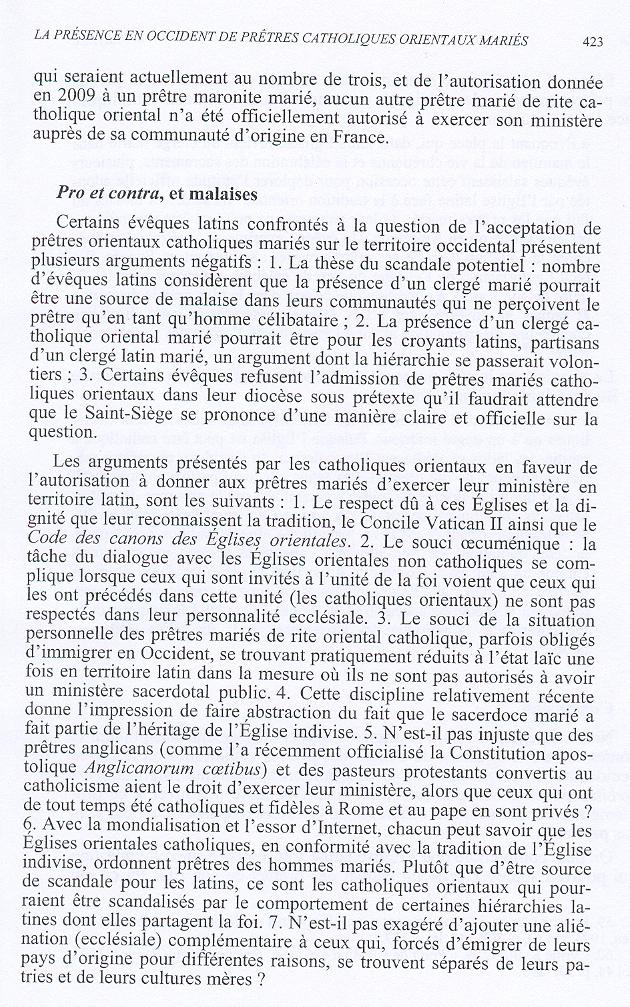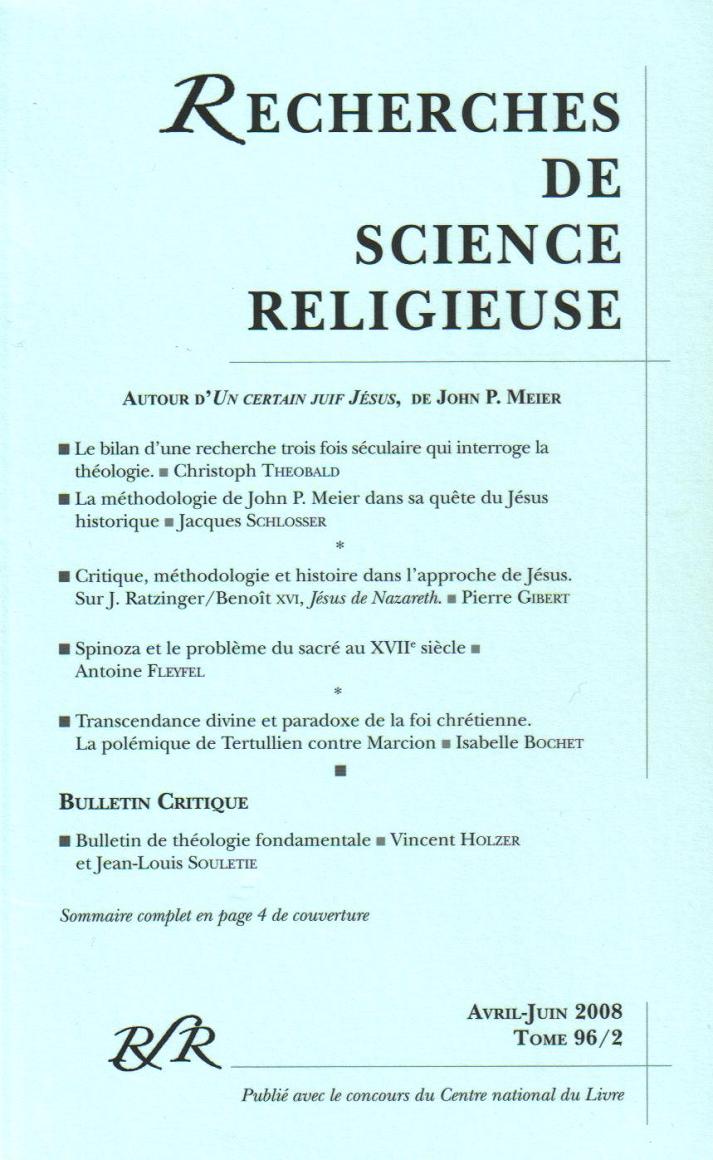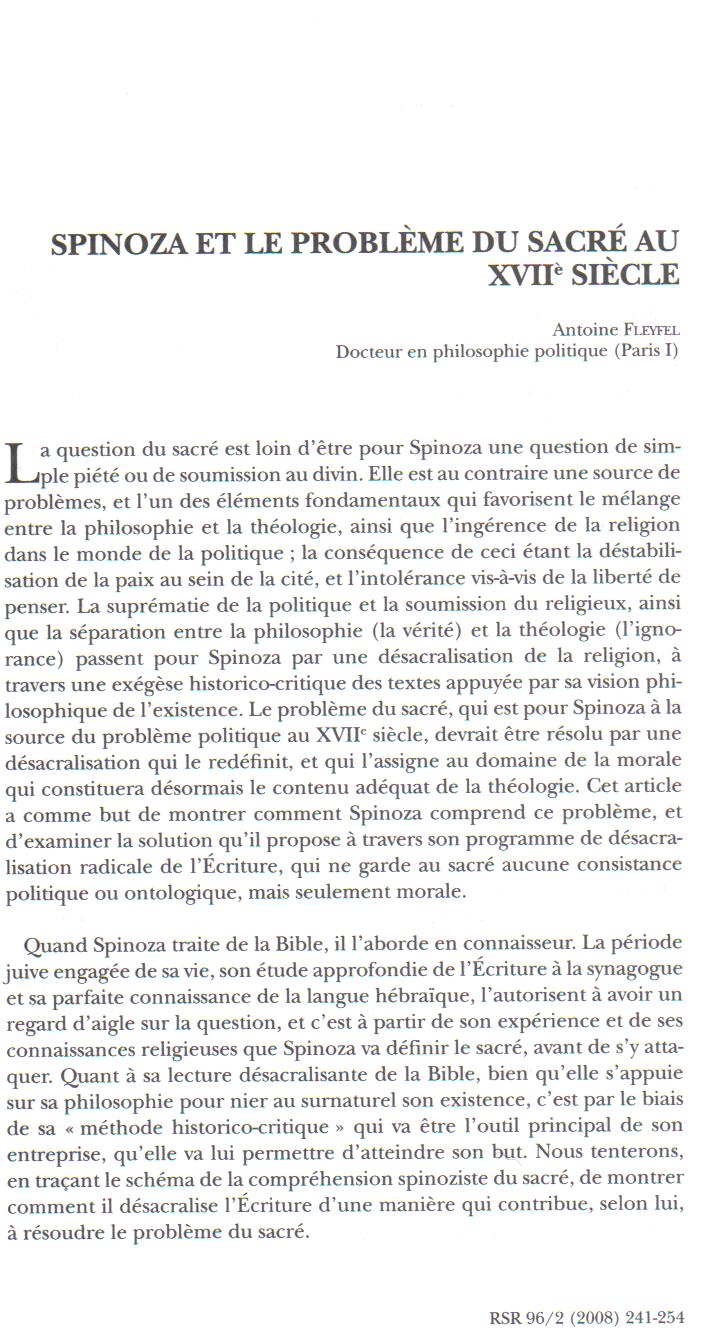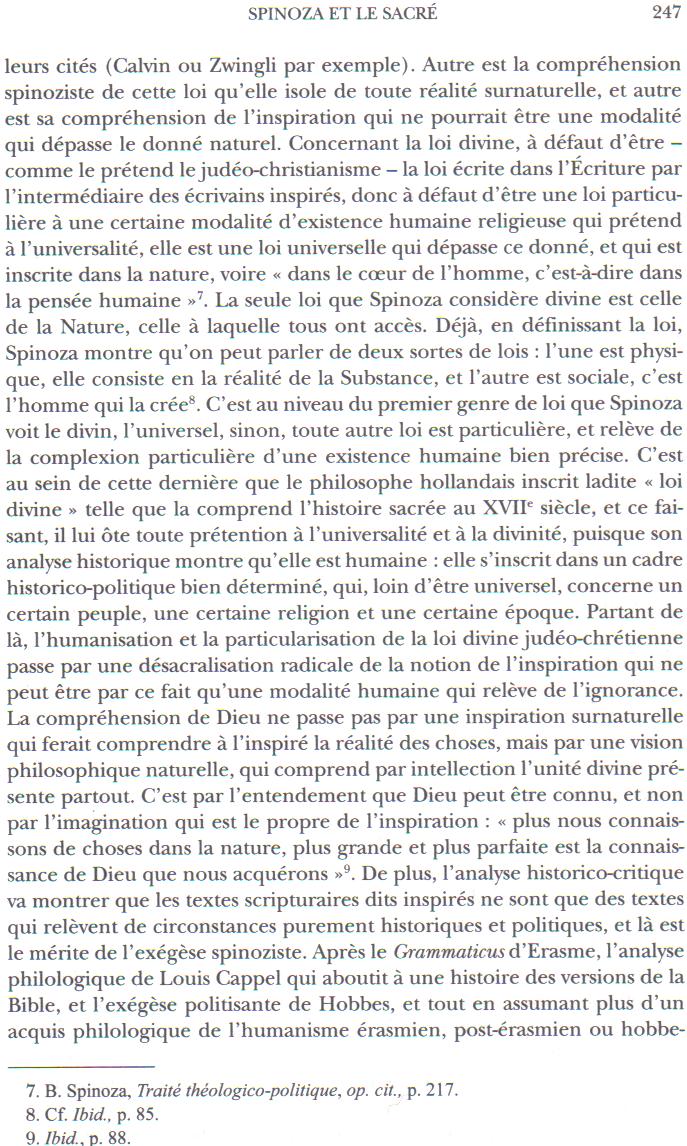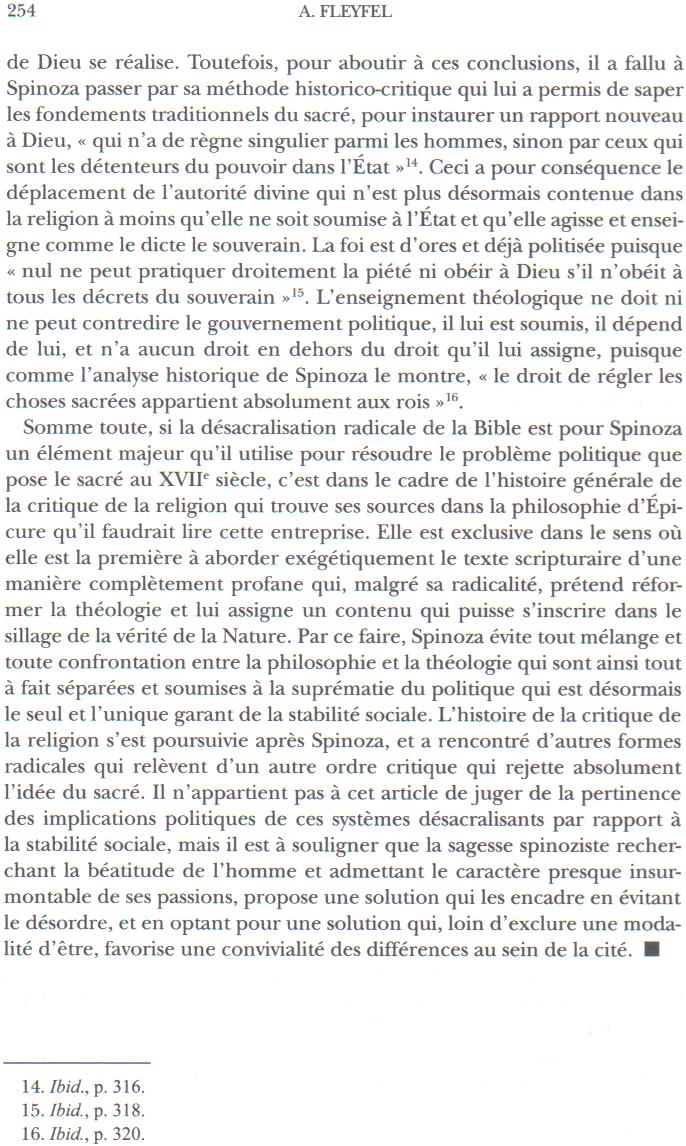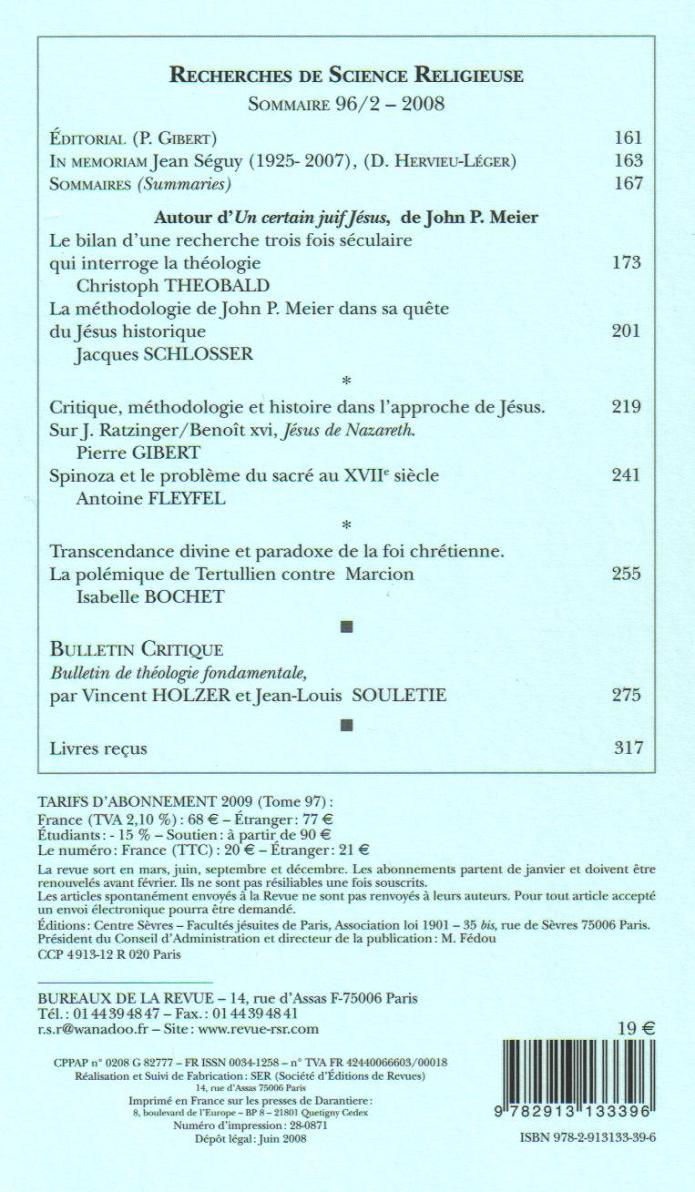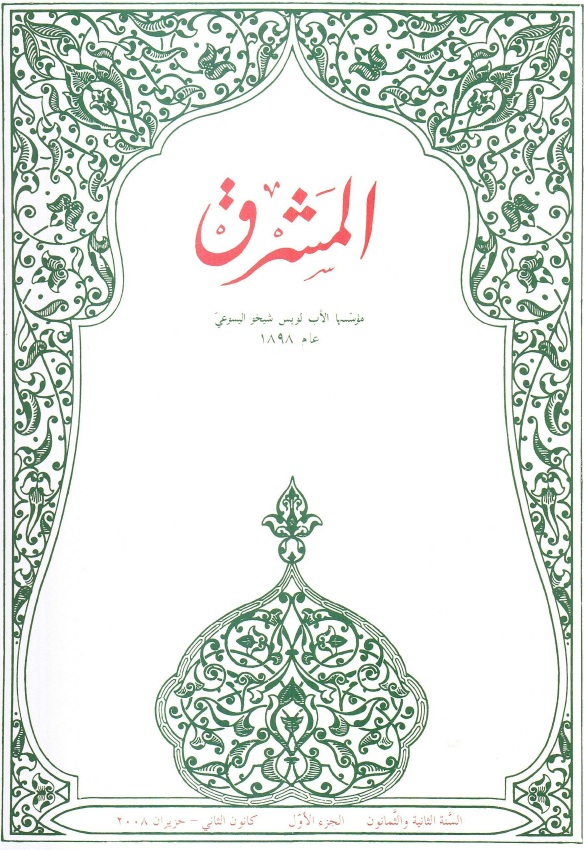|
|
Lien de la notice historique sur le site du Ministère de la Culture
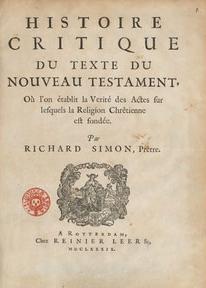
Auteur d’une œuvre abondante qui « juge la littérature religieuse du XVIIe siècle » (Margival, 1900), Simon a longtemps été absent de la kyrielle des théologiens du Grand Siècle, tels Bossuet, Arnauld, Nicole ou Pascal. Persécuté avec acharnement, aucun de ses livres n’est réédité au XIXe siècle. Pourtant, il fut un esprit universel qui a touché à tout ce qui concerne la Bible, la patristique, la liturgie, les sacrements et l’histoire. L’exégète sarcastique, au ton tranchant et moqueur, paye cher « le droit d’avoir raison contre tout le monde, sous le règne de Louis XIV » (Steinmann, 1985).
D’une importance qui l’égale à Érasme et Spinoza, Simon fut probablement le plus grand exégète du royaume de France, qui avait connu avant lui les travaux notoires de Cappel et de Morin. Des éléments de son exégèse vont traverser les siècles, et guider des spécialistes en charge des traductions françaises de la Bible de Jérusalem, de la Bible du centenaire ou de celle d’Édouard Dhorme.
Richard Simon naquit à Dieppe, le 13 mai 1638. Il fit partie de la congrégation de l’Oratoire où il connaîtra Malebranche. Étudiant l’hébreu avec passion, il lut les versions originales de la Bible dans une perspective historique qui écarte les méthodes scolastique et cartésienne. Cela lui causa beaucoup d’ennuis avec son ordre, surtout lorsqu’on trouva en sa possession des livres mis à l’index, comme la Bible polyglotte de Londres. Longtemps avant le texte de la TOB, Simon eut l’idée d’une traduction œcuménique de la Bible qu’il négociait avec les protestants, ce qui lui valut les foudres des bénédictins.
L’Histoire critique du Vieux Testament est incontestablement le chef-d’œuvre de Simon. Cet ouvrage est le premier qui aborde, en langue française, les problèmes exégétiques vétérotestamentaires. Cependant, plusieurs thèses suggérées ne furent guère appréciées par une époque très méfiante de la critique biblique. L’exégète de l’ancienne France avançait des idées qui irritaient les orthodoxies religieuses de son temps, notamment la thèse des écrivains publics, annalistes de la théocratie juive. Connus surtout comme prophètes, et investis d’une mission publique, ils écrivirent l’histoire sacrée du « peuple élu ». Cette théorie va de pair avec ce qu’affirme le cinquième chapitre de l’œuvre : Moïse n’est pas l’auteur unique du Pentateuque. De telles propositions, effectuées dans un cadre critique affaiblissant l’autorité sacralisée de la version massorétique de l’Écriture, auront des conséquences immédiates : le livre fut condamné, et Simon, exclu de l’Oratoire, fut durement attaqué par Bossuet.
La ressemblance de certains éléments de sa méthode avec ceux de Spinoza, le fit passer pour son héritier, le « Spinoza catholique ». Or Spinoza est l’un des seuls auteurs qu’il conteste explicitement dans ses écrits, essentiellement parce que le philosophe qui réfute la Révélation, réduit le contenu de la Bible à la seule loi morale naturelle. Le chrétien Simon, croyant en la révélation divine et en l’inspiration contenue d’une manière globale dans la Bible, ne pouvait être spinoziste.
Sans partisans ni disciples, il se retira en Normandie et devint curé de campagne. Il mourut le 11 avril 1712, quelques jours après avoir brûlé des manuscrits dont nous ne connaîtrons probablement jamais le contenu. Richard Simon fut enterré à l’église de Dieppe où il avait été baptisé.
Antoine Fleyfel
docteur en théologie (Strasbourg)
docteur en philosophie (Paris 1 – Sorbonne)
Extraits
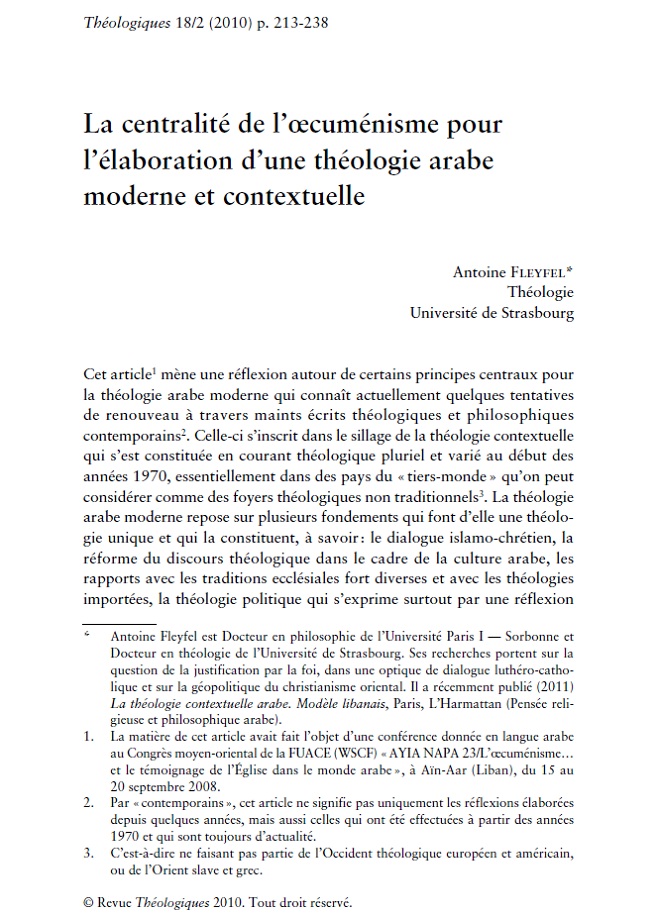
…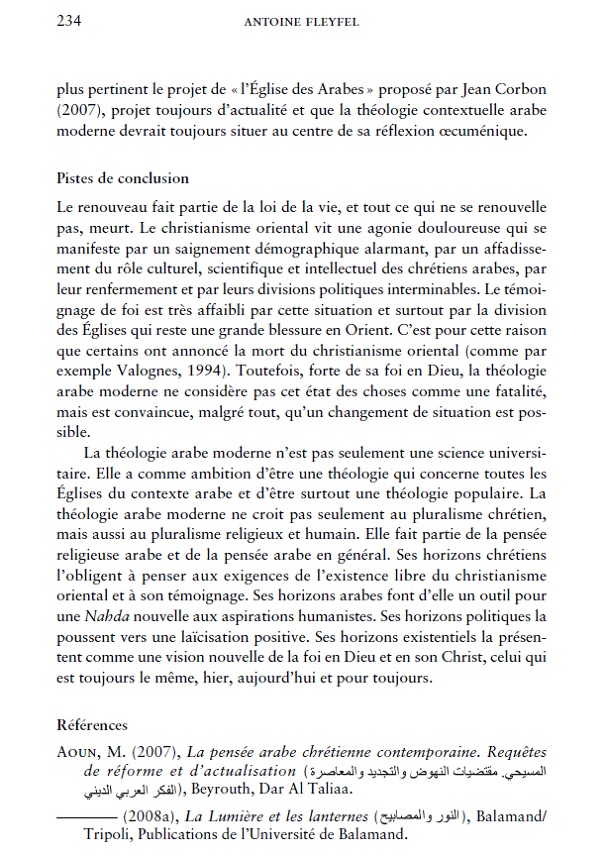
Article scientifique paru sur une année, en quatre parties, dans la revue de l’Œuvre d’Orient. N° 764 (juillet, août, septembre 2011), n° 765 (octobre, novembre, décembre 2011), n° 766 (janvier, février, mars 2012) et n° 767 (avril, mais, juin 2012).

Introduction
Il n’est pas besoin d’effectuer de scrupuleuses investigations pour constater le grand intérêt que porte le Saint-Siège pour le Moyen-Orient d’une manière générale, et pour les chrétiens d’Orient d’une manière très particulière. Plusieurs éléments mettent cela en évidence, comme :
1- Les visites des pontifes romains au Moyen-Orient : Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI.
2- Les prises de position à l’endroit de la violence au Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien.
3- Les synodes, écrits et discours qui abordent explicitement la question de la présence chrétienne en Orient ainsi que les thèmes qui s’y rapportent (dialogues œcuménique et interreligieux, droits de l’homme, liberté de conscience, etc.).
La compréhension de l’action diplomatique actuelle du Saint-Siège en faveur des chrétiens d’Orient passe par plusieurs médiations, comme l’examen de la nature de l’action diplomatique du Saint-Siège, la prise en compte de certains éléments historiques et l’analyse de certains écrits et activités pontificaux.
1- Nature de l’action diplomatique du Saint-Siège
Église catholique, Saint-Siège et État de la Cité du Vatican
Il est actuellement courant d’utiliser, notamment dans les milieux médiatiques, le vocable « Vatican » pour parler de l’action diplomatique du Saint-Siège, mais aussi de la gouvernance de l’Église catholique ou de l’État de la Cité du Vatican. Si cette utilisation n’est pas tout à fait fausse, elle reste porteuse de certaines imprécisions et confusions qu’il est nécessaire de clarifier.
Le pape unit en sa personne trois fonctions différentes : il est le primat de l’Église catholique avec juridiction sur « les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble»[1], le monarque absolu de l’État du Vatican et l’évêque ou le chef du Saint-Siège[2] qui a un statut de sujet souverain de droit international. Cependant, même si une seule et même personne jouit de ces trois pouvoirs, il est nécessaire de distinguer l’Église catholique du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican.
Si l’Église catholique est la communauté des baptisés ayant comme pasteur suprême l’évêque de Rome, le Saint-Siège est l’incarnation du pouvoir spirituel de cette Église[3], de la souveraineté abstraite qu’a le pape sur plus d’un milliard de catholiques à travers le monde. Quant à l’État de la Cité du Vatican, il est le support territorial du Saint-Siège – sa représentation temporelle –, peuplé de presque 900 habitants pour une superficie de 44 hectares. Effectivement, les accords du Latran (1929)[4] avaient mis fin à la « Question romaine »[5], reconnu la souveraineté du Saint-Siège et lui avaient créé un support territorial, l’État de la Cité du Vatican. Celui-ci existe pour assurer au Saint-Siège une indépendance réelle et visible dans son gouvernement de l’Église universelle et dans ses activités.
Cependant, ce n’est pas avec l’État de la Cité du Vatican que les États entretiennent des liens diplomatique, mais avec le Saint-Siège qui est sujet de droit international, qui siège au sein de certaines organisations internationales[6] et qui possède à l’Organisation des Nations unies (ONU) le statut d’observateur permanent. Tous les ambassadeurs des États, sont accrédités près le Saint-Siège et non auprès de l’État de la Cité du Vatican. Si le latin est la langue de l’Église catholique et la langue juridique de l’État, l’italien est la langue véhiculaire de l’État de la Cité du Vatican, l’allemand la langue des gardes suisses et le français la langue diplomatique du Saint-Siège.
La diplomatie du Saint-Siège a des sources lointaines qui la ramènent au premier millénaire, lorsque les papes envoyaient leurs légats, vers les différents royaumes de la chrétienté, afin de mener des négociations d’ordre international. Le Saint-Siège adapte sa diplomatie, au XVIe siècle, à l’émergence de l’État-nation : les premières nonciatures apparaissent. Depuis les accords du Latran, son rôle diplomatique international est pleinement reconnu et il a un statut égal à celui des autres États. Il est actuellement la seule autorité religieuse ayant un tel statut légal international.
Une puissance diplomatique « soft »
La négociation internationale menée par l’Église catholique est l’activité diplomatique du Saint-Siège. Cependant, l’activité de cette diplomatie est d’une nature différente que celle des activités diplomatiques des États, notamment des puissances occidentales, pour les raisons suivantes :
– Les nonces apostoliques (ambassadeurs du Saint-Siège) sont avant tout, les représentants de l’Église catholique, plus que d’un territoire.
– Le Saint-Siège n’est pas une puissance temporelle[7] ou géopolitique, mais une puissance spirituelle et morale. C’est à partir de cela qu’il est intégré dans les relations internationales[8].
– Les motivations principales du Saint-Siège sont : la protection des chrétiens, notamment des catholiques, et la promotion des valeurs de la justice, de la paix et des droits de l’homme.
Ainsi, il convient de reprendre la description que fait Theodoros Koutroubas de l’hypothèse qualifiant la puissance diplomatique du Saint-Siège comme « soft », parce que « privée de toute faculté d’exercice de pouvoir coercitif si ce n’est celui de l’appel à l’opinion publique […] dans le cadre d’un conflit international impliquant de puissances conventionnelles »[9]. Cependant, ce fait ne devrait pas être envisagé comme un handicap, car le Saint-Siège a été capable de prouver les potentialités de son activité diplomatique, notamment à travers le rôle qu’il a joué pour l’effondrement du bloc communiste. Il est à rappeler que malgré le petit nombre de son appareil diplomatique composé de 40 personnes à la deuxième section de la secrétairerie d’État, le Saint-Siège dispose, à travers 4500 évêques et un très grand nombre d’institutions de l’Église catholique, un relais d’information et de manœuvre sans égal.
2- Un intérêt ancien pour l’Orient
L’engagement du Saint-Siège en faveur des chrétiens d’Orient fait partie de ses combats principaux. Ainsi, on peut lire sur le site du Ministère français des Affaires Étrangères :
Le Saint Siège reste engagé dans des dossiers essentiels : au Moyen-Orient, la situation des chrétiens d’Orient est devenue sa préoccupation majeure, et notamment leur exode malgré l’implication de la communauté internationale. Le Liban est également une priorité car il est emblématique d’une coexistence possible entre communautés chrétiennes ou musulmanes. Représenté à la conférence d’Annapolis, le Saint Siège est favorable à une approche globale du processus de paix et souhaite un statut international pour Jérusalem et les lieux saints[10].
Mener une investigation historique sur l’intérêt du Saint-Siège pour l’Orient pourrait nous ramener aux croisades et à la protection des Lieux Saints, aux relations étroites avec les maronites dès le XIIe, au mouvement de l’uniatisme ou aux interventions médiates et immédiates auprès de l’Empire ottoman en faveur des communautés catholiques. Le Saint-Siège n’a pas rompu avec cette tradition à l’époque contemporaine. Son action diplomatique en faveur des chrétiens d’Orient s’est perpétuée sous l’impulsion des derniers papes. Cependant, il doit faire face, avec la création de l’État d’Israël, la guerre libanaise et les violences confessionnelles en Iraq et en Égypte, à de nouveaux défis inédits d’une grande complexité.
La création de l’État d’Israël a été perçue comme une catastrophe par les musulmans arabes et « la crainte de voir les autorités islamiques (et encore plus la rue) donner une connotation religieuse à l’alliance entre Tel-Aviv et la superpuissance occidentale ‘chrétienne’ fut […] un des soucis constants du Saint-Siège »[11]. Celui-ci est persuadé que la continuation de la présence chrétienne au Moyen-Orient dépend de l’engagement des chrétiens orientaux, avec les musulmans, pour l’avenir de leur terre commune. Ainsi, le Saint-Siège invite les chrétiens orientaux à montrer que leur présence n’est pas de nature opposée à leurs pays, mais qu’ils sont un facteur de progrès et de développement de la société majoritairement musulmane dans presque tous les pays (le Liban excepté). En outre, il doit faire face à des attitudes confessionnelles, d’autonomie ecclésiale, à des tendances séparatistes occidentales et à la difficulté d’expliquer la nécessité du dialogue catholico-judaïque à une population pour qui Israël est l’ennemi. Il est en fin de compte nécessaire pour le Saint-Siège de trouver l’équilibre entre de bonnes relations avec les juifs et Israël (en raison surtout de son intérêt pour les Lieux Saints), et la promotion de l’entente islamo-chrétienne (facteur incontournable pour présence chrétienne en Orient). Cela est l’un des défis majeurs de la diplomatie Vaticane[12].
La guerre libanaise fut la cause d’un grand malaise au Vatican dans les années 1970, puisque la seule puissance catholique au Moyen-Orient, les maronites, se sont engagés dans une guerre qui peut très facilement être interprétée sous le signe de l’hostilité vis-à-vis de l’islam. Cela nuisait aux rêves de la papauté qui voulait faire du Liban, identifié avec l’avenir des chrétiens orientaux, un modèle de convivialité pour les autres pays de la région, et rendait les maronites impopulaires parmi les musulmans, ce qui aggravait le danger d’un islamisme montant, très dangereux aux yeux du Vatican pour l’avenir des chrétiens orientaux[13].
Le malaise du Saint-Siège s’amplifie à l’issue de l’alliance américano-syrienne face à l’ennemi irakien. Celle-ci se concrétise au Liban par un envahissement des régions chrétiennes sous le control des divisions de l’armée libanaise du général Michel Aoun le 13 octobre 1990 :
L’alliance de l’unique super-puissance avec une Syrie qui cachait peu son désir de dominer complètement le seul pays moyen-oriental où les catholiques pouvaient toujours prétendre aux plus hautes fonctions étatiques, et avec le Royaume saoudien où toute pratique du culte chrétien était strictement interdite, persuadait le Pontife que les rapports alarmistes de ses collaborateurs dans la région étaient bien fondés, et que le nouvel ordre géopolitique au Moyen-Orient, sonnerait plutôt la fin des sociétés pluriconfessionnelles et l’extinction des communautés chrétiennes locales[14].
C’est dans le cadre de ces éléments historiques qu’il convient de comprendre l’Exhortation Apostolique de Jean-Paul II, « Une espérance nouvelle pour le Liban »[15] (1997), née au cours de l’Assemblée spéciale pour le Liban du Synode des Évêques (convoquée en 1991, à la fin de la guerre). D’aucuns auraient pu peut-être s’étonner du fait que le Saint-Siège réunisse un Synode consacré à un seul pays, alors que les Synodes sont normalement réunis pour s’intéresser aux situations de régions géographiques qui dépassent de loin la minuscule étendue du Pays des cèdres (10 452 Km2). Cependant, comprise à la lumière de la politique vaticane générale en faveur des chrétiens d’Orient, l’Exhortation prend tout son sens et situe le christianisme libanais au centre de la vision qu’a le Saint-Siège de l’avenir du christianisme moyen-oriental. Les chrétiens du Liban apparaissent comme la clef de voûte et la condition sine qua non de tout redressement sérieux possible pour les chrétiens dans la région.
Il est intéressant de souligner à cet endroit quelques éléments majeurs de ce document qui rappelle que le Liban « est un pays vers lequel les regards se tournent souvent, [et au sein duquel] les catholiques sont particulièrement appelés à servir le bien commun de la cité terrestre en tirant de la foi leur inspiration et les principes fondamentaux pour la vie en société » (1). Cependant, l’effort de reconstruction du Liban après la guerre n’est pas le propre des catholiques, puisqu’il leur incombe de collaborer, à cet effet, dans un esprit œcuménique, avec les chrétiens orthodoxes et protestants, et dans un esprit de dialogue interreligieux, avec les communautés musulmanes différentes.
Tout en s’inscrivant dans le sillage de l’effort diplomatique pour la préservation du christianisme en Orient, l’Exhortation ne s’intéresse pas qu’à ce volet – essentiel – pour le Saint-Siège. Principalement pastorale, elle traite de beaucoup de questions qui ont traits aux conditions internes du renouveau des Églises catholiques au Liban. Celui-ci touche à tous les domaines vitaux pour la vie des Églises patriarcales, comme l’enseignement secondaire et universitaire, la recherche, la liturgie, la théologie, l’action pastorale, la formation des prêtres et des laïcs, l’engagement dans la société, l’engagement politique, les biens des Églises, etc. En outre, l’exhortation laisse deviner le malaise provoqué par la guerre libanaise au Saint-Siège, et sa volonté d’en finir définitivement avec cette étape, nuisible à son sens à la présence chrétienne au Moyen-Orient. Ainsi, Jean-Paul II rappelle que « l’Église catholique au Liban a beaucoup pâti de la division de ses fils, particulièrement durant les récentes années de guerre. Elle en a été déchirée même de l’intérieur » (10). C’est pour cela qu’il invite à une conversion :
Le drame vécu durant ces dernières années par l’Eglise catholique au Liban fut une occasion cruelle pour elle d’éprouver la nécessité de la conversion, pour vivre l’Evangile, pour demeurer unie, pour dialoguer en vérité avec les autres Eglises et Communautés chrétiennes en vue d’avancer vers la pleine unité, pour construire aussi, avec les autres citoyens, une société capable de dialogue ouvert, de convivialité et d’attention aux autres, surtout aux frères les plus démunis (35).
Cependant, beaucoup d’éléments de facture pastorale s’inscrivent d’une manière évidente dans le cadre des grands traits de la diplomatie du Saint-Siège[16] :
1- Le dialogue œcuménique : celui-ci est nécessaire, parce que la division des chrétiens affaiblit leur témoignage. D’où la nécessité de déployer tous les efforts nécessaires pour un rapprochement œcuménique entre les Églises catholique, orthodoxes et protestantes.
2- Le dialogue interreligieux : « L’Islam et le Christianisme ont en commun un certain nombre de valeurs humaines et spirituelles incontestables » (13). Le dialogue interreligieux s’avère être dans cette perspective un antidote aux dangers de l’islamisme à l’endroit de la présence chrétienne au Moyen-Orient.
3- Le dialogue de vie entre les chrétiens et les musulmans dans le but de l’édification d’une société juste : « Un vrai dialogue entre les croyants des grandes religions monothéistes repose sur l’estime mutuelle, afin de protéger et de promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté » (89). Cette collaboration saine entre les chrétiens et les musulmans devrait faire du Liban l’exemple de convivialité pour tous les pays de la région : « Le dialogue et la collaboration entre chrétiens et musulmans au Liban peut aider à ce que, dans d’autres pays, se réalise la même démarche » (93).
4- Une insistance sur le respect des droits de l’homme et de la liberté de conscience : « L’État est le premier garant des libertés et des droits de la personne humaine » (114). L’Exhortation s’oppose par cela aux pressions sociales, voire aux menaces éventuelles qu’affronterait un musulman qui se convertit au christianisme.
5- L’action pour limiter l’émigration, mais aussi l’importance de maintenir des liens étroits avec les émigrés : « Intensifier les relations entre les communautés catholiques de la diaspora et les différents patriarcats au Liban. En effet, une communauté locale ne peut pas vivre coupée de son centre d’unité sans courir le risque de s’ériger dans une totale indépendance » (83).
6- La mise en garde contre toute forme d’extrémisme : « Le réveil de formes variées d’extrémisme est aussi profondément inquiétant et ne pourrait que desservir l’unité du pays, freiner le nouvel élan qu’il convient de lui donner et gêner la convivialité entre toutes les composantes de sa société » (14).
In fine, tout en délivrant son message essentiellement pastoral, Jean-Paul II lui ouvre tout un horizon politique qui n’est pas sans rappeler ses visites pastorales à dimension fortement politique, de la Pologne communiste, sa terre natale. Dans des conditions qu’on a longtemps décrites comme relevant d’une « frustration chrétienne », et dans le sillage de l’absence des leaders chrétiens les plus influents, Michel Aoun et Amine Gemayel exilés en France, et Samir Geagea emprisonné au Ministère de la Défense, Jean-Paul II délivrait en 1997 un message d’espoir aux chrétiens libanais, en les invitant à mettre de côté leur frustration, et à se renouveler de manière à se réengager de nouveau dans le monde arabe, et d’avoir une présence durable.
3 – Le pontificat de Benoît XVI et les chrétiens d’Orient
Le pèlerinage en Terre Sainte (8-15 mai 2009)
Les débuts du pontificat de Benoît XVI sont marqués par des évènements qui ont été interprétés comme des erreurs diplomatiques : le discours de Ratisbonne (septembre 2006) qui a suscité de vives réactions politiques et religieuses dans le monde musulman[17], et la réhabilitation de l’évêque intégriste négationniste Williamson (janvier 2009) qui a heurté le monde juif.
La visite du pape en Terre Sainte (Jordanie, Territoires Palestiniens, Israël), du 8 au 15 mai 2009 est bien liée à ces deux événements. Elle pourrait être considérée comme une clarification majeure, voire un rappel des positions du Saint-Siège aux endroits de l’islam et des musulmans, du judaïsme et des juifs. Cependant, c’est dans le cadre d’un apaisement du monde musulman et de l’État d’Israël, et d’un rappel des positions du Saint-Siège en faveur de la cause palestinienne, que le pape mène avec la plus grande prudence diplomatique un pèlerinage qui a comme but principal l’appui des chrétiens d’Orient.
Cette visite complexe qui a duré huit jours s’est effectuée dans une ambiance de tensions plus vives que celles qui existaient lors de la visite de Jean-Paul II en 2000[18]. Même si le pape donnait à sa visite un sens spirituel[19] la dimension politique était inévitable : «Chaque journée, chaque geste, chaque rencontre et chaque visite : tout aura une connotation politique»[20], disait Fouad Twal, le patriarche latin de Jérusalem. De plus, plusieurs facteurs étaient sujets à tensions, notamment la récente offensive d’Israël contre le Hamas à Gaza (1300 morts palestiniens entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009), l’affaire Williamson et l’opposition à la béatification de Pie XII, accusé d’avoir gardé le silence durant la Shoah.
Dans son entretien aux journalistes, accordé au cours de son vol en direction de la Terre Sainte le 8 mai 2009, Benoît XVI rappelait le caractère de l’action diplomatique du Saint-Siège, fondement de son appui pour les chrétiens d’Orient : « Je cherche certainement à contribuer à la paix non en tant qu’individu mais au nom de l’Église catholique, du Saint-Siège. Nous ne sommes pas un pouvoir politique, mais une force spirituelle et cette force spirituelle est une réalité qui peut contribuer aux progrès du processus de paix ». Et d’ajouter, afin de souligner le but essentiel de son pèlerinage : « Nous voulons surtout encourager les chrétiens en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient à rester, à apporter leur contribution dans leurs pays d’origine »[21]. C’est dans ces perspectives que trois messages politiques majeurs peuvent être relevés lors cette visite :
1- Rassurer le judaïsme et l’État d’Israël sur le fait que le Saint-Siège ne professe aucune forme d’antisémitisme et s’y oppose. C’est dans ce cadre qu’il convient de comprendre la visite de Benoît XVI au mémorial des Victimes et des Héros de la Shoah, le Yad Vashem à Jérusalem. Le pape y exprime sa solidarité avec le peuple juif et reconnaît les horreurs perpétrées pendant la Shoah : « Que les noms de ces victimes ne périssent jamais ! Que leur souffrance ne soit jamais niée, discréditée ou oubliée ! »[22]. De plus, Benoît XVI a rappelé le vendredi 15 mai 2009 à l’Aéroport International Ben Gurion – Tel Aviv, « que l’État d’Israël a le droit d’exister, de jouir de la paix et de la sécurité à l’intérieur de frontières reconnues internationalement »[23].
2- Tourner définitivement la page de Ratisbonne et approfondir les relations avec les musulmans. Les contacts avec ces derniers sont plus importants qu’en 2000. Benoît XVI reste effectivement plus longtemps que son prédécesseur en Jordanie[24], et devient le premier pape à se rendre au Dôme du Rocher (Jérusalem), le troisième lieu saint de l’islam.
3- Plaider en faveur de la solution des deux États. Le pape l’a dit d’une manière très claire le mercredi 13 mai 2009 au Chef de l’Autorité palestinienne : « Le Saint-Siège soutient le droit de votre peuple à une patrie palestinienne souveraine sur la terre de vos ancêtres, sûre et en paix avec ses voisins, à l’intérieur de frontières internationalement reconnues ». Le Souverain Pontife a pour l’occasion dénoncer le « mur de sécurité » bâti par l’État d’Israël autour des Territoires palestiniens : « Jérusalem (…) est entourée d’un mur d’apartheid qui empêche le peuple de vivre librement, à Gaza, en Cisjordanie, de se rendre à l’église du Saint-Sépulcre et à la mosquée Al Aqsa »[25]. Et d’ailleurs, la visite que le pape a rendue au camp de réfugiés palestinien d’Aïda, à l’entrée de Bethléem est plus que significative puisqu’il s’agit de l’un des plus anciens camps[26]. S’y rendre symbolise, entre autres, le retour à la racine du drame vécu par le peuple palestinien. Quant à sa déclaration de prier pour la levée du blocus de Gaza, il n’y a pas de doute qu’elle fut une désagréable surprise pour Israël qui avait espéré une visite strictement spirituelle.
Insister à plusieurs reprises sur ces trois positionnements politiques crée les conditions nécessaires pour l’action diplomatique du Saint-Siège en faveur des chrétiens d’Orient. Cependant, il insistera plus, durant ce voyage, sur la présence en Terre Sainte, et sur les difficultés qu’affrontent les chrétiens qui habitent toujours dans les endroits les plus sacrés du christianisme. L’Église catholique déplore en effet les difficiles conditions de vie des chrétiens, majoritairement arabes, qui représentent 2% des sept millions d’habitants d’Israël. Le Saint-Siège cherche toujours, depuis l’établissement des liens diplomatiques avec Israël en décembre 1993, à avoir un libre accès aux Lieux Saints et la possibilité d’agir pastoralement, en Terre Sainte, sans limitations ni empêchements. De surplus, la construction du « mur de sécurité » a causé la détérioration de la situation des chrétiens à Bethléem et aux alentours, et l’immigration, sur fond économique, ne cesse de s’aggraver. Il y a toutes les semaines des familles qui immigrent en Amérique, ce qui fait que les chrétiens représentent moins de 15% des habitants de Bethléem[27].
Face à cette situation alarmante, le pape consacre la part du lion de son voyage à consolider les communautés chrétiennes en Jordanie, dans le Territoire palestinien et en Israël. Il n’est pas question de déserter cette terre, de démissionner de la société, de quitter le Moyen-Orient, puisque le christianisme a toujours un rôle majeur à y jouer, notamment entre les juifs et les musulmans, et un témoignage à rendre sur cette terre des origines. Ainsi, le Saint Père pose des actes symboliques, assiste à des rencontres œcuméniques et prononce des homélies. Sans entrer dans tous les détails de son voyage, soulignons :
1- Le 9 mai 2009 en Jordanie : la bénédiction de la première pierre de l’Université catholique de Madaba et la pose des premières pierres d’une église latine et d’une église melkite au lieu de baptême de Jésus Christ sur le Jourdan. La présence chrétienne en Orient n’est pas seulement un attachement spirituel, mais aussi un attachement à la terre, avec toutes les dimensions culturelles et civilisatrices que cela suppose.
2- Le 15 mai 2009 à Jérusalem : rencontre œcuménique au patriarcat grec-orthodoxe. Celle-ci ressort la volonté du Saint-Siège de ne pas agir seul, mais en collaborant avec les autres Églises chrétiennes. La question de la présence chrétienne au Moyen-Orient, notamment en Terre Sainte, est la responsabilité de toutes les communautés. En outre, ce rapprochement avec l’orthodoxie moyen-orientale n’est pas à séparer du voyage qu’effectuera le pape à Chypre en juin 2010.
3- Le 10 mai 2009, le pape d’adresse aux fidèles à la messe célébrée au Stade international de Amman en disant : « La fidélité à vos racines chrétiennes, la fidélité à la mission de l’Église en Terre Sainte réclament de chacun de vous un courage singulier : le courage de la conviction, née d’une foi personnelle, qui ne soit pas seulement une convention sociale ou une tradition familiale ; le courage de dialoguer et de travailler aux côtés des autres chrétiens au service de l’Évangile et de la solidarité avec les pauvres, les personnes déplacées et les victimes des grandes tragédies humaines ; le courage de construire de nouveaux ponts pour rendre possible la rencontre fructueuse des personnes de religions et de cultures différentes, et donc d’enrichir le tissu de la société »[28]. Quelques jours plus tard, en célébrant une messe dans la place de la Nativité à Bethléem, le pape appelle les chrétiens à consolider leur présence en restant dans la région malgré toutes les difficultés.
In fine, le pape plaide pour la paix au Moyen-Orient, et mène des dialogues sur plus d’un front afin d’assurer les assises nécessaires pour l’avenir de la présence chrétienne au Moyen-Orient. Sa visite de solidarité aux chrétiens de la Terre Sainte a comme but de les affermir dans leur foi et de les encourager à rester sur cette terre d’origine. Ses actes et messages envers les juifs et les musulmans ont surtout comme but d’écarter tout malentendu, et de rappeler l’importance du sens religieux et culturel de la présence chrétienne : « Cette terre est véritablement un terrain fertile pour l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, et je prie pour que la riche diversité du témoignage religieux en cette région porte des fruits accrus de compréhension et de respect mutuels »[29].
La visite de Chypre (4-6 juin 2010) : le prélude du Synode pour le Moyen-Orient
Benoît XVI annonce clairement que le voyage à Chypre, « représente, sous de nombreux aspects, la continuation du voyage […] accompli l’an dernier en Terre Sainte »[30]. Même s’il déclare ne pas venir avec un message politique, mais religieux qui prône l’ouverture à la paix, le pape rappelle le rôle diplomatique « soft » du Saint-Siège en disant : « Nous pouvons également aider à travers les conseils politiques et stratégiques, mais le travail essentiel du Vatican est toujours d’ordre religieux, touche le cœur »[31]. L’un des objectifs principaux de ce voyage est la remise de l’Instrumentum laboris[32] du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Ce n’est probablement pas par hasard que le pape remet ce document à l’archevêque maronite de Chypre Youssef Soueif, eu égard au rôle central qu’assigne le Saint-Siège à l’Église maronite.
Sans s’étendre sur les détails de ce document directeur pour la tenue du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, soulignons les éléments qui mettent en lumière le sujet de cet article :
1- Le pape s’implique d’une manière personnelle pour les chrétiens d’Orient : « Il s’agit là d’un autre geste significatif du souci particulier de l’Évêque de Rome pour les chères Églises du Moyen-Orient », lui qui a « tenu à renforcer son amour pour la Terre Sainte, lors de ses voyages Apostoliques en Turquie, du 28 novembre au 1erdécembre 2006, puis du 8 au 15 mai 2009 en Jordanie, en Israël et en Palestine » (2).
2- La perspective de renouveau des Églises, lequel est supposé avoir des conséquences sur la présence chrétienne en Orient. L’Instrumentum laboris l’exprime expressément en parlant du double objectif du Synode : « a) confirmer et renforcer les chrétiens dans leur identité, grâce à la Parole de Dieu et aux Sacrements ; b) raviver la communion ecclésiale entre les Églises sui iuris, afin qu’elles puissent offrir un témoignage de vie chrétienne authentique, joyeuse et attirante » (3).
3- L’insistance sur les dialogues œcuménique et interreligieux : « Il est essentiel pour les chrétiens de bien connaître les juifs et les musulmans, afin de pouvoir collaborer avec eux dans la sphère religieuse, sociale et culturelle, pour le bien de la société tout entière » (4).
4- Le rappel que les chrétiens sont des « citoyens indigènes » qui participent à la formation de l’identité culturelle de leurs pays : « Leur disparition constituerait une perte pour ce pluralisme qui a caractérisé depuis toujours les pays du Moyen-Orient. Sans la voix chrétienne, les sociétés moyen-orientales seraient appauvries » (24).
5- Il incombe aux chrétiens d’œuvrer pour l’instauration d’une « laïcité positive » : « De telle sorte, ils aideraient à alléger le caractère théocratique du gouvernement et permettraient une plus grande égalité entre les citoyens de religions différentes, en facilitant ainsi la promotion d’une démocratie saine, positivement laïque, qui reconnaisse pleinement le rôle de la religion, dans la vie publique également, dans le respect total de la distinction entre les ordres religieux et temporel » (25).
6- Les chrétiens, bien que minoritaires presque partout, devraient éviter « le repliement sur soi et la peur de l’autre » (28).
7- Le document aborde la question démographique et encourage les familles nombreuses (29).
8- La liberté de religion (culte) et de conscience (choix de religion) sont des droits humains inaliénables.
9- Il faut combattre l’émigration, et profiter du soutien de ceux qui sont déjà émigrés.
10- La mise en garde contre l’islamisme et la violence qu’il suppose (41).
11- Rappel de la position du Saint-Siège sur la solution des deux États, israélien et palestinien.
12- Plaider pour une société démocratique cultivant la paix et jouissant d’un développement économique sain qui empêcherait les chrétiens d’émigrer.
13- L’avenir du Moyen-Orient est de la responsabilité des chrétiens et des musulmans : « Musulmans et chrétiens doivent parcourir un chemin commun. Nous appartenons au Moyen-Orient et nous nous identifions à lui. […] En tant que citoyens, nous partageons les responsabilités pour construire et pour assainir » (106)
14- Le chrétien pourrait avoir une contribution spéciale pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Par le dialogue, il peut jouer le rôle de pont entre les juifs et les musulmans.
15- Et enfin, le document se termine sur une note d’espérance pour l’avenir du christianisme au Moyen-Orient : « L’histoire a fait que nous sommes devenus un « petit reste ». Mais nous pouvons aussi, par notre comportement, devenir aujourd’hui une présence qui compte » (118).
L’Assemblée spéciale des évêques pour le Moyen-Orient
La lecture des propositions finales de l’Assemblée des évêques n’ajoutent pas grand-chose à ce qui a précédé su la question. Les « Propositionum »[33] reprennent effectivement les grands thèmes du dialogue œcuménique et interreligieux, les questions de la présence chrétienne, du renouveau des Églises, de l’attachement à la terre, du témoignage, etc. L’essentiel de ce qui a été dit et écrit depuis 2006, en Turquie, en Jordanie, en Palestine, en Israël et à Chypre est repris, mais reformulé et contextualisé par l’Assemblée des évêques moyen-orientaux. Et même si l’Instrumentum laboris était le fruit des réponses des Églises aux questions qui leur ont été posées, il semble que les aspirations des chrétiens moyen-orientaux rejoignent les projets du Saint-Siège pour l’avenir du christianisme dans cette région du monde.
La lecture des « Propositionum » montre à quel point il est difficile de séparer le pastoral du politique, car si certaines propositions relèvent de considérations « spirituelles » pures (la parole de Dieu ou la liturgie par exemple), d’autres propositions débouchent clairement sur des questions aux horizons politiques (les droits de l’homme ou la forme de l’État). Cela souligne encore une fois la subtilité de l’action diplomatique du Saint-Siège où tout acte « spirituel » échappe difficilement à la dimension politique, puisqu’il implique une contextualisation de la foi dans une culture et dans un espace-temps bien déterminés. En voulant encourager les chrétiens d’Orient et en les raffermissant dans leur foi, le Saint-Siège est forcément en train de poser un acte politique majeur qui suppose au moins la résistance à l’affaiblissement des chrétiens d’Orient et leur disparition, et au plus, un redressement de ce christianisme qui fait de lui un facteur de vie indispensable dans tous les pays arabes où il existe.
Cependant, l’importance de ce document final est à souligner à deux égards. Premièrement, il exprime la volonté conjointe du Saint-Siège et des chrétiens catholiques orientaux, représentés par leurs évêques, d’œuvrer pour la présence chrétienne au Moyen-Orient. Deuxièmement, bien au-delà des idées constructives proposées de diverses manières par le Saint-Siège, il établit une feuille de route, à l’instar de l’Exhortation apostolique pour le Liban (1997), qui engage les communautés locales. On peut effectivement lire à la fin du document : « Les Églises ayant participé au Synode sont appelées à prendre les moyens d’assurer le suivi du Synode, en collaboration avec le Conseil des Patriarches catholiques d’Orient et les structures officielles des Églises concernées, et à y impliquer davantage les prêtres, les experts laïcs et religieux » (propositio 43).
Ainsi, l’action diplomatique du Saint-Siège ne paraît pas isolée de l’engagement des communautés catholiques arabes qui s’avère nécessaire, voire incontournable, pour la réalisation de la politique vaticane. La lecture des Propositionum montre à quel point le Synode des évêques pour le Moyen-Orient dépend de la politique internationale que le Saint-Siège pratique depuis plusieurs décennies. Soulignons les éléments du Synode qui rappellent cela, et qui s’inscrivent dans le sillage direct de la diplomatie du Saint-Siège durant le pontificat de Benoît XVI :
1- Un attachement à la terre qui ne doit absolument pas se vider de son élément chrétien qui lui est fondamental : « Vu que l’attachement à la terre natale est un élément essentiel de l’identité des personnes et des peuples et que la terre est un espace de liberté, nous exhortons nos fidèles et nos communautés ecclésiales à ne pas céder à la tentation de vendre leurs propriétés immobilières » (propositio 6). Le document exhorte les concernés à trouver les moyens nécessaires qui aideraient les chrétiens à acheter leur logement ou à se loger, plutôt que d’opter pour la solution que le Saint-Siège et les Églises locales ont en aversion : l’émigration.
2- Dans le même sillage, il appartient aux Églises d’étudier les phénomènes migratoires et de faire « tout ce qui est possible pour consolider la présence des chrétiens dans leurs patries, et cela spécialement à travers des projets de développement, pour limiter le phénomène de la migration » (propositio 10).
3- Le dialogue œcuménique doit se poursuivre : « Les Pères synodaux encouragent ces Églises [catholiques orientales] à instaurer un dialogue œcuménique au niveau local. Ils recommandent aussi que les Églises orientales catholiques soient plus impliquées dans les commissions internationales du dialogue, dans la mesure du possible » (propositio 28).
4- Il en est de même concernant le dialogue interreligieux « qui rapproche les esprits et les cœurs. Pour cela, ils sont invités, avec leurs partenaires, au renforcement du dialogue interreligieux, à la purification de la mémoire, au pardon mutuel du passé et à la recherche d’un meilleur avenir commun » (propositio 40).
5- Même si les relations avec le judaïsme restent compliquées pour le christianisme arabe en raison du conflit israélo-palestinien et israélo-arabe, la déclaration Nostra aetate du Concile Vatican II est rappelée. « Les initiatives de dialogue et de coopération avec les juifs sont à encourager, pour approfondir les valeurs humaines et religieuses, la liberté, la justice, la paix et la fraternité. La lecture de l’Ancien Testament et l’approfondissement des traditions du judaïsme aident à mieux connaître la religion juive. Nous refusons l’antisémitisme et l’antijudaïsme, en distinguant entre religion et politique » (propositio 41).
6- Quant aux relations avec l’islam, elles paraissent incontournables et fondamentales pour l’avenir de la présence chrétienne au Moyen-Orient où « les chrétiens partagent avec les musulmans la même vie et le même destin. Ils édifient ensemble la société ». Cependant, ces relations devraient dépasser la simple question morale ou religieuse et s’étendre sur le domaine social et politique : « Il est important de promouvoir la notion de citoyenneté, la dignité de la personne humaine, l’égalité des droits et des devoirs et la liberté religieuse comprenant la liberté du culte et la liberté de conscience ». D’où la nécessité de rejeter toute attitude de recroquevillement, de renfermement et de haine : « Les chrétiens du Moyen-Orient sont appelés à poursuivre le dialogue de vie fructueux avec les musulmans. Ils veilleront à avoir, à leur égard, un regard d’estime et d’amour, mettant de côté tout préjugé négatif ». Cela devrait mener à offrir « au monde l’image d’une rencontre positive et d’une collaboration fructueuse entre les croyants de ces religions, s’opposant ensemble à tout genre de fondamentalisme et de violence au nom de la religion » (propositio 42).
Conclusion
Il n’y a pas de doute que le Saint-Siège joue un rôle majeur à l’endroit de la présence chrétienne au Moyen-Orient. On peut même légitimement douter qu’il existe de nos jours une diplomatie qui déploie autant d’efforts en faveur de ces chrétiens. Cependant, au vu des mutations très rapides et peu favorables aux chrétiens du Moyen-Orient durant ces dernières décennies, une question fondamentale ne cesse de s’imposer à tout observateur averti de cette région du monde : est-ce que la diplomatie du Saint-Siège et les efforts des communautés locales, pourraient occasionner un véritable renouveau du christianisme oriental, ou du moins, une stabilisation des certains acquis positifs que ces communautés possèdent encore aux endroits de la culture, de la politique, de l’économie ou de la démographie ? Les années à venir seraient probablement porteuses de réponses qu’une multitude d’hommes et de femmes espèrent positives.
Antoine Fleyfel
2011-2012
[1] « Constitution dogmatique Pastor Aeternus », in Concile Vatican I, 1870, chap. 3.
[2] Dans son sens le plus général, on entend par Saint Siège l’Église de Rome fondée par Pierre et Paul.
[3] « Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d’État, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église et les autres Instituts de la Curie Romaine » (CIC, Canon 360).
[4] Dans les accords du Latran, « l’Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme domaine inhérent à sa nature, conformément à sa tradition et aux exigences de sa mission dans le monde » (Art. II).
[5] Controverse politique sur le statut de Rome qui était le siège du pouvoir temporel du pape, mais aussi la capitale du Royaume d’Italie. Cette controverse a duré de 1870 (annexion de Rome par Victor-Emmanuel II) jusqu’aux accords du Latran signés le 11 février 1929 par Mussolini et Pie XI.
[6] Comme l’Agence internationale de l’énergie atomique ou l’Union postale universelle.
[7] Lorsque le pape avait fait parvenir à Staline sa demande de respecter les libertés religieuses sur les territoires européens que l’armée rouge occupait, celui-ci aurait répondu : « Le pape, combien de divisions ? ». Lorsqu’il apprit la mort de Staline, Pie XII aurait dit, en 1953 : « Maintenant qu’il est face aux anges, il sait combien j’en avais ».
[8] « Aucun chef d’État ou de gouvernement ne pourrait adopter le langage de dénonciation, de critique et de revendication typique du pape. On doit remarquer aussi, en particulier, que la force et la clarté qui caractérisent souvent les paroles du pape peuvent susciter des discussions voire des polémiques dans l’opinion publique internationale » (Giovanni Barberini, Le Saint-Siège, sujet souverain de droit international, Paris, Cerf, p. 61).
[9] Theodoros Koutroubas, L’action politique et diplomatique du Saint Siège au Moyen-Orient de 1978 à 1992, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, p. 40.
[10]http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/vatican-saint-siege_451/presentation-du-vatican_1353/relations-internationales_12400.html
[11] Theodoros Koutroubas, op. cit., p. 23.
[12] Par exemple, lors de la première Intifada en 1987, le Saint-Siège faisait face à la difficulté de maintenir un équilibre, dans le but de préserver les Lieux Saints, entre l’OLP qui comptait dans ses rangs beaucoup de chrétiens et Israël lié aux Occidentaux. Durant ce conflit, l’émigration chrétienne inquiétait le Saint-Siège qui ne voulait pas voir les Lieux Saints se vider des chrétiens, et le christianisme disparaître de sa région d’origine.
[13] « Au-delà même de la crise du Liban, [Jean-Paul II] souhaitait faire de l’Église maronite […] un élément fédérateur des chrétiens des différents rites afin de déboucher, à terme, sur une grande ‘Église des Arabes’ suffisamment solide pour assurer la pérennité du christianisme en Orient » (Jean-Pierre Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient. Des origines à nos jours, Paris, Fayard, 1994, p. 401.).
[14] Theodoros Koutroubas, op. cit., p. 374.
[15]http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19970510_lebanon_fr.html
[16] Ils seront rappelés et traités de nouveau durant le pontificat de Benoît XVI.
[17] Et qui a été rectifié, entre autres, par la visite du pape de la Turquie (novembre-décembre 2006).
[18] Cependant, Benoît XVI confirme le chemin tracé par Jean-Paul II tout en soutenant l’engagement des chrétiens de Terre Sainte dans leur rôle de pont entre juifs et musulmans
[19] Avant son départ, il affirmait : «Ma première intention est de visiter ces lieux rendus sacrés par la vie de Jésus et d’y prier pour le don de la paix et de l’unité, pour vos familles et tous ceux qui ont pour foyer la Terre sainte».
[20]http://www.20minutes.fr/article/324805/Monde-Benoit-XVI-en-Terre-Sainte.php
[21]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090508_terra-santa-interview_fr.html
[22] http://www.zenit.org/article-20938?l=french
[23]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_farewell-tel-aviv_fr.html
[24] Le pape ne manquera pas de souligner, à plusieurs reprises, le respect de l’Église catholique pour l’islam. Il a déclaré, par exemple, à l’Aéroport international Queen Alia de Amman : « Ma visite en Jordanie me donne l’heureuse occasion de dire mon profond respect pour la communauté musulmane, et de rendre hommage au rôle déterminant de Sa Majesté le Roi dans la promotion d’une meilleure compréhension des vertus proclamées par l’Islam » (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090508_welcome-amman_fr.html).
[25] http://pape-en-israel.blogs.la-croix.com/mustapha-cherif/qui-comprendra/
[26] Il déclare à cette occasion : « Cet après-midi, ma visite au Camp de réfugiés Aïda me donne l’opportunité d’exprimer ma solidarité à l’ensemble des Palestiniens qui n’ont pas de maison et qui attendent de pouvoir retourner sur leur terre natale, ou d’habiter de façon durable dans une patrie qui soit à eux » (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090513_aida-refugee-camp_fr.html).
[27] Cf. http://pape-en-israel.blogs.la-croix.com/qustandi-shomali/bethleem-aujourd’hui/
[28]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090510_intern-stadium_fr.html
[29]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_farewell-tel-aviv_fr.html
[30]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20100604_intervista-cipro_fr.html
[32]http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20100606_instrumentum-mo_fr.pdf
[33]http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20101026_elenco-prop-finali-mo_fr.html
Résumé
Dans le chapitre 12 de son TTP, Spinoza définit le sacré de la sorte : « Mérite le nom de sacré et de divin ce qui est destiné à l’exercice de la piété et de la religion et ce caractère sacré demeurera attaché à une chose aussi longtemps seulement que les hommes s’en serviront religieusement ». De par cette définition première qui fait relever le sacré de la religion, Spinoza est en train d’exclure le sacré du domaine de la vérité qui est propre à la philosophie. Quant à sa lecture désacralisante de la Bible, bien qu’elle s’appuie sur sa philosophie pour nier au surnaturel son existence, c’est par le biais de sa « méthode historico-critique », qu’elle va permettre à Spinoza d’atteindre son but. La question du sacré est donc loin d’être pour Spinoza une question de simple piété ou de soumission au divin. Elle est au contraire une source de problèmes. Cet article voudrait montrer comment Spinoza comprend ce problème, et d’examiner la solution qu’il y propose à travers son programme de désacralisation radicale de l’Écriture.
Spinoza and the problem of the sacred in the 17th century
In the 12th chapter of his Tractatus theologico-politicus, Spinoza defines the sacred in this way: “A thing is called sacred and Divine when it is designed for promoting piety, and continues sacred so long as it is religiously used: if the users cease to be pious, the thing ceases to be sacred”. By this first definition that situates the sacred in the realm of religion, Spinoza is excluding the sacred from the domain of the truth proper to philosophy. As for his desacralizing reading of the Bible, though it denies, on the basis of his philosophy, any existence to the supernatural, it is thanks to the “historico-critical method” that this reading will enable Spinoza to attain his goal. For Spinoza, the question of the sacred is therefore far from being a question of simple piety or submission to the divine. On the contrary, it is a source of problems. This article will attempt to show how Spinoza deals with this situation and to examine the solution he proposes through his program of radical desacralisation of the Scriptures.
Extraits
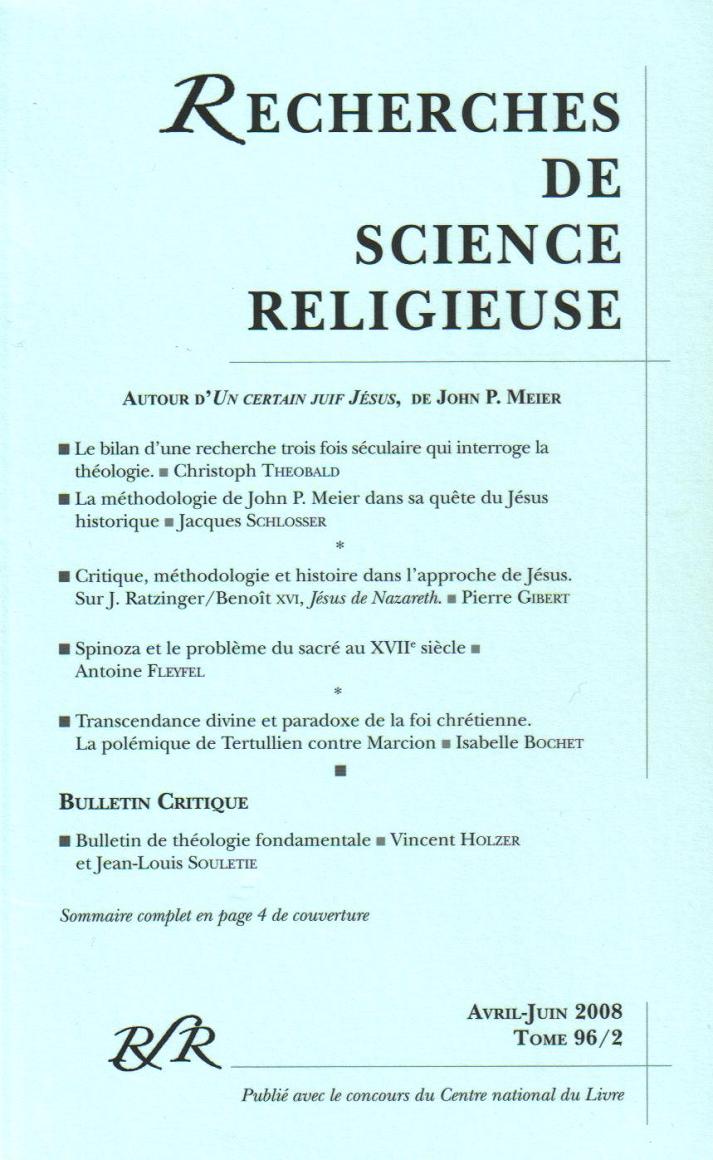 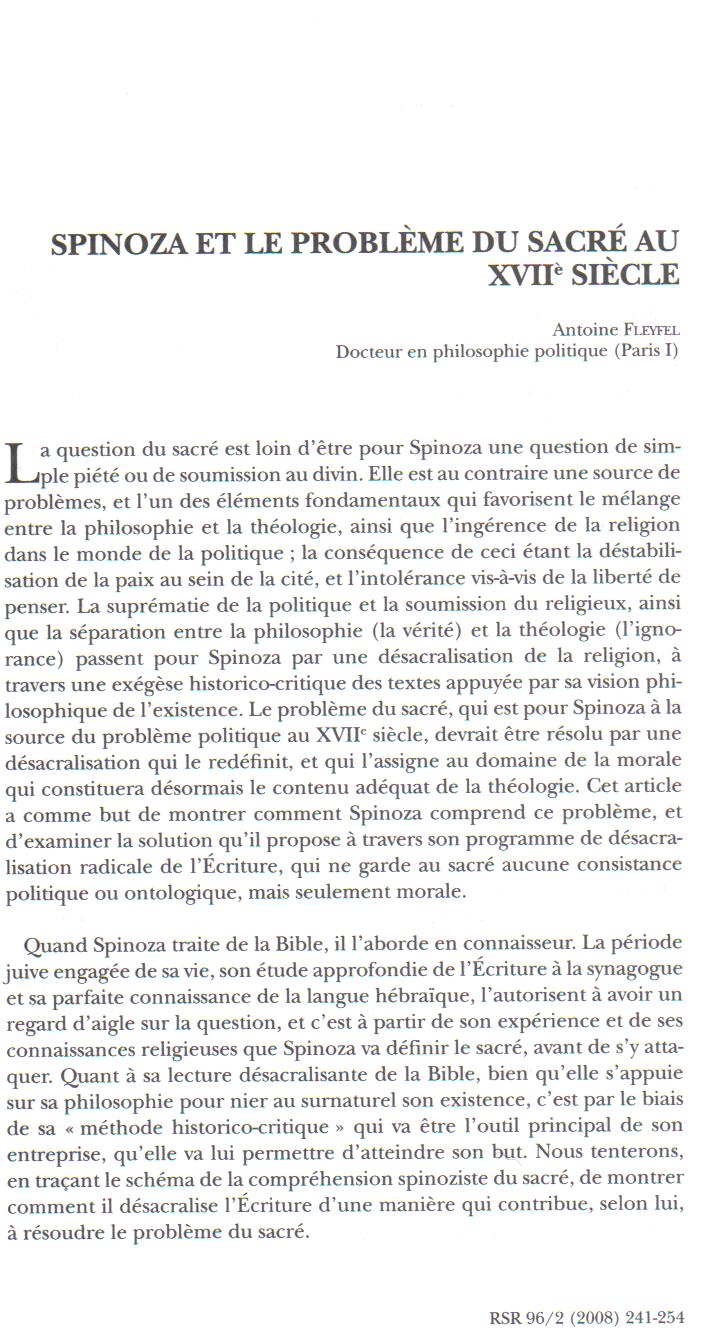 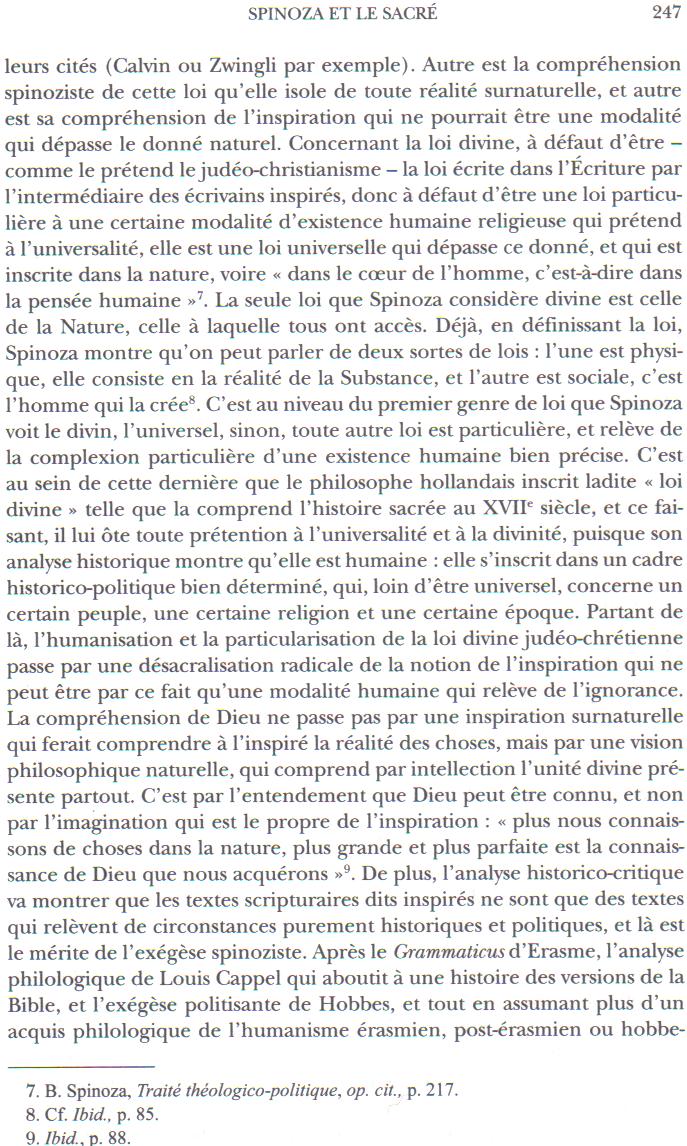 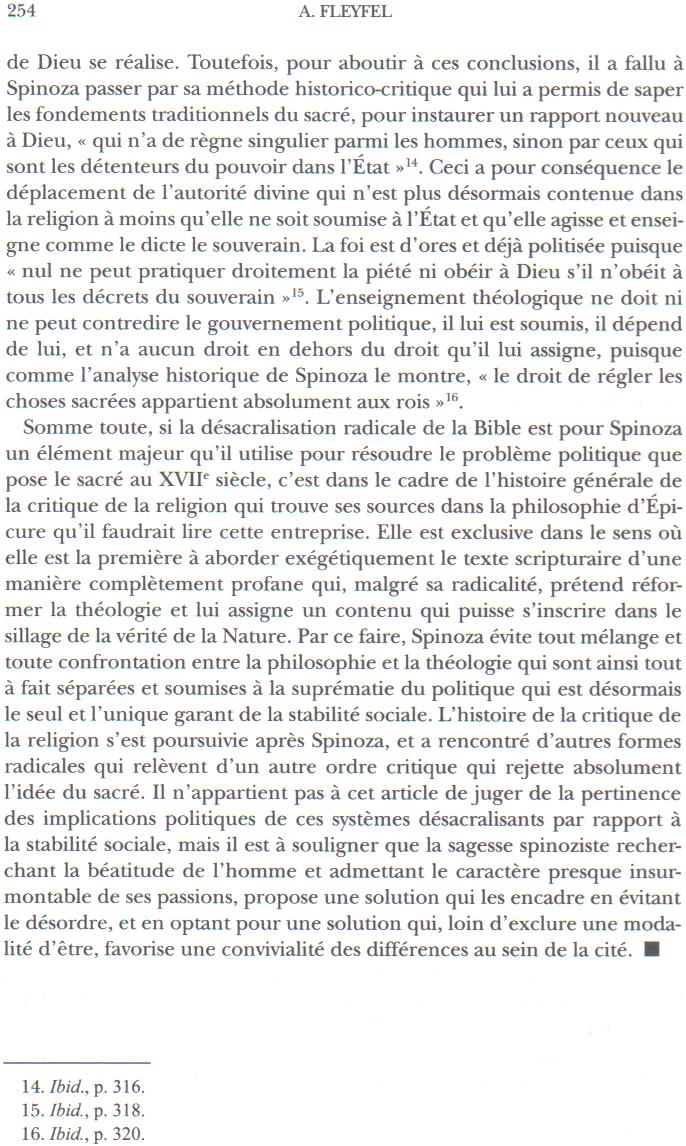 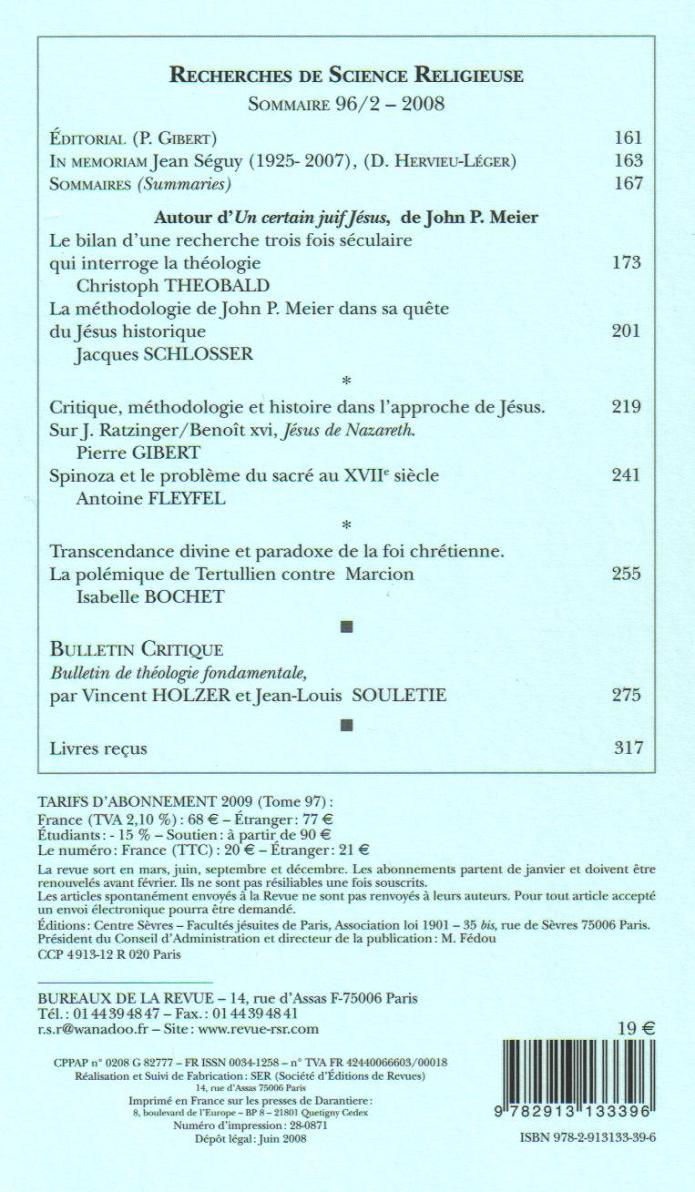
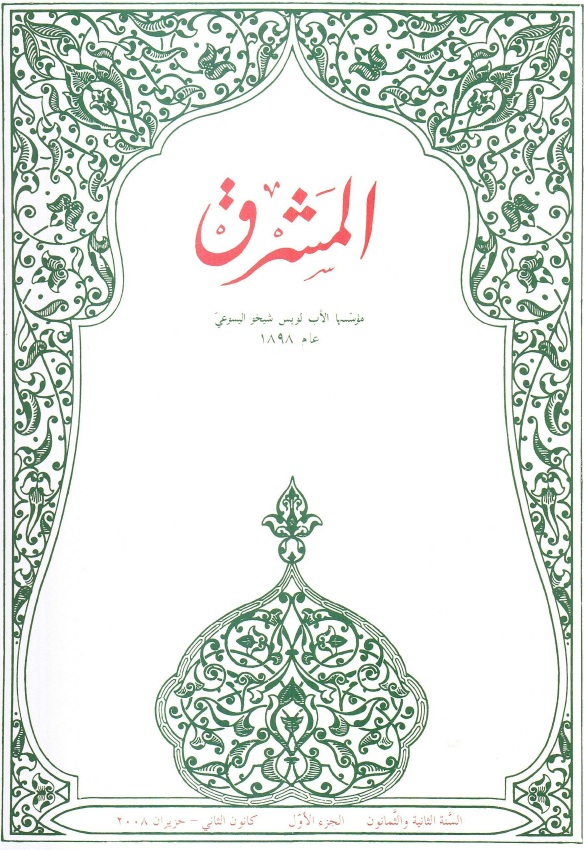
Cet article écrit en langue arabe a paru dans les pages 51-71 du n° 1 / LXXXIIe année / janvier – juin 2008, de la revue de théologie semestrielle Al-Machriq (fondée en 1898 et éditée par les jésuites).
Avec l’aimable autorisation du P. Camille Hechaymi, s.j., directeur des éditions “Dar Al-Machriq” lors de la parution de l’article, il possible de lire ou télécharger (Pdf) cet article en cliquant ICI.
Pour toute information sur la revue et pour les abonnements, vous pouvez les contacter par téléphone au + 961 1 20 24 24.
Antoine Fleyfel
05.03.2008

1. Introduction
Ce travail liturgique à comme but de faire une comparaison entre deux « rites de couronnement » maronites, l’un manuscrit datant de 1306, et l’autre imprimé à Bkerké et datant de 1942.
La motivation d’un tel travail est la recherche des origines les plus lointaines du rituel de couronnement maronite. Par le biais du rituel de 1306 (qui est le plus ancien manuscrit de couronnement maronite que l’Eglise maronite possède) il est en effet possible de retrouver une forme théologico-liturgique bien ancienne qui se rapproche plus de la source liturgique syro-antiochienne que le rituel de 1942. De plus que le manuscrit est exempt de toute latinisation qui ne s’est faite systématique dans l’Église maronite qu’à partir du XVIe siècle. Quant au rituel de 1942, c’était le dernier rituel officiel qui fut imprimé XXe siècle, et qui ait obtenu l’aval du patriarche maronite.
Ce travail comparatif permettra aussi de pouvoir observer certains éléments latinisants dans le rite de 1942, ce qui pourrait être intéressant pour un travail de réforme liturgique ; comme par exemple la caractéristique orientale de l’onction avec l’huile lors du couronnement, qui a disparu avec l’influence latine.
Après avoir brièvement présenté les deux rituels et établi leurs structures, les comparaisons des différentes parties seront effectuées.
2. Rite du couronnement maronite selon le manuscrit de Bkerké (1306 A.D.).
2.1. Aperçu
Le manuscrit de Bkerké du rite de couronnement maronite qui date de l’année 1306 est écrit en langue syriaque. Son état est quelque peu dégradé à cause de l’humidité et d’autres facteurs naturels qui attaquent et détériorent parfois les manuscrits. Beaucoup de feuilles et de mots manquent. Le rite du couronnement est suivi par un rite de bénédiction des habits sacerdotaux et des nappes qui couvrent l’autel. Le nombre de ses pages est de 53.
2.2. Structure
I- Rite des fiançailles
a- Le prêtre s’assure du consentement des deux sujets.
b- Prière
b’- Autre prière
c- Prière sur l’huile
d- L’onction des fiancés et de tous les présents
II- Rite de la bénédiction des anneaux
a- Prière de la bénédiction des anneaux et des ceintures
b- Trisagion
c- Credo
d- Hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre
e- Hymne chantée par le diacre
f- Mazmouro (chant) des lectures
g- Korouzouto
h- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière
i- Le prêtre ceinture les fiancés en récitant une prière
j- Pater
k- Prière Finale
III- Rite du couronnement
a- Prière proclamée par le diacre (Hlof chayno)
b- Bo’outo de saint Jacques chantée par le prêtre portant les couronnes de sa main droite
c- Trisagion
d- Mazmouro (chant) des lectures
e- Lecture d’Ep 5, 22-27
f- Lecture de Mt 19 3-6
g- Korouzouto
h- Chant de louange (w léh léychou’ mchiho)
i- Hymne (Fchito)
j- Le diacre proclame: prions
k- Le prêtre joint les mains des époux et proclame trois fois une doxologie trinitaire
l- Prière
l’- Autre prière
m- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’époux en récitant une prière
n- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’épouse en récitant une prière
o- Prière
p- Le prêtre encense en chantant une hymne de saint Ephrem
q- Prière sur la tête de l’époux
r- Prière sur la tête de l’épouse
s- Prière sur les deux ensembles
s’- Autre prière
s’’- Autre prière
t- Le prêtre met sa main sur la tête de l’époux en récitant une prière, et puis lui ôte la couronne.
u- Le prêtre met sa main sur la tête de l’épouse en récitant une prière, et
puis lui ôte la couronne.
v- Prière sur les paranymphes
v’- Prière
w- Prière proclamée par le diacre
IV- Prières finales
a- Prière finale
b- Homélie ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux
c- Tous proclament trois fois : Amour dans le Christ, Kyrie eleison
3. Rite du couronnement maronite selon le livre des rites de Bkerké datant de 1942 A. D.
3.1. Aperçu
Le livre des « Rites maronites » de Bkerké fut édité l’an 1942 sous le mandat de sa béatitude le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient Antoun Boutros Arida. Il est composé de 374 pages. Tout ce qui a rapport au rite du couronnement se trouve entre les pages 231-268. Ce livre est en langues syriaque et arabe (la transcription est en Karchouni). Un petit appendice indiquant la manière de la célébration des rites précède les rites des fiançailles et du couronnement.
3.2. Structure
I- Rite des fiançailles (qui selon les indications de livre doit se dérouler dans la maison de la fiancée).
a- Le prêtre s’assure du consentement des deux sujets
b- Les deux sujets répondent affirmativement
c- Le prêtre dit trois fois : “regardez, je suis par le témoignage des présents innocent de votre engagement”
d- Les deux se tiennent de la main droite, et le prêtre voile leurs mains par son étole et récite une prière
e- Ils se lâchent les mains et le prêtre récite une autre prière
II- Rite de la bénédiction des anneaux
a- Prière de la bénédiction des anneaux
b- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière
c- S’il y a des ceintures et d’autres habits, le prêtre y récite une prière
d- S’il le veut, le prêtre ceinture les fiancés
e- Prière finale
III – Rite du couronnement (qui se déroule dans l’Eglise)
a- Avant de commencer le rite, le prêtre récite les prières qui précèdent le couronnement, telles les prières qui précèdent l’office.
b- Doxologie
c- Prière initiale
d- Tous récitent le psaume 128
e- Froumiyoun (avec encensement)
f- Sédro
g- Hymne
h- Prière de l’encens
i- Mazmouro (chant) des lectures
j- Lecture d’Eph 5, 22-27
k- Fétgamo
l- Lecture de Mt 19 3-6
m- Chant de louange
n- Homélie, ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux
o- Korouzouto
p- Hymne (Fchito)
q- Prise du consentement des deux époux
r- L’épouse et l’épouse se prennent par leurs mains droites, et le prêtre met le bout de son étole et sa main droite au-dessus de leurs et récite une prière
s- Le prêtre bénit les deux anneaux
t- Le prêtre leur met les anneaux dans leurs mains gauches et récite une prière
u- Prière de la bénédiction des couronnes
v- Couronnement de l’époux avec la récitation d’une hymne puis d’une prière
w- Couronnement de l’épouse avec la récitation d’une hymne puis d’une prière
x- Couronnement des paranymphes et prière
y- Tous chantent une hymne de saint Ephrem (Mchiho dadnah men maryam)
z- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’époux et puis lui ôte la couronne
aa- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’épouse et puis lui ôte la couronne
bb- Le prêtre récite une prière sur la tête des paranymphes et puis leur ôte leurs couronnes
cc-Prière
IV- Prière finale
a- Prière finale
4. Comparaison entre le rite de 1306 et celui de 1942
4.1. Comparaison entre les deux rites des fiançailles
| Rite de 1306 |
Rite de 1942 |
| a- Consentement |
a- Consentement |
|
b- Réponses affirmatives |
|
c- Proclamation du prêtre |
| b- Prière |
d- Les deux fiancés se tiennent par la main droite, et le prêtre voile leurs mains par son étole et récite une prière |
| c- Autre prière |
e- Ils se lâchent les mains et le prêtre récite une autre prière |
| d- Prière sur l’huile |
|
| e- Onction des fiancés et des présents |
|
Ce tableau comparatif montre une divergence dans la structure des deux rites des fiançailles. Certains éléments ont été préservés dans le rite de 1942, alors que d’autres ont été soit transformés, soit éliminés.
Le premier élément qui est celui de la prise du consentement des deux fiancés a été préservé par le nouveau rite, aucun changement n’est à souligner à ce niveau. Quant aux points “b” et “c” du rite de 1942, ils sont inexistants dans le manuscrit du 1306. Il se peut que la réponse des futurs fiancés soit comprise implicitement après la prise du consentement dans le rite de 1306. Une telle hypothèse pourrait être appuyée par la proclamation “c” du prêtre qui supposerait un consentement explicite : “regardez, je suis par le témoignage des présents innocent de votre engagement”.
Les prières “b” et “c” de 1306, et les prières “d” et “e” de 1942, sont presque les mêmes (cf. l’appendice). Mais ce qui est à noter est le nouveau cachet sacramentaire qu’a revêtu le rite : le prêtre utilise désormais son étole et prie sur les mains des fiancés. Cette procédure est inexistante dans l’ancien rite. Il est probable que cette coutume soit d’influence latine, puisque la théologie sacramentaire orientale antique utilise en général l’huile comme signe sacramentel.
La prière sur l’huile ainsi que l’onction sont inexistantes dans l’ancien rite : le “d” et le “e” de 1306 sont une spécificité de ce dernier. Il appert que l’onction était utilisée naguère, non seulement pour le baptême, la confirmation, l’onction des malades et le sacerdoce, mais aussi pour le mariage. La remise d’une telle pratique à jour inscrirait davantage le rite du mariage maronite dans le sillage d’une théologie syro-antiochienne antique.
Un autre fait est à souligner : les présents sont aussi oints par l’huile bénie. Ceci est peut-être un signe qui étend la responsabilité des fiançailles à toute la communauté (qui a offert les cadeaux).
4.2. Comparaison entre les deux rites de la bénédiction des anneaux
| Rite de 1306 |
Rite de 1942 |
| a- Prière de la bénédiction des anneaux et des ceintures |
a- Prière de la bénédiction des anneaux |
| b- Trisagion |
|
| c- Credo |
|
| d- Hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre |
|
| e- Hymne chantée par le diacre |
|
| f- Mazmouro (chant) des lectures |
|
g- Korouzouto h- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prièreb- Le prêtre met les anneaux dans les mains des fiancés en récitant une prière c- S’il y a des ceintures et d’autres habits, le prêtre y récite une prièrei- Le prêtre ceinture les fiancés en récitant une prièred- S’il veut, le prêtre ceinture les fiancésj- Pater k- Prière finalee- Prière finale
Dans le rite de 1942, il s’agit dans “a” d’une bénédiction des anneaux, tandis que dans le rite de 1306, il s’agit dans “a” d’une bénédiction des anneaux et des ceintures. La bénédiction des ceintures pourrait évoquer tout un symbolisme de la pureté, de l’abstinence et de la virginité conjugale. Alors que même si la bénédiction des ceintures est mentionnée dans le nouveau rite, elle est désormais facultative et non essentielle comme dans le rite de 1306.
Entre les deux rites de la bénédiction des anneaux se trouve une divergence majeure. Toute une partie est omise dans le rite de 1942, à savoir: “b” Trisagion, “c” Credo, “d” hymne de saint Ephrem chantée par le prêtre, “e” hymne chantée par le diacre, “f” mazmouro (chant) des lectures, et “g” korouzouto. Beaucoup d’hypothèses peuvent être dites sur cette partie. On remarque cependant que la partie omise ressemble quelque peu à la structure de la première partie de la messe (la partie de la parole).
En ce qui concerne le Trisagion, sa présence peut être qualifiée d’ordinaire puisqu’il se trouve dans la messe et dans tous les offices liturgiques. Quant au Credo, il est de coutume orientale de le réciter dans la messe et à chaque prière liturgique (office).
Le manuscrit n’indique pas des lectures bibliques, mais le Mazmouro des lectures le suppose, bien qu’il puisse être parfois présent sans qu’il n’y ait des lectures à faire (comme dans certains offices nocturnes par exemple). Cependant le Korouzouto vient souvent se placer après les lectures bibliques.
Si dans l’ancien rite, il y a une bénédiction des anneaux et des ceintures dès la première prière, dans le nouveau rite, la bénédiction -facultative- des ceintures et des autres habits (inexistants dans 1306) vient se placer presque à la fin comme si elle n’était pas d’une très grande importance. La bénédiction des ceintures est facultative du moment qu’elle est obligatoire dans l’ancien rite.
La prière du Pater est omise du nouveau rite, alors que la prière finale est la même pour les deux rites.
Pourquoi y a-t-il eu tant d’omissions dans le nouveau rite ? Est-ce par ce que le rituel devenait trop long pour certains ? Ou est-ce un changement de mentalité sur certaines pratiques qui l’a entraîné ? Et la latinisation n’est-elle pas à l’œuvre ? Une recherche reste à faire à ce niveau.
4.3. Comparaison entre les deux rites de couronnement
|
a- Avant de commencer le rite, le prêtre récite les prières qui précèdent le couronnement, telles les prières qui précèdent l’office. |
|
b- Doxologie |
|
c- Prière initiale |
|
d- Tous récitent le psaume 128 |
|
e- Froumiyoun (avec encensement) |
|
f- Sédro |
|
g- Hymne (‘afifo) |
|
h- Prière de l’encens |
| a- Prière proclamée par le diacre (hlof chayno) |
|
| b- Bo’outo de saint Jacques chanté par le prêtre portant les couronnes de sa main droite |
|
| c- Trisagion |
|
| d- Mazmouro (chant) des lectures |
i- Mazmouro (chant) des lectures |
| e- Lecture d’Ep 5, 20-27 |
j- Lecture d’Ep 5, 22-27 |
|
k- Fétgamo |
| f- Lecture de Mt 19, 1-11 |
l- Lecture de Mt 19, 3-6 |
| g- Korouzouto |
m- Chant de louange (wleh leychou’ mchiho…) |
|
n- Homélie, ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux |
| h- Chant de louange (wleh leychou’ mchiho) |
o- Korouzouto |
| i- Hymne (Fchito) |
p- Hymne (Fchito) |
| j- Le diacre proclame: prions |
|
|
q- Prise du consentement des deux époux |
| k- Le prêtre joint les mains des époux et proclame trois fois une doxologie trinitaire |
r- L’épouse et l’épouse se prennent par leurs mains droites, et le prêtre met le bout de son étole et sa main droite au-dessus des leurs et récite une prière s- Le prêtre bénit les deux anneaux t- Le prêtre leur met les anneaux dans leurs mains gauches et récite une prièrel- Prière de la bénédiction des couronnesu- Prière de la bénédiction des couronnesl’- Autre prière m- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’époux en récitant une prièrev- Couronnement de l’époux avec la récitation d’une hymne puis d’une prièren- Le prêtre met la couronne sur la tête de l’épouse en récitant une prièrew- Couronnement de l’épouse avec la récitation d’une hymne puis d’une prièreo- Autre prière sur l’épouse
x- Couronnement des paranymphes et prièrep- Le prêtre encense en chantant une hymne de saint Ephremy- Tous chantent une hymne de saint Ephrem (Mchiho dadnah)q- Prière sur la tête de l’époux r- Prière sur la tête de l’épouse s- Prière sur les deux ensemble s’- Autre prière S’’- Autre prière t- Le prêtre met sa main sur la tête de l’époux en récitant une prière, et puis
lui ôte la couronnez- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’époux et puis lui ôte la couronneu – Le prêtre met sa main sur la tête de l’épouse en récitant une prière, et puis lui ôte la couronneaa- Le prêtre récite une prière sur la tête de l’épouse et puis lui ôte la couronnev- Prière sur les paranymphes
bb- Le prêtre récite une prière sur la tête des paranymphes et puis leur ôte leurs couronnesv’- Prièrecc- Prièrew- Prière proclamée par le diacre
Le premier fait très important à constater est la structure “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” du rite de 1942. C’est une structure très proche de celle de l’office et de la messe ; elle comprend une doxologie, une prière initiale, un psaume, un “houssoyo”, ce qui est inexistant dans l’ancien rite.
Depuis son début, le rite de 1306 diverge avec celui de 1942. La première prière (hlof chayno) proclamée par le diacre est inexistante dans le nouveau rite. Ceux qui précèdent, à savoir “b” et “c” sont aussi inexistants dans le rite de 1942. Il est à mentionner que le chant “b” chanté par le prêtre seul (portant les couronnes) est long. Et en ce qui concerne le Trisagion, c’est la deuxième fois qu’il apparaît dans la totalité du rite.
Les deux rites se rejoignent pour la première fois dans le Mazmouro des lectures: “d” dans 1306, et “I” dans 1942. Les textes des deux Mazmouro sont les mêmes.
Comme dans presque tous les rites maronites, les Mazmouro précèdent les lectures. La première lecture de saint Paul est presque similaire dans les deux rites, sauf que dans le rite de 1306 la lecture commence d’Ep 5, 20 et non d’Ep 5, 22 comme dans le nouveau rite.
Après la lecture de l’épître paulinienne, il est d’habitude de réciter dans l’Eglise maronite le Fétgamo, ce qui est le cas pour le rite de 1942 (k), et non pour celui de 1306. On ne récitait peut-être pas de Fétgamo naguère, ou sa récitation était tellement évidente qu’elle n’a pas été mentionnée ?
En ce qui concerne la lecture de l’Evangile (Mathieu) elle est presque la même dans les deux rites, sauf que celle de 1306 est plus longue. Dans l’ancien rite on lisait Mt 19, 1-11, tandis que dans celui de 1942, on ne lit que Mt 19, 3-6.
A la suite des lectures bibliques se trouvent deux éléments communs aux deux rites. Mais ce qui diffère est le Kourouzoto de 1306 qui est parallèle au chant de louange de 1942 et vice-versa. Quant à l’homélie, elle se dit dans le rite de 1942 après l’Evangile (n), alors qu’elle se situe dans le rite de 1306 à la fin, avec les prières finales.
Les deux rites se rejoignent à nouveau dans le chant Fchito, “h” pour 1306 et “p” pour 1942. Les paroles du chant sont les mêmes pour les deux rites.
La proclamation du diacre “prions” “j” dans 1306 est inexistante dans le rite de 1942.
La prise du consentement des deux époux (“q” dans 1942) est inexistante dans le rite de 1306. En effet, la prise de consentement est latine, et dans tous les rites orientaux originaires, il n’y a pas de prise de consentement pour le mariage. Le seul consentement que nous trouvons dans le rite est celui du rite des fiançailles, et il n’est pas tellement formel (il s’agit d’un simple consensus familial que le prêtre dirige).
L’acte de joindre les mains des deux époux existe dans les deux rites. Cependant, sa forme diffère un peu d’un rite à l’autre. Dans le nouveau rite, s’ajoute l’insertion de l’étole, et la doxologie primitive est développée.
Dans le nouveau rite se trouve une prière de la bénédiction des anneaux, et puis une mise des anneaux dans les mains gauches des époux (“s” et “t”). Cet acte liturgique est inexistant dans l’ancien rite. La seule mention des anneaux dans l’ancien rite se trouve dans la partie de la bénédiction des anneaux.
Les deux rites se rejoignent à nouveau dans une prière de la bénédiction des couronnes. Cette prière est la même dans les deux rites. Cependant, elle est précédée par une autre prière qui a le même thème et qui est plus longue dans l’ancien rite (l’).
Le couronnement de l’époux est le même dans les deux rites, sauf que dans celui de 1942 il y a un ajout d’une hymne. Le couronnement de l’épouse est le même dans les deux rites, sauf que le prêtre récite en premier lieu une prière “n” qui est chantée dans le nouveau rite “w”. Puis il récite une autre prière “o” qui est la même prière de “w” dans le nouveau rite.
Dans l’ancien rite, il n’y a pas de couronnement des paranymphes (“x” dans 1942). Les anciens considéraient seulement les époux roi et reine dans ce rite.
Derechef, les deux rites se rejoignent dans une hymne éphrémienne (“p” dans 1306 et “y” dans 1942). Les différences relevées à cet endroit sont : l’absence d’encensement dans le rite de 1942, ainsi que la disparition de quelques strophes du chant qui est désormais chanté par toutes l’assemblée, alors qu’il était chanté par le prêtre seul dans le rite de 1306.
La structure “q”, “r”, “s”, “s’”, “s’’” de l’ancien rite sont inexistant dans celui de 1942 qui ne fait aucune allusion à ce moment liturgique, ni aux prières récitées.
Les prières “t”, “u” et “v” de l’ancien rite, à savoir celles où le prêtre ôte les couronnes, et celles où il prie sur les paranymphes trouvent leurs parallèles dans “z”, “aa” et “bb” du nouveau rite. Sauf que dans l’ancien rite, l’action du découronnement des paranymphes est inexistante puisqu’ils n’ont pas été couronnés auparavant. Il existe aussi une légère différence dans l’action liturgique qui accompagne ces prières : dans l’ancien rite, le prêtre posait sa main sur la tête de l’époux ou de l’épouse, tandis que dans le nouveau, il se contente de lever sa main droite.
La prière “v’” de l’ancien rite est la même que l’autre “cc” du nouveau rite.
Avec la prière “cc”, le rite de couronnement de 1942 se clôt. Cependant, il existe un élément en plus dans le rite de 1306: la prière “w” proclamée par le diacre.
4.4. Comparaison entre les deux prières finales des rites
| Rite de 1306 |
Rite de 1942 |
| a- Prière finale |
a- Prière finale |
| b- Homélie ou quelques recommandations données par le prêtre aux nouveaux époux |
|
| c- Tous proclament trois fois: Amour dans le Christ, Kyrie eleison |
|
L’une des différences essentielles qui se trouvent dans ce rite se situe au niveau des prières finales. Le seul point commun est la prière “a” qui est la même dans les deux rites. Par la suite, l’homélie se situe à la fin du rite de 1306 qui s’achève par une triple proclamation de tous : Amour dans le Christ, Kyrie eleison.
5. Conclusion
Par le biais de cette étude comparative, il est possible de pendre conscience de la problématique liturgique du rite de couronnement maronite. Toute réforme de ce rite gagnerait beaucoup à s’inspirer de l’ancien rituel qui garde des formes liturgiques syro-antiochiennes bien anciennes. L’un des éléments liturgiques orientaux les plus importants est celui de l’utilisation de l’huile sacrée lors du sacrement. De plus qu’une telle comparaison permet de mettre en exergue les nouveautés et les influences subies du rite de 1942.
6. Références
– Le livre des rites maronites (en syriaque et arabe), Bkerké 1942, p. 231-268.
– Baissari Françis (Mgr), Rite ancien du couronnement maronite, Publications de l’institut de liturgie à l’université Saint Esprit n° 19, Kaslik 1994, p. 7-34.
Dr Antoine Fleyfel
Travail effectué en 1999 au Liban et modifié le 28 janvier 2008 à Paris.
Le Traité théologico-politique est-il un traité de tolérance religieuse en plus d’être un traité sur la liberté de philosopher ? Cette question est importante dans la mesure où la « liberté de philosopher » est au centre de la pensée spinoziste. Elle figure parmi les raisons qui ont poussé Spinoza à rédiger son traité. Mais est-ce que faire du Traité théologico-politique un traité de la liberté du philosophe et de la pensée implique la tolérance religieuse ? Cette question est posée à partir d’une constatation de l’importance de la notion de « tolérance religieuse » durant l’époque de Spinoza. Celle-là est débattue, (en raison surtout de questions d’ordre théologico-politique), et les traités sur la « tolérance » sont loin de manquer. Avant d’examiner la pensée de certains auteurs représentant cette vague de la tolérance religieuse, il serait opportun, pour plus d’éclaircissement, d’examiner la définition du terme « tolérance ».
Le « Dictionnaire de la langue philosophique », définit « Tolérance » de la sorte : « Lat. tolerentia, der. de tolerare, supporter (au propre et surtout au fig.). A. Dans un sens très large : action de tolérer, c.-à-d. d’admettre sans réaction défensive. Tolérance de l’organisme à des conditions anormales. Tolérance en ce qui concerne le poids ou les dimensions… […]. B. Dans l’acception la plus usuelle (morale, politique) : attitude concédant aux autres la liberté d’exprimer des opinions que l’on juge fausses et de vivre conformément à ces opinions. Syn. : permission, concession, autorisation, liberté, faculté, licence […] ».[1] Cette définition pourrait poser problème en raison de la parenté, sinon de l’adéquation qui est faite entre la liberté et la tolérance. Or, si tolérance est synonyme de liberté, la question de savoir si le Traité théologico-politique est un traité de tolérance ou de liberté est résolue. Mais, est-ce bien le cas ?
A partir du XVIe siècle[2], la tolérance commence à jouer le rôle d’une vertu[3]. Au moment de la Réforme et de la Contre-réforme, plusieurs vicissitudes politiques et religieuses (surtout des édits), ainsi que la croissance du pouvoir des Etats pousse d’aucuns à penser cette question. C’est aussi le problème de la cohabitation entre différentes confessions (des Eglises rivales surtout) qui rend urgent la recherche d’un système favorisant la coexistence.
Sébastien Castellion (1515-1563) fait partie des gens qui ont pensé cette question au XVIe siècle. Ce protestant et humaniste français se brouille avec Calvin et devient professeur de grec à Bâle. Il est très gêné par le supplice de Michel Servet[4] à Genève, et rédige une œuvre qui n’est que la riposte à ce supplice, et qui s’intitule : « Le traité des hérétiques, à savoir si on les doit persécuter, et comme on se doit conduire avec eux, selon l’advis, opinion et sentence de plusieurs auteurs » (1554). Cette œuvre apparaît comme une œuvre de tolérance dans le sens où il y invite à l’acceptation de l’autre. Il y a une norme commune voire une limite que personne n’a le droit de transgresser, et cette limite, Castellion la restreint tellement que presque toutes les communautés qui s’entretuent (notamment les réformés et les catholiques) peuvent s’y conformer. Après avoir formulé une définition de ce que le terme hérétique pourrait signifier : « nous estimons hérétiques tous ceux qui ne s’accordent avec nous en notre opinion »[5], il donne la définition de cette norme qui serait un principe de tolérance, de paix, et d’acceptation de l’autre : « Hors de ces deux articles fondamentaux : « un seul Dieu et Jésus-Christ son fils », tous les autres points de doctrine sur lesquels les chrétiens se séparent, tel que le baptême, l’âme, le libre arbitre, etc., sont déclarés indifférents »[6]. Pour appuyer sa thèse, il fait référence à certains Pères de l’Eglise, à Luther, à Brenz, à Erasme, à Calvin, et à lui-même. Pratiquement, cette norme théorique pouvait être à l’origine du dénouement du problème que vivaient catholiques et protestants au siècle de la Réforme, puisque les problèmes principaux au sujet desquels ils s’affrontaient étaient d’ordre institutionnel, sacramentaire, théologique, et ne portaient pas sur la question de l’unicité de Dieu, ou sur la filiation divine de Jésus (bien que Luther ait quelques restrictions sur certaines formulations christologiques, notamment chalcédoniennes, il reste fidèle à la tradition christologique dogmatique traditionnelle).
Le traité de Castellion envisage la tolérance de diverses manières. Il est possible d’y lire : « qu’un chacun retourne à soi-même, et soit soigneux de corriger sa vie, et non de condamner les autres »[7]. Il invite aussi à une conversion intérieure et personnelle qui favoriserait la tolérance et l’acceptation de l’autre. Les réactions contre cette forme de pensée pousse Bèze à dire que la charité telle que la comprend Castellion est une charité diabolique et non chrétienne ; quant à Calvin, il le traite de monstre qui a autant de venin que d’audace[8].
En bref, les causes qui ont poussé Castellion à rédiger son traité, et bien avant, à se séparer de Calvin, sont au nombre de deux : premièrement, l’absolutisme de Calvin qu’il qualifiait de tyrannique (dans un manuscrit de Castellion intitulé : « Contra libellum Calvini » on lit : « Jean Calvin jouit aujourd’hui d’une très grande autorité, et je lui souhaiterais plus grande encore si je le voyais animé de sentiments plus doux »[9]) ; deuxièmement, l’intolérance vis-à-vis de ceux qui pensent différemment (cas Servet), ce qui pousse à considérer son courage comme un plaidoyer pour la tolérance. Sa tolérance a cependant ses limites, puisqu’elle se borne à la seule religion chrétienne (cf., la norme évoquée supra), et ne peut impliquer le judaïsme par exemple où Jésus-Christ n’est point reconnu comme fils de Dieu ou comme Christ. Mais il est possible de dire que son traité est d’une certaine manière un traité de la liberté du chrétien, puisqu’une fois le Dieu Un, ainsi que son Fils Jésus-Christ confessés, le chrétien a la liberté de suivre le chemin qu’il veut pour vivre cette confession, ou en d’autres termes, sa religion chrétienne. Nous pouvons qualifier cette liberté de liberté religieuse (chrétienne). Il faut toutefois être conscient que la véritable motivation de Castellion n’est pas cette exigence de liberté religieuse, mais la nécessité de lutter contre l’intolérance qu’il vit autour de lui, et qu’il ne put supporter, ce qui le poussa à réagir, et à rédiger son traité de tolérance.
John Locke (1632-1704), contemporain de Spinoza, est le principal initiateur de l’empirisme anglo-saxon. En 1689, il rédige une « Lettre sur la tolérance » (Epistola de tolerentia ad clarissimum virum). Comme tous les philosophes qui ont pensé la question de la tolérance, Locke n’écrit pas pour le plaisir de spéculer ; ce sont plusieurs circonstances politiques qui l’ont poussé à rédiger sa Lettre, entre autres, la persécution religieuse dans l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Cette persécution toucha même la personne de Locke qui fut contraint de fuir l’Angleterre vers les Pays-Bas pour des raisons politiques et religieuses.
Avant sa « Lettre sur la tolérance », Locke avait déjà composé en 1667 un « Essay concerning toleration ». Il y défendait la tolérance envers les non-anglicans, mais non envers les catholiques, qu’il dénomme papistes et qui font des confusions entre le spirituel et le politique. Il rédige aussi, entre 1673 et 1674 : « On the difference between civil and ecclesiastical power, indorsed excommunication », et en 1679 : « Tolerentio ».
Dans sa « Lettre sur la tolérance », Locke établit une distinction très claire entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. L’Etat jouit d’un pouvoir purement temporel, et n’a rien à voir dans le domaine rituel ou spirituel. Son devoir consiste « à veiller à la paix, à la sécurité et à l’intérêt publics, qui sont des biens terrestres »[10]. Ainsi, la liberté de jugement de chacun est sauvegardée. Pour qu’il y ait tolérance, il faut qu’il y ait séparation entre l’Eglise et l’Etat parce que l’intolérance n’est que la conséquence de la confusion entre ces deux domaines. Les Eglises (Locke les mentionne au pluriel) ne sont que des institutions privées qui n’ont rien à voir avec la collectivité (ou en d’autres termes avec tout ce qui a rapport au pouvoir civil, ou à la communauté civile ou politique).
Avec Locke, c’est un principe de laïcité de l’Etat qui prévaut. La question du culte est une question personnelle, et tout le monde a des droits égaux. A la différence de Castellion, sa tolérance s’étend aux païens, aux mahométans et aux Juifs. Il émet toutefois des réserves à l’égard des catholiques (les papistes) puisque par principe, ils sont une source d’instabilité sociale et politique du fait de reconnaître le pape comme souverain, c’est-à-dire comme autorité suprême, qui dépasse le spirituel et s’étend au temporel. Et puisque cette autorité que les catholiques revendiquent entre en conflit avec celle de l’Etat (ou du roi), Locke ne peut l’admettre.
Reste à noter que l’analyse de la tolérance chez Locke « se limite à la tolérance spécifiquement religieuse »[11]. Il cherche dans sa Lettre à donner des raisons philosophiques pour prouver qu’il ne faut point recourir à la persécution religieuse. Il tente de prouver l’irrationalité de la persécution religieuse.
En bref, la raison qui a poussé Locke à rédiger sa Lettre est le manque de tolérance religieuse. De par sa vision érastienne, la question du pouvoir relève de l’Etat, tandis que la question religieuse est une question personnelle. Est seulement rejetée la confession ou religion qui introduit une confusion entre ces deux domaines (à savoir les catholiques).
Pierre Bayle (1647-1706) est aussi un contemporain de Spinoza. C’est un auteur complexe qui est l’un des inspirateurs des Lumières. L’ouvrage de Bayle qui intéresse cet article est celui intitulé : « Commentaire philosophique sur ces paroles : Contrains-les d’entrer »[12]. C’est un des ouvrages fondateurs en matière de tolérance religieuse, mais qui, à la différence du texte de Locke, n’est pas un ouvrage de politique mais de controverse religieuse, notamment une critique de la justification augustinienne politique, laquelle, en se basant sur des textes d’Augustin, veut justifier la persécution des dissidents (en identifiant les donatistes qu’Augustin combattait et les protestants).
Bayle réfute dans son ouvrage toute conception et toute justification de la persécution religieuse. Il tente de prouver que la persécution est contraire à la lumière naturelle, à l’esprit de l’Evangile, qu’elle est chaotique, qu’elle s’oppose à l’Eglise pré-augustinienne, et surtout, qu’elle cause des guerres de religions infinies[13]. Il essaie aussi de montrer que ce n’est pas l’augustinisme politique qui est universel, mais la conscience morale. Il propose contre la persécution religieuse, la tolérance, qui est liée à l’affirmation des droits de la conscience, même si elle est erronée. « Dans la tolérance, pour Bayle, il est question fondamentalement d’une conscience morale « détachable » de l’entendement ou de la conscience religieuse »[14], ce qui le conduit à promouvoir une tolérance plus étendue que chez Locke, qui inclut même les athées. Dans ses « Pensées diverses sur la comète », l’idée de la vertu et du sens de l’honneur n’est pas exclue de l’athéisme, ce qui le mène à parler des athées vertueux, tels les épicuriens ou Spinoza.
Somme toute, Bayle avance deux arguments contre l’intolérance. Premièrement, il s’agit d’une falsification philosophique (de la lumière naturelle) et théologique (notamment biblique) pour appuyer les arguments de la persécution. Deuxièmement, cette persécution ne favorise point la paix, mais met les différentes parties en état de guerre perpétuelle.
Le dernier auteur qui intéresse cette réflexion est Voltaire (1694-1778). Bien qu’il soit d’une époque postérieure à celle de Spinoza, Voltaire s’inscrit dans ce mouvement de la tolérance et de la lutte contre la persécution religieuse. Il reprend par exemple, à sa façon, la critique de la théorie augustinienne que Bayle développe avant lui. Voltaire mène en outre plusieurs campagnes contre l’injustice et l’intolérance, notamment dans des affaires comme celles de Calas, de Sirvey et de Lally. En 1763, il publie une « Traité sur la tolérance ». Cet ouvrage est un traité de réhabilitation du protestant Callas qui a été injustement accusé d’avoir tué son fils (qui selon ses accusateurs, voulait se convertir au catholicisme), et fut supplicié sur la roue.
Ce traité dénonce le fanatisme, et Voltaire y plaide pour une attitude différente envers les protestants (il évoque aussi certaines injustices commises par les protestants contre les catholiques). Il y trace une histoire de la tolérance, et prend comme exemple Jésus-Christ, surtout contre la prétention chrétienne d’imposer le dogme ou la foi par la force, la contrainte ou la violence. Il est surtout frappé par le fait que certains veulent imposer aux autres des dogmes qui sont incertains et discutables. Il se moque des personnes qui croient que seule une religion est vraie, la leur. Voltaire apparaît dans cet ouvrage comme exaltant la fraternité avec toute l’humanité.
De la réflexion de Voltaire sur la tolérance dans ce traité, il est à retenir que Voltaire réagit d’une part contre une injustice, un fanatisme et une persécution religieuse, et qu’il réagit d’autre part contre une compréhension erronée du religieux (concernant les dogmes, l’exclusivité de la vérité, etc.). Son aspiration à la fraternité entre les être humains (en d’autres termes à la paix) est à souligner.
Ce parcours d’auteurs montre une progression de la réflexion sur la tolérance et sur l’acceptation de l’autre : de Castellion chez qui la tolérance se limite au domaine chrétien, à Locke qui l’admet pour les autres religions, à Bayle qui étend son acception aux athées, jusqu’à Voltaire qui prêche une fraternité universelle. Cette tolérance, nous la retrouvons chez Spinoza qui la développe à l’extrême. Le système spinoziste est en effet un système qui fait place à tous les types de personnes. Le sage qui vit selon la raison comme l’ignorant qui mène une vie passionnelle font tous deux partie de Dieu. Un retour à la théorie du droit naturel chez Spinoza permet de clarifier cette idée. Le conatus du sage qui suit les voies de la vérité, de la philosophie, est autant participant à la nature divine que le conatus de l’ignorant, celui qui est régi par ses passions plutôt que par sa raison. Spinoza arrive même à dire que les valeurs des sages sont équivalentes aux valeurs des ignorants. Ceci est évident du fait que pour le philosophe, il ne peut exister dans la Nature quelque chose qui soit contraire à la Nature. La Nature est une, univoque, moniste, et toutes les personnes jouissent du même droit de nature. L’égalité des hommes et l’admission de leurs diversités font partie des axiomes du système spinoziste. Même les passions font partie de la Nature, puisqu’il ne peut exister dans la Nature quelque chose d’autre que la Nature.
Cependant, trouver chez Spinoza cette ouverture à l’autre, et son acceptation extrême au point d’en faire un égal ne signifie pas que son traité ou sa pensée aient comme centre la tolérance. L’idée de tolérance est en effet présente, mais ce n’est pas elle qui prime dans le spinozisme. Déjà, les causes qui ont poussé les autres auteurs sus traités à rédiger leurs ouvrages sont assez différentes des causes qui ont poussé Spinoza à écrire. Il se trouve chez les quatre auteurs précédemment cités une réaction contre une persécution religieuse insoutenable. Le cas Servet chez Castellion, les persécutions religieuses en Angleterre chez Locke, la justification de la persécution chez Bayle, et les différents cas chez Voltaire. Bien que Spinoza ait été affecté par la mort d’une des personnes faisant partie de son cercle (Adrian Koerbagh), qui fut jugée pour avoir professé des opinions spinozistes, et qui périt en prison quinze mois après sa détention, et bien qu’il traite ouvertement de la question religieuse, c’est le problème de la liberté de pensée qui le préoccupe. Déjà, le cas de Koerbagh est un cas de philosophie et non de religion, puisqu’il a été jugé à cause de ses opinions philosophiques, et non à causes de ses opinions religieuses (bien que la procédure judiciaire ait été imprégnée de notions religieuses). Dans la préface du Traité théologico-politique, Spinoza affirme : « Si tel était le droit public que seuls les actes puissent être poursuivis, les paroles n’étant jamais punies, de semblables séditions ne pourraient se parer d’une apparence de droit, et les controverses ne se tourneraient pas en sédition. Puis donc que ce rare bonheur nous est échu de vivre dans une République, où une entière liberté de juger et d’honorer Dieu selon sa complexion propre est donnée à chacun, et où tous tiennent la liberté pour le plus cher et le plus doux des biens, j’ai cru ne pas entreprendre une œuvre d’ingratitude ou sans utilité, en montrant que non seulement cette liberté peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l’Etat, mais que même on ne pourrait la supprimer sans détruire la paix de l’Etat et la piété. Telle est la thèse que mon principal objet a été de démontrer dans ce Traité »[15]. Il ajoute aussi plus loin : « cette liberté peut et même doit être accordée sans danger pour la paix de l’Etat et le droit du souverain, elle ne peut être enlevée sans grand danger pour la paix et grand dommage pour l’Etat »[16]. Et de conclure : « ma conclusion est enfin que pour maintenir ce droit le mieux possible et assurer la sûreté de l’Etat, il faut laisser chacun libre de penser ce qu’il voudra et de dire ce qu’il pense »[17].
Ces trois citations poussent à conclure que le Traité théologico-politique est un traité sur la liberté de penser et non sur la tolérance. Bien qu’il est possible de parler d’une certaine tolérance et d’une acceptation de l’autre dans ce traité, c’est la liberté de penser qui prime, et Spinoza n’hésite pas à affirmer que ce fut la principale thèse qu’il voulait démontrer (selon sa célèbre lettre à Oldenburg). Mais, parvenu à ce stade, quelle différence faire entre un traité de tolérance et un traité de la liberté de philosopher ? A se borner à la définition du terme tolérance citée plus haut, il n’y aurait pas de différence. Cependant, cette analyse montre que les deux diffèrent. Dans les traités qui défendent la thèse de la tolérance, la tolérance est proposée comme solution au désordre social et politique causé par l’abus de pouvoir religieux, ou par l’insertion du religieux dans le politique, tandis que dans le cas de Spinoza, c’est la liberté de penser, ou plutôt le respect de la liberté de penser qui est proposé comme solution à l’impasse politico-religieuse.
Toutefois, les solutions proposées dans les deux cas (celui de la liberté et celui de la tolérance) mènent ou pourraient mener aux mêmes solutions. Dans le cas d’une tolérance poussée telle celle de Bayle ou celle de Voltaire, où tous les courants peuvent être inclus, y compris les athées, nous sommes très proches du spinozisme qui admet tout le monde (à une seule exception : que l’appartenance religieuse n’entre pas en contradiction ou en opposition au politique. Le système spinoziste est clair sur la question de la suprématie du politique, et en dehors de ce que le politique approuve, en dehors de la religion ou des religions que le politique approuve, aucune tolérance religieuse n’est possible, car une instance non approuvée par l’Etat est hors la loi). Ainsi, la différence qui peut être relevée est une différence de procédure et une différence de réflexion, et il est possible que des systèmes de pensée mènent aux mêmes résultats sans que leurs procédures soient forcément identiques. Même si un traité de la liberté de philosopher et un autre de tolérance mènent à des résultats qui se ressemblent et à des buts qui se rejoignent, l’exclusivité et l’originalité d’une œuvre ou d’une forme de réflexion ne peut être niée, surtout dans le cas de Spinoza, chez qui cette question de la liberté n’est pas liée à sa vision politique seule, mais à son ontologie.
En somme, le Traité théologico-politique est un traité sur la liberté du philosophe de philosopher, et en même temps sur la liberté de tous de vivre selon leur conatus, sous l’égide du politique bien sûr. Il était important de faire la distinction entre le traité de Spinoza et les traités de tolérance religieuse, puisque la confusion entre les deux est facile, et parce que la liberté est une notion qui occupe une place essentielle dans tout le système spinoziste. Cette nuance permettra de mieux comprendre la conception qu’a Spinoza de l’Etat, et sa compréhension du problème théologico-politique.
Dr Antoine Fleyfel
Paris 19.12.2007
————————————————-
[1] FOULQUIE Paul, Dictionnaire de la langue philosophique, PUF, Paris 1978, p. 729.
[2] La question de la tolérance est présente bien avant cette date, entre autres chez les Romains, et a pu avoir des sens bien différents. Il se produit cependant au XVIe siècle, un éclatement de cette notion.
[3] Cf., GUILLEMAIN Bernard, in Encyclopædia Universalis, Paris 1992, p. 713.
[4] Michel Servet (1511-1553) fut un médecin espagnol et un théologien protestant qui nia le dogme de la Trinité et la divinité du Christ. Fuyant l’Inquisition à Genève, il y fut brûlé suite à un procès où Calvin joua le rôle déterminant.
[5] In Encyclopédie philosophique universelle, les œuvres philosophiques, dictionnaire t. I, PUF, Paris 1992, p. 468
[6] Idem.
[7] Cité dans l’article Castellion Sébastien in Encyclopædia Universalis 2000 sur CD-ROM.
[8] Idem.
[9] Idem.
[10] In Encyclopédie philosophique universelle, op. cit., p. 1298
[11] Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, sous la direction de Monique CANTO-SPERBER, PUF, Paris 1996, p. 1537
[12] « Contrains-les d’y entrer » est une citation de l’Evangile selon Luc, 14, 23
[13] In Encyclopédie philosophique universelle, les œuvres philosophiques, dictionnaire t. I, PUF, Paris 1992, p. 962
[14] In Encyclopédie philosophique universelle, les notions philosophiques, dictionnaire t. II, PUF, Paris 1990, p. 2611
[15] SPINOZA B., Traité théologico-politique, GF Flammarion, Paris, 1965, p. 22
[16] Ibid., p. 26
[17] Ibid., p. 27
1. Introduction
Cet article a comme but de faire le point sur une question qui, suite au Concile du Vatican II, fait travailler l’Église Maronite sur plusieurs champs. Il s’agit des influences de l’Église Latine qu’a subies cette Église, ce qu’on appelle communément, la latinisation. Celle-ci la touche à plus d’un niveau, qu’il soit juridique, ecclésial, théologique ou liturgique. Les limites de cette étude se bornent à l’étude du phénomène de la latinisation de la liturgie maronite, tout en faisant parfois référence aux autres genres de latinisation. Le but de ces quelques pages ne serait pas seulement de traiter de la question d’un point de vue purement historique, c’est-à-dire en relatant les événements, mais aussi d’essayer de voir si la latinisation a été un phénomène grave qui a altéré sa liturgie, altération qui pour une Église au sein de laquelle le lex orandi, lex credendi fait tradition, correspondrait à une altération de son identité.
D’une manière officielle, la problématique contemporaine relative à la latinisation des Églises Orientales et au retour aux sources de leurs traditions, relève du deuxième Concile du Vatican. L’Église Catholique enseigne dans le décret « Orientalium Ecclesiarum » la nécessité de la résolution d’une telle problématique, puisque pour la pensée du Concile, il est admis que l’Église Catholique, unie dans sa foi, est diverse dans ses traditions orientales et occidentales, ce qui fait sa richesse et sa grandeur. L’Église Catholique considère les Églises Orientales avec beaucoup de respect en disant d’une manière claire que « Les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiastiques et la discipline chrétienne des Églises Orientales sont l’objet d’une grande estime de la part de l’Église Catholique » (OE, 1). Elle exprime sa volonté de « sauver dans leur intégrité les traditions de chacune des Églises particulières ou rites » (OE, 2), et pousse ces Églises à « faire effort pour revenir aux traditions ancestrales » (OE, 3). Et enfin, le Concile du Vatican II voudrait que certaines erreurs historiques commises par un esprit de conformisme liturgique soient corrigées. Pour ce faire, il « confirme et approuve l’ancienne discipline des sacrements en vigueur dans les Églises Orientales et la pratique qui en concerne la célébration et l’administration, et, si le cas le réclame, il souhaite qu’elle soit rétablie » (OE, 12).
Avait de traiter de la question de la latinisation de l’Église Maronite, j’essaierai d’examiner rapidement l’état des influences latines sur d’autres Églises Syriaques, pour montrer que la latinisation touche à plus d’une tradition antiochienne. Mon choix tombe sur deux Églises, l’une du Moyen-Orient et l’autre de l’Extrême-Orient. Je parle précisément de l’Église Syriaque Catholique et de l’Église Syro Malabar. Je ne choisis pas ces deux Églises seulement en raison de leur appartenance à la tradition syriaque, mais aussi parce que ce sont deux exemples bien éloignés, entre lesquelles se situe la latinisation de l’Église Maronite. L’Église Syro Malabar a en effet subi une très forte latinisation qui dépasse de loin celle qu’a subie l’Église Maronite, du moment que la latinisation est moins influente dans l’Église Syriaque Catholique que dans l’Église Maronite[1].
Par la suite, j’attaque l’essentiel de mon sujet, en essayant de comprendre la question de la latinisation de l’Église Maronite à partir de deux périodes, bien différentes quant à l’apport de la latinisation. La première époque s’étend du XIIIe au XVIe siècle, alors que la seconde couvre la période qui va de la fin du XVIe siècle jusqu’à la veille du Concile Vatican II. Si la première époque ne latinise l’Église maronite que d’une manière assez superficielle, la deuxième se plonge dans des zones qui lui sont bien intimes. Mais est-ce que cette deuxième période de latinisation est tellement grave, est-elle irrévocable, et aurait-elle changé la face de l’Église Maronite qui se forme, d’une manière principale à travers sa liturgie ?
2. L’Église Syro Malabar et la latinisation
Les origines de l’Église Syro Malabar remontent selon la tradition à l’Apôtre Thomas qui l’aurait établie en Inde. Les rites primordiaux de cette Église sont ceux de l’Église syriaque antiochienne. Suite à l’arrivée des missionnaires latins en Inde (XVIe s.), cette Église se soumet complètement à Rome, et se livre à une forte latinisation qui touche tous ses secteurs ecclésiaux : droit, organisation, liturgie, etc. Au cours de ces derniers siècles, l’Église Syro Malabar a eu conscience d’elle-même en tant qu’Église subordonnée à l’Église Latine, et elle faisait tout pour lui ressembler. Ce n’est d’ailleurs qu’en 1992 que le Saint Siège la déclare Église sui juris, et qu’une recherche sérieuse d’identité commence a être effectuée en son sein, surtout d’un point de vue liturgique.
C’est suite aux prescriptions du Concile du Vatican II qu’une partie de la hiérarchie syro malabar essaie d’entreprendre une réforme liturgique qui ramène cette Église à ses origines antiochiennes, et qui épure son rite, latinisé d’une manière excessive. Ce travail de réforme s’est retrouvé face à une grande résistance ecclésiale qui tenait à la latinisation. La résistance était tellement ample qu’un « évêque s’est écrié de démissionner, s’il était obligé de retourner aux formes strictement orientales »[2]. La latinisation de cette Église était si pénétrante qu’une grande partie de son clergé attendait le jour où ils ressembleraient en tout à l’Église Latine.
Même en 1968, trois ans après la clôture du concile, le texte du Qurbana « ad experimentum » était toujours à tendance latine qui consiste « à réduire les textes et mouvements liturgiques, l’emploi de l’encens, de choisir entre le symbole de Nicée et celui dit « apostolique » (de l’Église romaine), de communier les fidèles sous l’espèce du pain seul etc. »[3]. D’ailleurs cette Église en était arrivée à admettre la célébration des messes basses, qui correspondent à l’usage de l’Église Latine et non à celui des Églises Orientales pour qui la messe est toujours solennelle. Des trois anaphores existant dans leur messe, une seule est utilisée, celle d’Addaï et Mari, d’ailleurs « latinisée à outrance ». Tout ceci sans mentionner les pauses de silence, les prières improvisées, et les « restructurations des rites préanaphoraux selon des modèles latins » [4]. Les vêtements liturgiques utilisés sont ceux de l’Église Latine, et les vêtements traditionnels sont mis de côté. Les détails de la latinisation de la messe syro malabar sont trop longs pour être cités ici, surtout que cette messe en est arrivée à être plus latine qu’orientale.
La latinisation touche aussi aux autres sacrements, et leur célébration est presque calquée sur les célébrations sacramentelles latines. Pour n’en donner que quelques exemples, je mentionne les formules baptismales qui sont actives (latines) plutôt que passives (orientales), la séparation des trois sacrements de l’initiation, et le privilège de la bénédiction des huiles par les évêques. Actuellement, cette Église indienne est toujours en plein travail de réforme liturgique et ecclésiale, qui l’aiderait à retrouver ses sources, et à définir sa personnalité propre.
3. L’Église Syriaque Catholique et la latinisation
L’Église Syriaque Catholique naît au XVIIe siècle. Elle est composée des Jacobites (les Syriaques Orthodoxes) qui ont voulu s’unir à Rome. Au début de ce schisme, les rites de l’Église Syriaque Catholique ressemblaient à ceux de son Église mère, alors qu’au fur et à mesure que cette Église se rapprochait de Rome, sa structure, son ecclésiologie, son droit et sa liturgie se latinisaient.
La latinisation liturgique de l’Église Syriaque Catholique est loin de ressembler à la latinisation qu’a subi l’Église Syro Malabar. Elle est même plus légère que la latinisation qu’ont subi les maronites. G. Khouri-Sarkis l’affirme en montrant les similarité toujours évidentes entre les deux Églises syriaques sœurs : « entre les Syriens catholiques et leurs frères orthodoxes les différences sont minimes. Elles se réduisent à quelques infiltrations étrangères et notamment latines, qui se sont introduites chez les premiers, tantôt par décision officielle, tantôt par simple mimétisme »[5]. Toutefois, autant optimistes que pourraient être ces phrases, les influences latines sont bien présentes dans la liturgie syriaque catholique, et dès Vatican II, nombreux sont ceux qui ont entrepris la tâche de restaurer cette liturgie à partir des sources anciennes qui remontent au XVIIe siècle, voire au XIIe et jusqu’aux Pères de l’Église Syriaque, comme Sévère d’Antioche ou Jacques d’Édesse.
Khouri-Sarkis remonte les influences latines au-delà du XVIIe siècle. Il est question d’influences missionnaires à partir du XVe siècle, influences qui ont introduit beaucoup d’éléments étrangers à la liturgie syriaque. Mais c’est surtout « depuis leur union avec Rome, [que les Syriaques Catholiques] ont adopté certains usages occidentaux, et notamment la célébration quotidienne de la messe par chaque prêtre. Il en a résulté que de nombreux canon des Pères syriens ont été abandonnés… »[6]. Au sein de l’Église Syriaque Catholique, on célébrait même des messes basses.
Au cours du XIXe siècle, l’Église syriaque orthodoxe subit maintes tentatives puissantes de latinisation. Mais c’est grâce à la résistance de certains hiérarques que ces tentatives ont parfois pu être freinées. En 1843, le Missel Syriaque édité à Rome « faisait de la célébration de la messe syrienne et, plus particulièrement encore, de la messe pontificale, ou même seulement solennelle, une parodie à l’usage des Syriens, de la grand’messe latine ». Et quelques décennies plus tard, en 1888, le synode de Charfet « aurait entériné toutes les latinisations déjà opérée par le missel de 1843 et y aurait ajouté de nombreuses autres (…) si la réforme latinisante envisagée ne s’était pas heurtée à une opposition farouche de la part du patriarche, […] [qui] essayait de réduire les dégâts à leur strict minimum »[7].
En 1922, le grand savant et liturgiste le patriarche Rahmani entreprend un grand effort d’épuration de tout ce qui est étranger à la liturgie syriaque du Missel. Malgré certains résultats bénéfiques, il n’est pas allé très loin, ou peut- être ne pouvait-il pas. Toutefois, à certains niveaux, il a aggravé la latinisation, et s’est éloigné des usages de l’Église Syriaque Orthodoxe, en essayant d’imiter dans la messe l’Agnus Dei, l’usage des hosties latines, et la communion sous une seule espèce. Même les cancels et les rideaux disparaissent de l’Église.
Actuellement l’Église Syriaque Catholique est toujours en train de réformer sa liturgie, dans un sens qui va vers un retour aux sources syriaques antiochiennes, et qui épure cette liturgie des influences latines.
4. L’Église Maronite et la latinisation : des origines jusqu’au XVIe siècle
Les influences extérieures sur les liturgies syriaques ne datent pas des interventions latines en Orient. Bien avant, ces liturgies avaient aussi subi les influences de la liturgie de l’empire byzantin. À une période historique qui se situe dans la seconde moitié du premier millénaire, cette liturgie était tellement influente que l’Église Melchite Antiochienne, a laissé tomber définitivement sa liturgie syriaque, et s’est appropriée la liturgie byzantine. Cette adoption était surtout pour cette Église un signe de soumission et d’appartenance à l’Église de l’Empire. Comme quoi, plusieurs siècles avant le début de la latinisation des maronites au XIIIe siècle, l’idée de l’adoption d’une liturgie qui marque l’appartenance doctrinale et politique à une entité politico-religieuse était d’actualité. Le Patriarcat de Rome n’est pas le premier à avoir faire adopter à une Église relevant d’un autre Patriarcat sa liturgie. Toutefois, malgré ces influences byzantines et latines, les Églises Syriaques ont réussi à garder l’essentiel de leur liturgie, qui ressort toute une théologie et une vision du monde très attachée à la Bible. Michel Hayek l’exprime en ces termes : « Théologiquement elles [les Églises Syriaques] conservent cette vision biblique du monde et de Dieu dont l’hellénisme envahissant n’avait réussi à entamer la surface, et que la latinisation ultérieure n’aura point détourné de ses orientations profondes. Comme pour la Bible, cette vision est atomistique et cosmique, face au psychologisme latin en mystique et son monoïdéisme en dogmatique, face aussi au doxologisme grec en liturgie »[8].
L’Église Maronite a depuis ses débuts, eu des relations privilégiées avec l’Église Latine. Ce n’est pas seulement le fait d’être défenseur de la foi orthodoxe du Concile de Chalcédoine qui le souligne, mais aussi les relations ultérieures qu’elle a eues avec la papauté, et la conscience filiale liée à ces relations. Nous le savons par exemple à travers une lettre adressée par ses moines en 517 à l’attention du pape Hormisdas pour protester contre la persécution qu’ils ont subie en raison de leur foi chalcédonienne et de leur attachement au siège pétrinien. Cette lettre protestait contre l’événement au cours duquel le patriarche Sévère d’Antioche lâcha contre les moines maronites ses « loups rapaces » et tua 350 moines. Elle montre bien comment les maronites considéraient dès la genèse de leur Église, leur appartenance à l’Église Catholique. À la période croisade, plusieurs légendes véhiculées par la tradition orale maronite parlaient de la parenté lointaine de Jean-Maroun avec Charlemagne, et de l’ « intervention apostolique par l’intermédiaire du délégué pontifical Jean de Philadelphie qui aurait sacré évêque le premier patriarche maronite »[9]. Mise à l’écart la question de l’historicité de ces traditions orales, l’esprit qui en ressort marque d’un manière bien profonde la conscience qu’a l’Église Maronite de son appartenance à l’Église du pape.
Toutefois, ces quelques bribes historiques ne sont pas suffisantes pour parler d’une latinisation de l’Église Maronite, et ne peuvent d’ailleurs, en aucun sens être considérées comme une latinisation, mais seulement comme la marque d’une appartenance profonde de l’Église maronite à l’Église universelle. La latinisation ne commencera à s’installer dans l’Église de saint Maroun qu’à partir du XIIIe siècle, lorsque l’Église Maronite, en coupure de relations avec le siège de Rome pour plusieurs siècles en raison de l’occupation musulmane de l’Orient, reprend ces relations, à partir du XIIe siècle par le biais des croisés avec qui ils ont entretenu des relations privilégiées. Pierre Dib parle de cette cordialité avec les États latins d’Orient qui « s’exprime aisément quand on pense que les maronites se considéraient comme en parfaite communion de foi avec l’Église Latine »[10]. D’ailleurs, les fils de Maroun obtiennent une place privilégiée au sein des État latins d’Orient : il « étaient admis dans les rangs de la bourgeoisie et bénéficiaient du même droit que les bourgeois latins »[11].
Mais le problème de cette époque consiste en ce que les francs étaient incapables d’admettre une orthodoxie de la foi qui ne soit pas appuyée par une uniformité rituelle et légale. Nous sommes là bien loin de la diversité ecclésiale prônée par le deuxième Concile du Vatican. Bien que considérant les maronites avec sympathie, les Francs avaient besoin de voir en l’Église Maronite une Église qui ressemble à l’Église Latine. Ce qui était contraire aux coutumes occidentales paraissait suspect pour eux. Resituée dans son époque, cette conception est tout à fait compréhensible. Un auteur latin de cette époque, Jacques de Vitry, voulait que le peuple maronite « se rapproche autant que possible de ses Seigneurs et de ses alliés [les latins], en rejetant de ses coutumes orientales ce qui peut attirer les soupçons et en adaptant tous les usages des francs pour gagner la sympathie de ces derniers »[12]. L’activité latinisante de l’Église Romaine est en train de prendre place à partir de l’alliance entre les maronites et les croisés, et c’est au XIIIe siècle que se situe le début officiel de la latinisation de cette Église.
L’événement qui se situe au commencement de cette latinisation est celui de la visite d’un éminent patriarche maronite à Rome, Jérémie él Amchiti. Ce dernier arrive à Rome en 1209, et y demeure pendant cinq ans et demi. Il assiste au Concile Général de la Ville connu sous le nom du quatrième Concile du Latran. C’est durant ce Concile que le pape, Innocent III, va formuler d’une manière officielle sa volonté de vouloir conformer l’Église Maronite à l’Église Latine en tout, pas seulement en matière dogmatique, mais aussi en matière sacramentelle et vestimentaire. Ce pape met en exécution son rêve de vouloir universaliser le rite latin, et de l’appliquer à toute la chrétienté. Le patriarche maronite répond immédiatement au désir du Saint-Père, et dès son retour au Liban, le clergé maronite commence – dans la mesure du possible – à se vêtir à la manière latine, et à se conformer aux rituels et prescriptions canoniques de l’Église de Rome. Ils ont considéré que la volonté d’union avec Rome l’emportait sur les différences rituelles.
D’une manière plus pratique, les maronites ont commencé à partir de cette date à appliquer à leur Église orientale des coutumes qui lui sont étrangers. Les décrets de Latran IV faisaient autorité pour cette petite communauté qui a commencé à introduire des prescriptions telle la « confession annuelle » ou la « communion pascale ». Davantage, « un manuscrit de 1281 ne requiert pour la confection du chrême que l’huile et le baume [ce qui n’était pas du tout en usage dans l’Église Maronite qui faisait le chrême à partir d’une longue liste d’ingrédients]. Un pontifical de 1296 mentionne l’imposition de la mitre aux évêques ; certains rites d’ordinations ressemblent étonnement à leurs analogues latins : présentation des ordinants, tonsure, porrection des instruments et des livres sacrés… »[13]. La liste est longue, et elle témoigne d’une latinisation qui se met en œuvre dans l’Église Maronite qui met de côté ses usages syriaques antiochiens, et qui adopte des usages qui ne relèvent pas de sa tradition, tout cela, au nom de sa volonté de marquer sa communion et sa soumission au Saint Siège. De cette époque, nous avons aussi un précieux témoignage qui qualifie le taux de latinisation qui touchait l’Église maronite. Environ deux cent ans après la retraite des croisés, Fra Gryphon, un délégué de Rome s’exprimait de la sorte : « Les maronites en Europe, à Chypre, à Rhodes, à Tripoli, à Beyrouth et à Jérusalem, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, entrent dans les églises des Latins, et, revêtus de leur ornements sacrés, ils offrent sur leurs autels le sacrifice de la messe comme eux, ils élèvent le Corps et le Sangs, et comme eux ils font le signe de la croix. Ils se confessent chez eux et reçoivent des mains de leurs prêtres l’Eucharistie, de même qu’ils reçoivent d’eux des présents, tels la mitre et autres choses »[14]. Ce texte témoigne que la latinisation qui a été entreprise par Innocent III s’est à une certaine mesure réalisée dans l’Église Maronite.
Cependant, une autre circonstance historique va aller à l’encontre de cette latinisation en la freinant. Suite à la disparition des États Latins (à la fin du XIIIe siècle), les maronites se sont trouvés couper de l’occident, et ce que le frère Gryphon relate de sa visite de l’Église Maronite n’est qu’un latinisation qu’elle avait subie durant l’époque croisée, et qui ne s’est plus développée après leur déclin. Nombre de chercheurs soulignent que non seulement la latinisation de l’Église Maronite a été freinée, mais aussi que l’Église Jacobite a profité de cette période pour influencer à son tour l’Église de Maroun, et elle a à un certain niveau réussi (l’œuvre du patriarche Dwayhi en témoigne). Dib l’exprime en disant que « le danger de latinisation s’est éloigné du fait de l’interruption des communication avec Rome et l’Occident »[15].
Suite à toutes ces vicissitudes, et se basant sur les rares textes liturgiques maronites qui nous sont parvenus de cette période, il est a conclure que jusqu’au XVe siècle, la latinisation de l’Église Maronite fut une latinisation bien limitée, et qu’elle ne touchait pas à l’essence liturgique ni même à la discipline de cette Église. Même si la latinisation de l’Église de saint Maroun commence officiellement au XIIIe siècle, ce n’est qu’à partir de la fin du XVIe siècle qu’elle sera sérieuse et effective. Alors qu’avant cette époque, « ses effets se réduisaient presque uniquement à quelques détails extérieurs et d’importance secondaire, tels que le port de l’anneau, de la mitre et de la crosse par les prélats ; la manière de faire le signe de la croix, l’usage des cloches, du pain azyme et des ornements sacrés »[16]. Les textes romains datant du XVIe siècle montrent bien que l’Église Maronite avait plein de pratiques qui relèvent de la tradition orientale commune, telle l’administration des sacrements de l’initiation chrétienne à l’enfance, ou la communion sous les deux espèces. Jusqu’au XVe siècle, et même jusqu’à une grande partie du XVIe, l’Église Maronite était toujours fidèle à ses traditions ancestrales, et à sa personnalité syriaque antiochienne. La latinisation qu’elle subit est bien légère, et elle ne modifie en elle rien d’essentiel. Au contraire, ses relations avec l’Église Latine lui furent bénéfiques à plus d’un niveau, et il n’est pas difficile de comprendre les latinisations qu’elle a subies à cette époque comme le fruit d’un échange culturel, qui n’a rien de mauvais. Les latins ont après tout donné aux maronites le meilleur de ce qu’ils avaient, et en voulant par exemple voir un évêque avec une crosse et une mitre, ils n’ont voulu aux maronites que ce qu’ils veulent à eux-mêmes. De plus, ces changements n’ont pas été seulement adaptés par les maronites, mais ils ont aussi été appropriés par eux. Ces usages n’étaient plus des usages étrangers à leur Église, mais des usages qui en sont devenus une partie intégrante, sans pour le moins altérer l’identité ecclésiale des fils de Maroun. Il serait insensé de demander aux maronites de laisser tomber les influences latines de cette époques (mitre, crosses, cloches, etc.), que de demander aux arméniens de laisser tomber l’usage de la mitre parce que celui-ci est entré dans la tradition de leur Église aux cours du IXe siècle suite à un échange avec l’Église Latine. Peut-être que sur certains détails, ont pourrait se poser des questions, comme par exemple sur l’utilisation du pain azyme qui ne fait pas partie des prescriptions du « Livre de la Direction », mais en général, ce que l’Église Maronite a pris des Latins jusqu’au XVIe a fait partie de sa personnalité, sans pour autant saper, altérer ou déformer son entité propre. Ces nouveaux usages entrent en majorité en symbiose avec ses anciens usages, et s’il faut être honnête, il faut dire que la demande qu’a faite le pape Innocent III au maronites de se conformer en tout aux usages latins est d’une manière générale restée lettre morte, vu que les changements fussent tellement extérieurs et marginaux. Alors, pourquoi cette première tentative de latinisation n’a pas pu aboutir ? C’est probablement comme le dit Paul Naaman, parce que « les maronites étaient jaloux de leurs traditions orientales »[17].
5. L’Église Maronite et la latinisation, de la fin du XVIe siècle jusqu’au Concile du Vatican II
La situation politique à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle est bien différente de celle des deux siècles précédents. Si ceux-ci n’ont pas permis aux maronites de pouvoir mener des relations en bonne et due forme avec le Saint Siège, l’ère ottomane va être quelque peu différente. Il y aura toujours des difficultés d’ordre politique et pratique, mais en général, les relations reprennent, et d’une manière assez étroite. Non sans difficultés, les légats du pape arrivent à parvenir chez les maronites, qui ont désormais la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec Rome, voire de lui rendre visite et d’y envoyer des élèves pour se former dans le Collège Maronite.
Le premier événement marquant de cette deuxième étape de latinisation de l’Église maronite, est celui de la légation d’Eliano qui est de très mauvaise mémoire chez les maronites. Il « fut l’un des agents les plus actifs de la latinisation de l’Église Maronite »[18]. C’est par son intermédiaire que le pape Grégoire XIII envoie au patriarche maronite, en 1577, les décrets et les canons du Concile de Trente. Comme au XIIIe siècle, la papauté s’attend des maronites à ce qu’ils appliquent les prescriptions relatives à l’Église Latine, sans distinctions disciplinaires ou dogmatiques. Toutes les règles du Concile devaient être appliquées par les maronites. Et à la différence du XIIIe siècle, cette volonté pontificale ne va pas rester lettre morte, et Eliano va veiller avec un grand zèle, non dénué d’insolence, voire d’ignorance parfois, à mettre en réalisation ce projet de latinisation de l’Église Maronite.
Rien qu’à lire les rapports qu’Eliano a faits sur l’état de l’Église Maronite, et ses projets pour un synode maronite, nous avons conscience d’être devant un projet de latinisation de cette Église qui est loin d’être superficiel. La liste est longue, mais à titre d’exemple, je mentionne quelques idées maîtresses qu’Eliano envisage. Dans son inventaire sur l’Église Maronite qui se résume par une phrase clef, Eliano écrit : « Il faudra exhorter le peuple à recevoir l’usage romain » ; le légat du pape dit que « les maronites consacrent l’eau toutes les fois qu’ils veulent baptiser, au lieu de bénir les fonts une fois par an le Samedi Saint : il faut introduire la bénédiction des fonts le Samedi Saint »[19], ce qui certes s’apparente à l’usage latin. Et de dire aussi que « dans l’Église maronite, on célèbre la messe avec du pain azyme, et les laïcs communient sous les deux espèces : il faut écarter progressivement les laïcs de la communion sous les deux espèces, à cause du péril de verser le précieux sang »[20]. Encore un autre exemple de latinisation qui va à l’encontre des traditions antiques maronites, puisque le « Livre de la Direction », datant du XIe siècle mentionne d’une manière claire du pain eucharistique qu’il « ne doit pas être azyme, mais levé avec du levain mêlé au Qurbân »[21]. Davantage, Eliano veut tellement conformer les usages maronites aux usages latins qu’il veut remplacer le Pontifical maronite par le Pontifical romain. Dans son projet de synode maronite, Eliano poursuit toujours dans la même logique, et veut par exemple que l’Église Maronite ne célèbre la messe qu’en utilisant les mêmes hosties qu’utilise l’Église Romaine, qu’il y ait dans les Églises des vases d’eau bénite selon les mêmes usages latins, etc.
En 1580, le pape Grégoire XIII envoie une seconde légation envers les maronites sous la direction d’Eliano, et « exprime le vœu que les maronites s’accordent avec le Saint Siège, tant dans les dogmes que dans les rites ecclésiastiques »[22]. C’est par cette légation que Rome a voulu introduire son calendrier (qui sera adopté par les maronites en 1606), ainsi que le Rosaire qui était ignoré par tous les chrétiens orientaux. Le synode de Qannoubine qui se réunira en cette même année approuvera toutes ces réformes latines, et le projet d’Eliano sera un succès pour la latinisation qui va pour la première fois pénétrer l’Église Maronite de manière à lui changer maintes habitudes et formules liturgiques fondamentales. Même les formules baptismales passeront d’une formulation orientale passive : « tel est baptisé… », à une formulation latine active : « je te baptise… ». Si la latinisation de l’Église Maronite relève d’une volonté romaine, sa réalisation prend place d’une manière officielle et sérieuse au cours du premier synode moderne de l’Église maronite en 1580.
Parallèlement à ces événements qui se déroulaient au Mont Liban, deux autres événements qui se déroulaient à Rome sont à mentionner, puisqu’ils appuyaient le processus de latinisation qui touchait l’Église de Maroun. Le premier événement est celui de la fondation du Collège Maronite en 1584, qui avait comme but la consolidation des liens entre les Églises Romaine et Maronite. La majorité des élèves qui y seront formés vont être de tendance latinisante marquée. Le second événement est celui de la mise à la disposition des maronites d’une imprimerie par Grégoire XIII. Cette imprimerie « contribua largement à consacrer définitivement le caractère latinisant des livres liturgiques et théologiques, mettant progressivement fin à l’activité des copistes et aux particularités liturgiques. Il est à noter que le rôle des élèves du Collège maronite dans cette affaire fut généralement prépondérant »[23].
Malgré les efforts d’Eliano de latiniser l’Église Maronite, celle-ci résistait, et tenait bien à nombre de ses traditions anciennes. C’est surtout en la personne du patriarche Sarkis Rizzi que s’est manifestée cette résistance, puisqu’il était attaché aux traditions anciennes de sa communauté, et ce à la différence de son neveu Joseph Rizzi, qui va lui succéder au siège patriarcal, et qui était « à tendance latinisantes marquées »[24]. C’est d’ailleurs cette résistance du Patriarche Sarkis qui va freiner quelque peu l’entreprise d’Eliano, et qui va pousser Rome à envoyer un autre légation sous la direction de Dandini, une personne plus ouverte qu’Eliano, qui va obtenir des maronites par la douceur, ce que Eliano n’a pas pu obtenir par l’autorité. À l’arrivée de Dandini, et durant sa rencontre avec le chef de l’Église Maronite d’ailleurs bien malade, voire mourrant, le patriarche protestait contre les résultats de la légation d’Eliano et du synode de 1580 dont il niait la légitimité. C’est pour cette raison qu’un deuxième synode va être tenu à Qannoubine en 1596, et malheureusement pour la tradition maronite, c’est le nouveau patriarche latinisant qui va le terminer, et qui va permettre à la légation romaine de pouvoir mettre à exécution les projets de latinisation de l’Église Maronite. Il y aura maintes conséquences à cette latinisation, et les décrets du synode seront loin d’être syriaques antiochiens ; ils s’inscrivent plutôt pleinement dans une logique latine, scholastique et tridentine : « […] procession de l’Esprit du Père et du Fils […] ; double application possible du Trisagion ; existence du purgatoire, universalité du péché originel : sans baptême les enfants n’auront pas le salut ; vision béatifique ou tourment des âmes immédiatement après la mort ; illégalité de l’apostasie même de bouche ; séparation du baptême et de la confirmation dont le ministre est l’évêque : composition du saint chrême de baume et d’huile ; interdiction d’employer le pain fermenté pour la messe ; consécration de l’huile des malades par le seul évêque le Jeudi saint ; la forme des sacrements est de l’Église Romaine ; indissolubilité du mariage, même si la séparation des corps est prononcée »[25]. De toute façon, il faut dire que c’est à partir des deux légations d’Eliano et de Dandini qui mirent en doute l’orthodoxie des Maronite, que la latinisation systématique de l’Église Maronite commençait à prendre cours, surtout qu’elle sera appuyée par la hiérarchie, qui à partir du patriarche Joseph Rizzi qui va amplement contribuer à l’exécution des décrets du deuxième synode de Qannoubine, et va répandre la vision latinisée de l’Église Maronite. Il ne sera d’ailleurs pas le seul, puisqu’au qu’au fur et à mesure qu’il y aura des élèves maronites formés à Rome, la latinisation de l’Église Maronite prendra de l’ampleur. L’un de ces élèves qu’il faut mentionner n’est autre que la patriarche Amira qui « était si marqué par l’influence latine qu’il fut appelé le « patriarche romain » »[26]. La latinisation de l’Église Maronite n’était plus un phénomène qui lui est imposé par l’extérieur, ou par une volonté pontificale, mais elle découlait de la hiérarchie maronite elle-même, convaincue de la nécessité de se conformer en tout aux usages de l’Église Latine.
Deux ans après le deuxième synode de Qannoubine, un autre synode maronite va se réunir à Day’it Moussa. Ce synode va s’inscrire dans une lignée directe du synode précédant, et va introduire plusieurs usages latins, telle la séparation du baptême et de la conformation, le rejet de la communion avant l’âge de 7 ans, et l’uniformatisation des paroles consécratoires durant la messe : « Nul ne dira la messe que par ces paroles : « Ceci est en effet mon corps. Ceci est en effet le calice de mon sang »[27].
Toutefois, la latinisation de l’Église Maronite n’était pas cause gagnée, puisqu’en 1644, un quatrième synode maronite va se réunir à Hrach, et aura comme but principal la tâche de s’occuper « du retour aux anciens usages maronites modifiés par le précédent Synode »[28]. Malgré les efforts de Rome et des élèves du Collège Maronite, l’Église Maronite avait une profonde conscience de son identité syriaque antiochienne qui était tellement collée à la constitution intime de sa personnalité, qu’une altération sérieuse de son entité était extrêmement difficile.
C’est une grande figure de l’Église Maronite, le patriarche Estéphane Dwayhi (1670-1704), qui va faire face à ces essais d’altération, et qui va une fois pour toute définir l’identité orientale antiochienne syriaque de l’Église de Saint Maroun. Il est un réformateur qui va affronter deux camps : « deux écueils l’y attendaient qu’il sut mieux que tout autre éviter : la jacobitisation et la latinisation »[29].
Peut-être que rien ne montrait que cet élève du Collège Maronite qu’était le patriarche Dwayhi, serait tellement attaché à l’identité syriaque de son Église. Mais même avant son élection patriarcale, le jeune Estéphane parcourait les paroisses, recherchait les manuscrits et les scrutait. Il écrivait, essayait de rejoindre une pureté de la tradition maronite, et appuyé par une érudition théologique, liturgique et historique hors normes, il rédigeait les ouvrages qui vont faire référence dans l’Église Maronite. L’ouvrage qu’il faut le plus retenir pour cet article n’est autre que son célèbre « Candélabre des Saints Mystères », qui n’est pas seulement un livre de liturgie historique maronite, mais aussi un traité théologique qui laisse ressortir l’identité antiochienne syriaque de l’Église Maronite, un traité de théologie qui au sein d’une époque latinisante, professe une pensée beaucoup plus biblique que scholastique, beaucoup plus orientale qu’occidentale. Bien que le patriarche ne manque pas de mentionner le Concile de Trente et de s’appuyer sur ses décrets. Bien qu’il mentionne d’autres Conciles occidentaux et que sa réflexion s’inscrivent parfois dans le cadre d’une polémique qui relève de la contre réforme (comme sur la question de la consubstantiation par exemple qui est totalement étrangère à une pensée théologique orientale, qu’elle soit syriaque ou byzantine), ses dissertations sont principalement bâties sur des données scripturaires. Son écrit relève d’une réflexion théologique orientale qui comprend plus la théologie en tant que mystère liturgique vécu, qu’en tant que question intellectuelle et dogmatique relevant de décrets et de réflexions aristotélistes parfois. Le patriarche parle facilement des traditions principales des Églises, il se réfère aux anciens Pères et aux premiers Conciles qu’il cite avec aisance. Il est bien clair qu’en parlant des traditions latines et maronites, Dwayhi sait bien de quoi il est en train de parler. Il en fait bien la distinction, et il est bien conscient de la différence de ces deux traditions, et de la nécessité de préserver sa propre tradition. Pour ce faire, Dwayhi va dénoncer toute influence jacobite sur le rite maronite, et va par son attitude vis-à-vis de la latinisation freiner son avancement dans l’Église Maronite.
Dwayhi ne va pas s’attaquer de front à la latinisation. Les circonstances de son temps ne le lui permettent pas. « Par obéissance à l’autorité suprême du Saint Siège qui avait tendance depuis Innocent III déjà en 1215 à introduire les usages de l’Église Romaine, il a accepté toutes les décisions relatives à la liturgie que les synodes précédents avaient portées »[30]. C’est pour cette raison qu’il va évoquer certaines coutumes latines qui se sont introduites dans l’Église Maronite comme des coutumes allant de soi. Pour n’en donner que quelques exemples : le lavement des mains du prêtre durant la messe, la mitre et la crosse de l’évêque et le pain eucharistique azyme.
Sa manière d’exposer les actions liturgiques maronites, et surtout ceux relatifs à la messe, se basent sur un souci de pureté de la tradition syriaque maronite ; la clarté de son exposé et la fixation liturgique qui en découle vont être un facteur de résistance à la latinisation montante de l’Église Maronite. Vu l’importance de la personne du patriarche et de la valeur érudite de son œuvre, il sera impossible de faire abstraction de son entreprise, et d’agir comme si elle n’avait pas existé. Par exemple, il mentionne la structure de la messe maronite en soulignant les éléments qui sont propres à la tradition syriaque, voire à la tradition maronite, comme le Houssoyo, ou le Mazmouro. Il parle de ces éléments d’une manière détaillée et avec une autorité qui ne permettrai à aucune autre forme de substitution latine de se substituer à elle. Dwayhi fixe par son œuvre la liturgie maronite selon des normes syriaques antiochiennes qui barrent la route devant toute latinisation ultérieure excessive de la liturgie maronite.
Un peu plus de trois décennies s’écoulent pour que se réunisse dans des conditions politiques et communautaires difficiles, le synode maronite du Mont Liban en 1736. À première vue, ce synode a tout pour être un synode latinisant, surtout qu’il s’inscrit dans la lignée des efforts de latinisation qui ont commencé à partir de la fin du XVIe siècle. Déjà, le texte fondamental du synode a été écrit à Rome, par l’érudit maronite Assémani, en latin. Celui-ci le relate dans la chronique de sa mission en disant que « Le Patriarche et les Évêques, ont demandé au légat du Saint Siège, la copie latine du synode… qu’il avait fait à Rome, pour signer […]. Le Légat est rentré de Qannoubine à Louayzi pour continuer la traduction du latin en arabe du futur Synode »[31]. De plus, le même Assémani écrivait dans son rapport sur le synode présenté au pape Clément XII que « les canons décrétés dans ce synode contiennent en effet la somme de ce qu’on doit croire et pratiquer ; cette somme affirme-t-il, est puisée dans les Saints Conciles et surtout dans celui de Trente avec certaines ajouts du rite particulier de la Nation maronite »[32]. Il est vrai d’ailleurs, que d’un point de vue légal, le synode est fortement influencé par le droit de l’Église Latine. L’article concernant l’Église Maronite dans le « Dictionnaire du droit canonique » le montre bien en disant que « presque tout le droit latin du mariage est admis ; l’usage du pain azyme est imposé : en ce qui concerne le baptême, la confirmation, l’extrême onction, le choix est laissé entre la forme sacramentelle latine et la forme orientale, mais la formule d’absolution conforme à celle du Rituel romain est seule tolérée »[33].
Il est vrai que le synode du Mont Liban latinise, puisqu’il reste le fils de son époque qui est difficilement concevable hors des normes culturelles qui relèvent du XVIIIe siècle. Toutefois, ceux qui ont vu dans ce synode un triomphe de la latinisation systématique ont tort. Sans oublier qu’ils mettent en doute la fidélité de l’éminent Assémani à son Église, il ressort du synode que maintes traditions maronites antiques « furent rétablies, ou tout au moins ont été susceptibles de l’être ; car le synode, et c’est en cela qu’il est un chef-d’œuvre, ouvre en ce sens de grandes possibilités sur l’avenir. Là où son auteur se trouvait lié par des décisions antérieures, il manifeste une nostalgie évidente, sinon un dépit, en pensant aux rites anciens abandonnés »[34]. Michel Hayek décrit davantage la situation de ce synode qui est pour lui une certaine forme de retour aux sources en disant de lui qu’il « a enregistré les faits et accepté les déformations du passé, en se portant de ses vœux vers l’avenir dont il escomptait des réalisations qui ne sont pas encore venues : pieuses dispositions insérées dans le texte, comme de sourdes protestations, des revanches verbales sur les déformations déjà entérinées »[35].
La suite de l’histoire maronite va toujours subir des influences latines, mais rien de nouveau, de radical et de fondamental va désormais s’installer, puisque l’essentiel a été fait durant cette période qui va de la légation d’Eliano jusqu’au synode du Mont Liban. Les latinisations qui vont succéder à ce synode ne seront que des mises à jour, ou des intrusions qui ne touchent pas à l’essentiel de la liturgie maronite, mais qui se résument par l’introduction de coutumes paraliturgiques latines (surtout à la seconde moitié du XIXe siècle), par le calquage de mélodies ou la traduction de chants religieux, etc. Mais grosso modo, l’Église maronite va traverser cette période avec un acquis de latinisation qu’elle hérite de la période qui va de la fin du XVIe siècle jusqu’au synode du Mont Liban. Beaucoup d’historiens et de liturgistes maronites vont être conscient de cette latinisation que subit leur Église. De Dwayhi à Pierre Dib qui écrit un bel article sur l’Église Maronite dans le « Dictionnaire de Théologie Catholique » en 1928, il est question de souligner les influences latines, et d’évoquer d’une manière parfois réservée et assez prudente une volonté de retour aux sources de la tradition maronite. Ceci ne va être possible qu’avec le deuxième Concile du Vatican qui va ouvrir la voie officielle aux réformes liturgiques, et qui va permettre à l’Église Maronite de pouvoir rechercher son identité syriaque antiochienne, à travers une liturgie qui exprime sa personnalité propre. Actuellement, l’Église Maronite est toujours en pleine réforme liturgique qui s’est manifestée par l’impression de nouveaux livres liturgiques réformés (comme le texte de la messe, les lectionnaires, etc.), par un travail ardu de la commission liturgique patriarcale, et par la contribution du travail liturgique de plusieurs institutions religieuses et académiques, tel l’Institut de Liturgie à l’Université Saint Esprit de Kaslik par exemple, qui a tant donné en matière de réforme liturgique.
6. La latinisation, bilan :
Je le répète, cet article a pour but principal de traiter de l’aspect liturgique de la latinisation. C’est pour cette raison que je trouve utile de chercher à savoir d’une manière synthétique, quelle latinisation a été opérée sur la liturgie de l’Église Maronite. La pyramide liturgique maronite comporte trois étages : le plus haut est celui des sacrements et à leur tête la messe, le deuxième est celui de l’Office Divin, alors que l’étage le plus bas est celui des pratiques paraliturgiques.
Le premier texte du Missel maronite imprimé à Rome en 1592-1594 est interdit par le patriarche et ne sera accepté ultérieurement que pour cause de manque d’exemplaires. L’un de ses problèmes réside dans le fait qu’il comporte « la mutilation des formules consécratoires et de l’épiclèse »[36]. Ce sont les élèves du Collège Maronite qui en sont responsables, dont Amira, celui qui deviendra le « patriarche romain ». Davantage, des prières sont insérées à la fin du volume : des bénédictions traduite du latin en syriaque, et surtout, des prières et action de grâce de Thomas d’Aquin que Amira a pris le soin de traduire. Cette première édition de la messe s’éloigne bien de la messe que célébraient alors les maronites, qui ne comportait pas ces prières latines, et dont chaque anaphore avait ses paroles consécratoires propres. Dandini, en 1596, en « reconnaissait les caractéristiques, notamment en ce qui concerne les formules consécratoires : elle différaient d’une anaphore à l’autre ; elles étaient parfois longues, parfois trop courtes, ne retenant que les tout premiers mots de la forme consécratoire de la messe latine »[37].
Pierre Dib résume d’une manière claire les transformations qu’a subi le texte de la messe : « les retouches importantes que le texte liturgique y a subies concernent les paroles de l’institution et l’épiclèse. Le récit de la cène était raconté en d’autres termes que dans la messe latine. Ces termes variaient du reste avec les anaphores. Maintenant, les paroles de l’institution sont une simple traduction du missel romain. Quant à l’épiclèse, elle est mutilée : le célébrant ne demande plus que le Saint Esprit soit envoyé sur le pain et le vin pour les transformer au corps et au sang du Christ, mais pour appliquer aux fidèle les effets du sacrement eucharistique »[38].
La deuxième édition date de 1716. Rien de substantiel ne change par rapport à la latinisation déjà introduite dans le texte durant l’édition précédente, sauf qu’il y eut une suppression de plusieurs anaphores, et un ajout de l’anaphore de l’Église Romaine composée par Scandar d’après le canon de la messe latine, et adaptée selon la forme de l’anaphore maronite des Douze Apôtres. Les éditions ultérieures du texte de la messe, qu’elles soient romaines ou libanaise ne vont plus ajouter quelque chose de substantiel à la latinisation du missel maronite. En 1992, le texte réformé de la messe va se séparer de maintes latinisations et retrouver certaines formes archaïques de la liturgie maronite eucharistique. Toutefois, il reste du travail à faire : l’anaphore maronite dite Charar n’a toujours pas retrouvé sa place dans le missel, les prière eucharistiques consécratoires conservent toujours un même texte uniforme, etc. Cependant, le nouveau missel qui va sortir très prochainement est très prometteur.
En somme, que dire de la latinisation de la messe maronite ? Un préjugé qui commence à faire date veut que la messe maronite a été tellement latinisée, qu’elle a perdu son identité maronite syriaque antiochienne. C’est une exagération d’une influence qui n’est en vérité que très superficielle. La seule lourde influence latinisante de la messe maronite consiste en l’introduction de l’anaphore dite de l’Église Romaine, et encore, sa structure est maronite. Il suffit d’écarter cette anaphore (ce qui a été fait durant la dernière réforme) pour voir que les dégâts ne sont pas si considérables que ça. L’influence latine n’a pas touché à la structure de la messe, ni au dispositions générales de la célébration. Elle n’a fait qu’ajouter parfois certaines prières latines, et les seuls lieux où elle a été vraiment active sont des points relatifs aux formules du Trisagion, des paroles consécratoires et de l’épiclèse. Hayek dit dans ce sens qu’on « peut donc dire que cette influence s’est exercée plus par minimisme et amputation que par une véritable modification à l’ordre liturgique lui-même. Celui-ci reste généralement a l’abri de toute déformation »[39].
Quant aux autres rituels sacramentaires, ce sont eux qui été le plus latinisés dans la liturgie maronite. La latinisation touche son point culminant lorsqu’au XVIIe siècle, certains « traduisirent du latin une partie du rituel et l’imposèrent à l’usage »[40]. Nonobstant, ce n’est pas tout le rituel qui a été affecté, puisque le pontifical était presque indemne de toute influence latinisante, et que c’était le pontifical de Dwayhi qui à partir du mandat de ce patriarche va être utilisé dans l’Église Maronite. Mais malgré cette latinisation du rituel, et toutes les modifications qu’il a pu encourir, « le rite maronite conserve encore dans son ensemble le cadre et les caractères essentiels de la liturgie d’Antioche »[41]. En bref, même le rituel qui est le plus latinisé dans la liturgie maronite, garde les caractéristiques essentielles et principales de l’identité syriaque antiochienne de l’Église de Maroun.
Quant à l’Office Divin, l’Église Maronite a la chance de pouvoir avoir à sa disposition un texte qui n’a pas été modifié par les intrusions latines. L’office n’a pas subi de latinisation de forme ou de texte, ce qui est une grande occasion pour pouvoir rejoindre à travers ses textes, la théologie antique de l’Église Maronite, théologie dont les sources remontent à bien loin dans l’histoire (un exemple d’un tel travail est celui de Jean Tabet qui a essayé de ressortir une théologie maronite à travers son analyse des textes de l’office commun). À cause de la persécution et de la pauvreté qu’on vécues les maronites, le fait de ne pas pouvoir beaucoup développer leur prières des heures les a permis de garder des formes et des structures bien archaïques de l’office, ce qui n’a pas forcément été le cas d’autres Églises orientales.
Concernant les pratiques paraliturgiques, la latinisation a bien œuvré dans ce sens : de l’introduction du Rosaire à partir des légations pontificales de la fin du XVIe siècle, en passant par le « Chemin de la Croix » et les exhortations du patriarche Hoyek qui insistait dans son action pastorale sur « la dévotion au sacré cœur »[42], et en arrivant aux dévotions actuelles qui sont majoritairement à aspect marial comme ceux relatif à certaines apparitions de la Vierge Marie, ou aussi à des attachement à des cultes de saints occidentaux. Dans ce domaine plus populaire, certains aspects de la personnalité maronite orientale sont parfois altérés par des concepts spirituels latin, mais loin de là que ces latinisations altèrent la personnalité maronite. Le seul danger qui puisse exister consiste à vouloir substituer la liturgie officielle de l’Église (messe et offices) par des pratiques paraliturgiques. Mais actuellement, une grande partie du clergé maronite est conscient de cette question, et ne sacrifie pas la grande tradition antiochienne au nom de petites spiritualités qui sont bonnes en soi, et qui devraient plus relever d’une dévotion personnelle que d’une prière liturgique officielle de l’Église. Davantage, il y a beaucoup de bémols à mettre à ces affirmations, puisque certaines dévotions ont tellement été assumées par les fils de Maroun qu’il est difficile de les écarter, sous danger d’amputer les nouveautés de la personnalité maronite, qui n’est pas une personnalité stagnée, mais toujours nouvelle à travers les siècles et les changements culturels et théologiques. D’une manière plus concrète je veux dire que le Rosaire par exemple, fait désormais partie intégrante de la spiritualité d’une majeure partie des maronites, ainsi que d’autres dévotions comme celle du sacré cœur. Nos plus grands saints les ont priés, et pour n’en citer que un, je mentionne Charbel Makhlouf. Comme il est impossible de nous imaginer le saint de Aannaya sans Rosaire, il est aussi difficile de dire que le Rosaire ne fait pas partie de la spiritualité maronite, en tant que phénomène désormais personnel, et non étranger. Mais cela ne veut pas dire aussi que les maronites ne pourront pas rejoindre des formes de prières individuelles orientales qui sont louables, comme le chapelet de la « prière de Jésus ».
7. Conclusion
Ce survol historique et les petites analyses qui ont été faites sur l’état de la latinisation de la liturgie de l’Église Maronite me permettent de répondre à la question que j’ai posée dans mon introduction, et qui consiste à savoir si la latinisation de l’Église Maronite a altéré sa personnalité orientale et syriaque. L’histoire nous permet de voir que l’Église Maronite a subi maintes latinisations, qui ne touchent pas seulement à sa liturgie, mais aussi, à d’autres aspects de sa vie en tant qu’église. Mais malgré cette latinisation qui touche à sa liturgie à différents niveaux et selon des degrés de force très variables, l’Église Maronite a préservé sa personnalité syriaque, et les insertions latinisantes dans ses textes liturgiques n’ont en rien altéré son statut antiochien. La réforme liturgique n’est pas une tâche facile puisqu’elle n’a pas seulement comme mission de rejoindre les origines et d’épurer les textes des intrusions étrangères, mais aussi d’actualiser la liturgie qui doit parler à l’homme actuel. Étant une action vivante, l’action liturgique doit s’éloigner de tout aspect muséologique. De plus, quand les latins ont donné aux maronites leurs usages, ils leur ont donné le meilleur de ce qu’ils avaient. À part quelques comportements condamnables comme par exemple ceux d’Eliano en train de brûler nos manuscrits, l’Église Latine est à remercier puisqu’à travers son action globale, elle a aidé les maronites à dépasser les difficiles conditions historiques dans lesquelles elle vivait, et aussi, elle leur a donné une grande richesse à travers l’échange culturel qu’elle a eu avec elle. La latinisation liturgique de l’Église Maronite ne lui a en général pas causé de grands dégâts, et le retour aux sources n’est pas seulement un tâche très possible et en cours de réalisation, mais elle est aussi une tâche passionnante qui est une occasion à l’Église Maronite pour repenser ce qu’elle est, et pour redéfinir son identité à partir de son histoire, et à la lumière des situations nouvelle qu’elle est en train de vivre.
Cependant, après une prise de conscience de la problématique de la latinisation de l’Église Maronite, il n’est plus permis de sacrifier l’héritage même de cette Église au nom d’un euphémisme spirituel ou d’un syncrétisme liturgique. Sans être fanatiques et sans vouloir absolutiser leur liturgie et la rendre stagnante, les maronites doivent bien veiller à la garder intacte dans son héritage, c’est-à-dire reflétant la personnalité maronite syro antiochienne. Une liturgie qui véhicule une théologie sémitique aurait beaucoup de choses à dire à son entourage musulman qui lui aussi pense d’une manière sémitique, et peut être beaucoup plus qu’une théologie occidentale et orientale qui ont des langages parfois incompréhensibles pour un moyen oriental. La pureté liturgique maronite est ainsi intimement liée à sa vocation de dialogue : qu’il soit un dialogue œcuménique qui fasse profiter les autre Églises de la richesse théologico-liturgique de l’Église Maronite, ou qu’il soit un dialogue inter religieux qui puisse faire parvenir aux autres sémites un message compréhensible de salut. Michel Hayek, l’un de ceux qui m’ont fortement influencé durant ma formation théologique, philosophique et liturgique, me disait toujours et il l’a écrit : « les Syriens [il s’agit des Église Syriaques] ont la responsabilité devant Dieu et devant l’histoire du salut du monde islamique. Seuls ils peuvent lui parler un langage compréhensible, à partir de ces mêmes consonnes sémitiques que l’islam croit éternelles et incréées ; pourvu toutefois qu’ils sachent, à la faveur du Concile, se constituer une expression théologique toute centrée sur la Bible, ni grecque, ni latine, à l’abri de toute option philosophique aristotélicienne, mais sémitique, marquée de ce cachet de primitivité au niveau duquel le monde ambiant situe sa foi et son culte »[43]. Que la mémoire de ce saint érudit maronite nous accompagne toujours et nous guide dans nos recherches. Décidemment, la liturgie n’est pas une question d’un dimanche matin, mais c’est tout un programme de vie.
Antoine Fleyfel
Paris, 17.10.2005
Bibliographie
Orientalium Ecclesiarum, Décret du Concile Vatican II sur les Églises Orientales Catholiques, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_orientalium-ecclesiarum_fr.html
G. De Clercq, Maronite, in. Dictionnaire de droit canonique, T. VI, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1957, p. 811-829.
Pierre Dib, Église Maronite, in. Dictionnaire de Théologie Catholique, T. X, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1928, p. 2-142.
Etienne Douayhi, Candélabre des Saints Mystères, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1895, t. I, 564 p. et 1896, t. II, 694 p.
Joseph Féghali, Histoire du droit de l’Église Maronite, T. I, Letouzey et Ané, Paris, 1962, 377 p.
Michel Hayek, Liturgie Maronite, Histoire et textes eucharistiques, Mame, Paris, 1964, 436 p.
G. Khouri-Sarkis, La réforme liturgique dans les Églises de langue syriaque, in. L’Orient Syrien Vol IX, n. 2-3, 1964 Vernon, France, p. 323-382.
G. Khouri-Sarkis, Projet de Restauration de la Liturgie syrienne d’Antioche, in. L’Orient Syrien, Vol. IX, n. 4, 1964, Vernon, France, p. 409-442.
Jean Madey, À propos de la réforme liturgique de l’Église Chaldéo-Malabare, in. Parole de l’Orient, Vol. XI, 1983, Kaslik, Liban, p. 257-280.
Youwakim Moubarac, Pentalogie antiochienne / domaine Maronite, Tome I/1, Cénacle Libanais, Beyrouth, Liban, 1984, 744 p.
Paul Naaman, La société maronite à la fin du XVIe siècle, in. Parole de l’Orient, n. XVII, Kaslik, 1992, p. 93-111.
Paul Rouhana, Histoire du Synode Libanais de 1736, in. Parole de l’Orient XIII, Kaslik, 1986, 111-164.
Paul Rouhana, Identité ecclésiale maronite, Des origines à la veille du Synode Libanais, Parole de l’Orient, XV, Kaslik, 1988-1989, p. 215-259.
————————————————-
[1] Cf. G. Khouri-Sarkis, La réforme liturgique dans les Églises de langue syriaque, in. L’Orient Syrien Vol IX, n. 2-3, 1964 Vernon, France, p. 336.
[2] Jean Madey, À propos de la réforme liturgique de l’Église Chaldéo-Malabare, in. Parole de l’Orient, Vol. XI, 1983, Kaslik, Liban, p. 60.
[3] Ibid., p. 261.
[4] Ibid., p. 264.
[5] G. Khouri-Sarkis, La réforme liturgique dans les Églises de langue syriaque, op. cit., p. 336.
[6] G. Khouri-Sarkis, Projet de Restauration de la Liturgie syrienne d’Antioche, in. L’Orient Syrien, Vol. IX, n. 4, 1964, Vernon, France, p. 416.
[7] G. Khouri-Sarkis, La réforme liturgique dans les Églises de langue syriaque, op. cit., p. 337.
[8] Michel Hayek, Liturgie Maronite, Histoire et textes eucharistiques, Mame, Paris, 1964, p. xiv.
[9] Ibid., p. 33.
[10] Pierre Dib, Église Maronite, in. Dictionnaire de Théologie Catholique, T. X, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1928, p. 34.
[11] Joseph Féghali, Histoire du droit de l’Église Maronite, T. I, Letouzey et Ané, Paris, 1962, p. 25.
[12] Ibid., p. 26.
[13] Ibid., p. 28.
[14] Michel Hayek, op. cit., p. 38.
[15] Pierre Dib, op. cit., p. 31.
[16] Ibid., p. 63.
[17] Paul Naaman, La société maronite à la fin du XVIe siècle, in. Parole de l’Orient, n. XVII, Kaslik, 1992, p. 106.
[18] Jospeh Féghali, op. cit., p. 46.
[19] Ibid., p. 52.
[20] Ibid., p. 53.
[21] Youwakim Moubarac, Pentalogie antiochienne / domaine Maronite, Tome I/1, Cénacle Libanais, Beyrouth, Liban, 1984, p. 286.
[22] Joseph Féghali, op. cit., p. 72.
[23] Paul Rouhana, Identité ecclésiale maronite, Des origines à la veille du Synode Libanais, Parole de l’Orient, XV, 1988-1989, p 241.
[24] Michel Hayek, op. cit., p. 44.
[25] Ibid., p. 45.
[26] Ibid., p. 48.
[27] Youwakim Moubarac, op. cit., p. 527.
[28] Ibid., p. 516.
[29] Michel Hayek, op. cit., p. 50.
[30] Ibid., p. 51.
[31] Youwakim Moubarak, op. cit., p. 523.
[32] Paul Rouhana, op. cit., p. 231.
[33] G. De Clercq, Maronite, Dictionnaire de droit canonique, T. VI, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1957, p. 824.
[34] Michel Hayek, op. cit., p. 53.
[35] Ibid., p. 54.
[36] Ibid., p. 63.
[37] Ibid., p. 65.
[38] Pierre Dib, op. cit., p. 129.
[39] Michel Hayek, op. cit., p. 75.
[40] Pierre Dib, op. cit., p. 130.
[41] Ibid., p. 132.
[42] Ibid., p. 111.
[43] Michel Hayek, op. cit., p. XV-XVI.
|
|