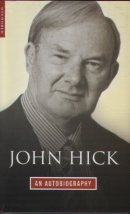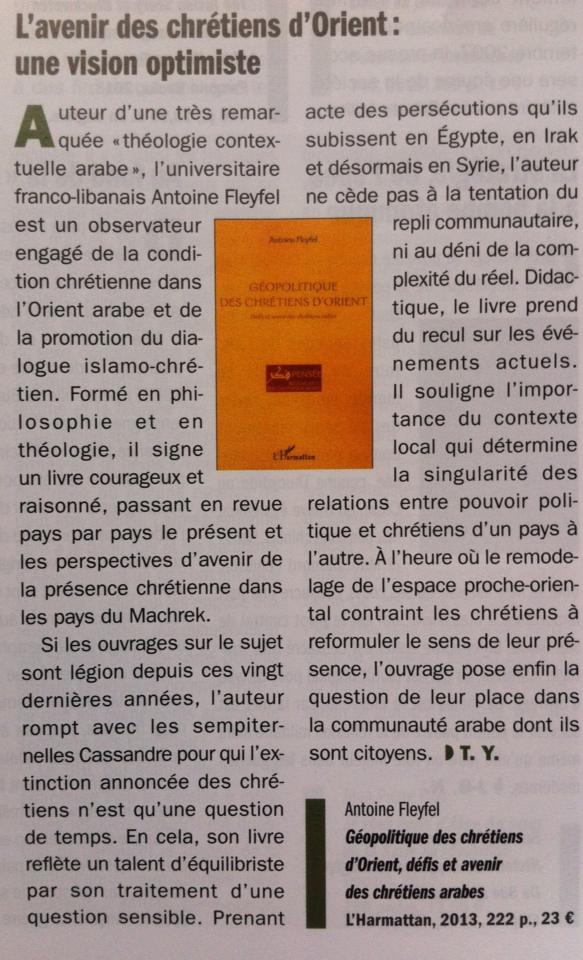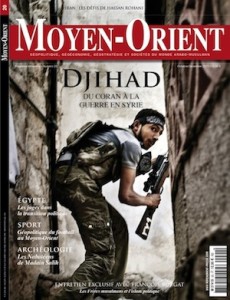|
|
Recension du livre de Michel YOUNÈS, Pour une théologie des religions, DDB, Paris, 2012, 256 p., in MSR, janvier-mars 2014, p. 68-70.

Le nouvel ouvrage de Michel Younès, maître de conférences à la faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon arrive à point. Ce dernier avance une réflexion théologique sur la question de la diversité des religions, vieille de plus d’un demi-siècle, et constate qu’elle « stagne ». À l’heure de la mondialisation, des nouvelles technologies et de la rencontre jamais aussi urgente et étendue entre les cultures et les religions, cet état des choses a des répercussions fort peu édifiantes sur le dialogue interreligieux. Ainsi, l’auteur entend rappeler les fondamentaux de la réflexion en la matière, et met à la disposition de son lecteur une vision globale de la problématique, de ses visées, de ses acquis et de ses impasses. Quant à l’angle à partir duquel il entend aborder la question, il n’est autre que celui de la « théologie chrétienne des religions » qui s’avérera catholique au fil des pages de l’ouvrage, et fidèle aux requêtes du Magistère actuel de l’Église et de son enseignement.
Younès dont le travail se déroule sous les hospices d’une « théologie réflexive de type fondamental » rappelle dans la première partie de son travail trois notions clefs de la théologie des religions, à savoir le salut, l’alliance et la révélation. Celles-ci peuvent être appréciées selon trois genres de théologies désormais classiques en la matière : la théologie exclusive, la théologie inclusive et le pluralisme théologique. Face à son constat d’un certain épuisement de ces lieux théologiques, l’auteur propose une voie nouvelle dans la deuxième partie de son travail, une « proposition méthodologique pour aborder les religions d’un point de vue chrétien » intitulée « proportionnalité ». La troisième partie de cet essai montre dans quel sens la notion de proportionnalité jette un regard nouveau sur la problématique de la théologie des religions et permet « une meilleure articulation des trois notions clefs abordées dans la première partie », tout en montrant les bénéfices afférents.
La première partie de l’ouvrage, intitulée « Portes d’entrée en théologie des religions » constitue une réelle introduction de la question, et pourrait permettre à un profane en la matière d’en comprendre l’essentiel. À travers ses analyses des théologies du salut, de l’alliance et de la révélation, l’auteur passe en revue une considérable littérature théologique, sans pour autant étouffer le lecteur par de longues analyses de pensées théologiques de premier rang, nombreuses à occuper les pages de cette partie. Au centre de celle-ci, toute une panoplie de réponses tentant de concilier ou pas, la centralité du Christ pour la foi et son statut irremplaçable, avec la diversité des religions. Younès analyse avec adresse les différentes théologies, mettant en valeur leurs vertus et critiquant leurs impasses. Cependant, force est de constater que les distances qu’il prend avec l’exclusivisme et le pluralisme théologiques sont largement plus grandes que celle prises avec l’inclusivisme théologique.
La proportionnalité comme méthode occupe la deuxième partie de l’ouvrage. L’auteur la fonde à partir d’une démarche pluridisciplinaire qui fait appel aux mathématiques, à la philosophie, aux Pères de l’Église et surtout à l’Écriture. Au fil des pages, la proportionnalité se révèle de plus en plus comme une clef herméneutique, et les passages évangéliques deviennent désormais l’occasion d’une compréhension connexe à cette méthode. Ainsi, le mystère du Christ selon l’évangile de Marc est-il par exemple compris comme « un dévoilement proportionné » ; ou aussi, il est question en parlant des Actes des Apôtres de la proportionnalité comme « une œuvre pneumatologique ». La proportionnalité paraît comme une notion riche pouvant supporter diverses appréciations. Retenons que celle-ci considère la révélation de Dieu comme proportionnée aux capacités de ceux qui la reçoivent, « permet à la vérité une expression différenciée, et rend possible par le fait même un regard différencié sur la réalité ». Cependant, l’auteur écarte tout soupçon de pluralisme théologique de sa réflexion en rappelant que « pour la foi chrétienne, l’histoire du salut comme une régénération de la création s’accomplit définitivement dans le mystère du Christ Jésus » et que « la relation entre le Père et le Fils dans la force de l’Esprit émerge comme la norme absolue… ».
La dernière partie du livre examine en un premier temps la possibilité pour la logique de proportionnalité « de ressaisir, à la lumière de la foi en Christ, la question du salut, de l’alliance et de la révélation », et en un second temps, les horizons des relations entre l’Église et les religions à partir de la méthodologie proposée. La diversité des religions paraît légitime, et la proportionnalité « fait apparaître leur différence en fonction de leur capacité à s’approprier la vérité » qui reste une et unique, mais approché selon des « degrés relatifs aux capacités de se l’approprier ». Ainsi, la diversité paraît se former à partir des capacités d’accueil de la vérité. Cependant, l’appropriation par Christ demeure pour la théologie chrétienne, le plus haut degré de la proportionnalité, logique s’appliquant aussi l’interreligieux qu’à l’œcuménique et l’ecclésiologie. Effectivement, aux « yeux de l’Église catholique, la plénitude de l’Église du Christ se trouve en elle, sans pour autant qu’elle soit complètement absente des autres Églises et communautés ». Enfin, la proportionnalité s’approprie la missiologie, perçue en tant que dialogue et annonce. Ces deux attitudes sont « à effectuer proportionnellement à l’appropriation de celui à qui elles s’adressent ».
La théologie des religions ainsi que les dialogues interreligieux, œcuméniques et culturels constituent certainement les plus grands défis de la théologie d’aujourd’hui et de demain. Quel espace pourrait y occuper la nouvelle méthodologie ? Daignent les acteurs des dialogues répondre à ce questionnement fondamental.
Antoine Fleyfel
Université catholique de Lille
Paru dans Actes du colloque international organisé par le Centre d’études et d’interprétation du fait erligieux de la faculté des sciences religieuses à l’université Saint Joseph, Beyrouth, février 2014, p. 11-21.
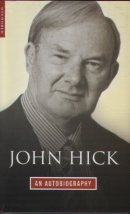
Comment articuler l’universalité et la particularité des religions ? D’autant que cette question se heurte presque toujours à des prétentions absolutistes, à des théologies exclusives ou inclusives. Dans tous ces cas de figure, le rapport entre le particulier et l’universel reste très problématique, puisque captif de lectures qui se saisissent d’une compréhension de la vérité divine, considérée comme la meilleure, voire la seule adéquate, et excluent ou tolèrent d’autres versions qui ne s’inscriraient que dans l’erreur ou dans l’incomplétude.
Dût cette investigation s’appuyer sur des éléments théologiques, elle est de nature philosophique. Il est effectivement question d’investir ce sujet à partir des pistes philosophiques proposées par John Hick qui, à partir de ses réflexions sur le pluralisme théologique, donne une réponse sérieuse à notre problématique. Mais avant de se verser sur sa réponse, il est de bon ton d’aborder brièvement sa biographie, pour ce qu’elle apporte d’éclairage à notre examen de sa réflexion.
Éléments biographiques[1]
John Hick (1922-2012) est un philosophe et théologien anglais qui enseigna longtemps aux États-Unis dans les domaines de la philosophie de la religion et de la théologie. Sa contribution au sujet du pluralisme théologique est majeure.
Sa pensée s’ancre indubitablement dans un cheminement personnel. Avant d’avoir 20 ans, il se convertit à l’évangélisme dans sa version stricte, et s’inscrivit à l’Université d’Edinburgh pour étudier la philosophie. À cette époque, la philosophie de Kant lui fut d’un attrait qui commença à mettre en question son fondamentalisme religieux. Longtemps membre de l’Église réformée unie en Grande-Bretagne (United Reformed Church), il dut faire face à un procès l’accusant d’hérésie entre 1961 et 1962. Cela concernait la confession de Westminster[2] ; Refusant d’admettre la naissance virginale de Jésus, Hick considérait que la question était ouverte à toute interprétation, et qu’il était agnostique à cet égard.
Le philosophe racontait son expérience de l’immigration en Grande-Bretagne dans les années 1950-1960. Elle le poussa à se poser la question du pluralisme théologique, puisque la grande diversité religieuse qui en découlait ne pouvait pas le laisser indifférent. Sa rencontre avec des réalités nouvelles représentées par des musulmans, des sikhs, des Hindous ou des pentecôtistes le poussait à réévaluer son positionnement théologique et spirituel. En fréquentant des mosquées, des synagogues, des temples et des pagodes, Hick constatait qu’il s’y passait la même chose que dans une église, c’est-à-dire qu’il s’y trouvait « des êtres humains ouvrant leurs esprits à une réalité divine qui les dépasse, reconnue comme personnelle et bonne, et exigeant une droiture et un amour entre les hommes. J’ai pu constater, [dit-il], que la foi sikh, par exemple, est pour le sikh dévoué, ce que la foi chrétienne est pour le chrétien sincère ; mais aussi que chaque foi est, très naturellement, perçue par ceux qui y adhèrent, comme unique et absolue »[3]. C’est ainsi qu’il considéra que l’une de ses vocations consistait à « œuvrer pour la nouvelle pratique de la théologie des religions […]. Il me semblait, [dit-il], que cela engageait une franche reconnaissance qu’il existait une pluralité de révélations divines et de contextes de salut »[4].
Cette pensée reçut maintes critiques, dont celle Joseph Ratzinger, alors préfet de la congrégation pour la Doctrine de la foi. Celui-ci considérait que des théologiens catholiques accusés de relativisme comme Jacques Dupuis, Peter Phan ou Roger Haight, étaient philosophiquement inspirés par lui. Dominus Iesus fut par ailleurs considérée comme une condamnation de la pensée de Hick. Trois ans avant sa mort, en 2009, Hick rejoignit la Société religieuse des Amis (Quakers), ce qui était en adéquation avec sa réflexion et qui révélait les grandes tensions qu’il vécut au sein de son Église.
Pratiques théologiques
Hick considère qu’il existe deux pratiques majeures de la théologie : il dénomme la première « théologie dogmatique » (dogmatic theology) et la seconde « théologie critique » (problematic theology). C’est ainsi qu’il les définit : « Alors que la pratique dogmatique de la théologie assume que ses positionnements de base représentent la vérité finale, la pratique critique de la théologie considère ses conclusions comme des hypothèses, sujettes à révision et toujours en quête d’un discours plus adéquat[5]. » Les deux restent nécessaires à son sens, mais lui s’inscrit franchement dans le sillage de la seconde, tout en reconnaissant adhérer jadis pleinement à la première qu’il disait toujours respecter. Ce sont les a priori de la théologie critique qui servent de fondement à son questionnement philosophique autour de la diversité religieuse, fondés sur une lecture pluridisciplinaire s’appuyant essentiellement sur l’histoire, l’exégèse, l’anthropologie ou la sociologie.
Cela étant, le philosophe considère que la vision traditionnelle qu’a le christianisme des autres religions fut forgée à une période d’ignorance de l’autre et de la vie religieuse de l’humanité. À cet égard, le christianisme n’a rien d’exclusif puisque cette pratique est partagée par toutes les religions. Et Hick de poursuivre sa réflexion en pensant qu’il est évident que sa religion soit une parmi plusieurs : « Nous étions comme un groupe de personnes qui descendait une longue vallée, chantant nos propres chants, développant au cours des siècles nos propres histoires et slogans, sans être conscients que derrière la colline, il y a une autre vallée, avec un autre excellent groupe de gens avançant dans la même direction, mais avec leurs propres langages et chants et histoires et idées[6]. »
Cependant, il constate que la religion chrétienne traverse, à ce sujet, trois phases de développement : commençant par un rejet total, traversant une sotériologie inclusive et finissant par une reconnaissance de la valeur intrinsèque des religions.
Pour illustrer la première phase, Hick cite deux extraits historiques. Le premier du concile de Florence (1439-1441) : « Toute personne restant en dehors de l’Église catholique, non seulement les païens, mais aussi les juifs, les hérétiques ou les schismatiques, ne peut prendre part à la vie éternelle ; Mais ils iront au feu éternel qui a été préparé au diable et à ses anges, sauf s’ils rejoignent l’Église à la fin de leur vie ». Et le second du message du « Congress on World Mission at Chicago » (1960) : « Depuis la guerre, plus d’un milliard d’esprit sont passés dans l’éternité, et plus de la moitié de ceux-là est allée au tourment du feu de l’enfer, sans entendre parler de Jésus Christ, de qui il était, ou de pourquoi il est mort sur la Croix du calvaire[7]. » Enfin, il considère la doctrine excluant le salut en dehors de l’Église ou du christianisme n’est plus acceptée à la lumière de connaissance actuelle de l’autre.
Pour illustrer la deuxième phase, Hick parle d’une acceptation d’un salut des autres mais seulement à travers la religion chrétienne. À ce sujet, il cite la théorie du chrétien anonyme de Rahner qu’il rejette. Considérer que la grâce divine touche les autres mondes de foi à travers le christianisme, c’est-à-dire à travers la personne et la croix du Christ, correspond pour Hick à dire que la lumière du soleil ne peut atteindre les autres planètes que si elle est reflétée en premier lieu par la terre[8].
Pour illustrer la troisième phase, le philosophe évoque la reconnaissance de la valeur salvifique contenue chez les autres. La suite de ce travail s’étendra sur la réflexion de Hick à ce sujet.
Notons que ces trois phases évoquées correspondent aux trois manières de concevoir la théologie du dialogue, c’est-à-dire à partir de l’exclusive, l’inclusivisme et le pluralisme.
La révolution copernicienne de Hick
Hick parle de sa proposition comme d’une révolution copernicienne qui consiste en un passage paradigmatique d’un christianisme centré autour de Jésus (Jesus centered), à une vision qui centrée sur Dieu, fondement de toute sorte de foi religieuse[9]. Cette révolution est supposée avoir des conséquences de taille sur le dogme chrétien au sein duquel il faudra passer d’un christocentrisme à un théocentrisme. Ainsi c’est Dieu qui sera le centre et l’objet de l’adoration de toutes les religions, y compris le christianisme : « Nous devons réaliser que l’univers de la foi est centré autour de Dieu, et non autour du christianisme ou autour d’une autre religion. Il est le soleil, la source originaire de la lumière et de la vie, celui que toutes les religions reflètent à partir de leurs propres manières[10]. »
Ce nouveau paradigme a des implications considérables en christologie. En considérant Jésus comme littéralement le Dieu incarné, la deuxième hypostase de la Trinité, il est impossible de dépasser une vision traditionnelle invitant toute l’humanité à la foi chrétienne. La solution à ce problème consiste ainsi à considérer les notions de l’incarnation et de la divinité du Christ comme métaphoriques, mythiques, comme des expressions poétiques de la dévotion chrétienne au Seigneur, expressions appartenant au langage imaginaire des anciennes cultures[11]. La tradition chrétienne a transformé cette poésie en prose, et par conséquent, le métaphorique Fils de Dieu devint un Fils de Dieu métaphysique, la deuxième hypostase de la Trinité. Néanmoins, en tant que métaphore, le discours sur l’incarnation fournit une manière familière pour exprimer le fait d’être disciple de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Cela permet aussi de dire que « Jésus est notre contact vivant avec le Dieu transcendant »[12].
Concernant la personne du Christ, Hick adopte des résultats exégétiques faisant une distinction, voire une séparation entre le Jésus de l’histoire et celui du dogme. Ainsi il considère que le Jésus pré-pascal ne s’est pas proclamé comme Messie ou Fils de Dieu, ni n’a accepté qu’on le désignât comme tel. Le Jésus historique n’a jamais enseigné qu’il est Dieu. L’idée de l’incarnation n’est que métaphorique et mythique.
En comprenant l’incarnation sous cet angle, Jésus ne sera plus considéré comme le seul moyen d’accès à Dieu. Il pourra être révéré comme celui à travers qui le salut est communiqué, sans devoir nier les autres chemins se déclarant comme une voie de salut. Cela permet de préserver la foi chrétienne sans dévaloriser les autres formes de foi ou les reléguer à un rang inférieur : « Nous pouvons dire qu’il y a salut en Christ sans dire qu’il n’y a pas de salut en dehors du Christ. »
Quelles assises philosophiques à ce pluralisme ?
De prime abord, Hick constate que quelle que soit notre appartenance religieuse, chrétienne, musulmane ou autre, elle dépend presque toujours du monde dans lequel nous sommes nés : « D’un point de vue réaliste, l’engagement religieux de chacun est normalement une question de ‘‘religiosité ethnique’’ plutôt que d’un jugement comparatif délibéré et d’un choix[13]. » Effectivement, « nous avons été formé depuis notre enfance dans notre tradition, absorbant ses valeurs et ses présupposés. Cela est devenu une partie de nous comme notre nationalité, notre langage et notre culture ; les traditions religieuses étrangères peuvent paraître comme étranges, comiques ou bizarres comme un nom étranger, des coutumes ou une nourriture peuvent l’être »[14]. Ainsi, il existe un conditionnement historique des religions : « Dans chaque cas, les expériences de révélation et les traditions religieuses qu’elles ont crées furent conditionnées par l’histoire, la culture, le langage, le climat, et certainement toutes les circonstances concrètes de la vie humaine, dans un espace-temps particulier. Et même si la forme culturelle et philosophique de la révélation du divin était caractéristiquement différente dans chaque cas, nous pouvons croire que le Seul Esprit œuvrait partout, agissant dans l’esprit humain[15]. »
Mais pourquoi cette différence de la perception du divin existe-t-elle ? Pourquoi celui-ci ne se révèle-t-il pas d’une manière similaire partout ? Pour répondre à cette question, Hick s’appuie, entre autres, sur l’adage de Thomas d’Aquin : « Tout ce qui est perçu est perçu selon le mode de celui qui perçoit[16]. » Ainsi, « l’idée générale de la divinité a été concrétisée dans l’expérience juive par l’image de Yahvé comme un être personnel qui existe en interaction avec le peuple juif. Il est une partie de leur histoire et ils sont une partie de la sienne. Mais Yahvé est différent, par exemple, de Krishna, qui est une personnification hindou particulière de l’Éternel, en relation à la communauté Vaishnavite de l’Inde »[17].
Pour inclure toute les religions dans sa réflexion, Hick a recours à des concepts où les différentes expériences du divin peuvent être contenues. Ainsi utilise-t-il, selon ses articles, différents termes pour décrire l’objet des religions : « l’Un Éternel » (Eternal One), ou « Réalité ultime » (Ultimate Reality), voire le « Vrai » (the Real).
L’Un Éternel a toujours cherché à communiquer avec l’esprit humain, cherchant à se faire connaître. Par conséquent, la révélation est forcément plurielle puisqu’elle a lieu dans différents endroits de la culture humaine. Dans le monde sémitique et patriarcal, on pensa Dieu en terme masculin en tant que Dieu le Père. Dans le monde indien, pour des raisons culturelles, Dieu fut pensé comme Mère. Dans tous les cas qu’il cite, il considère qu’il y a une perception authentique du divin, « mais la forme concrète qu’il prend dépend des facteurs culturels »[18]. Ceux-ci peuvent être catégorisés dans deux manières de concevoir l’Un Éternel : la première à partir du concept de la déité, c’est-à-dire l’Un Éternel en tant que personnel (modèle théiste), et la seconde à partir du concept de l’absolu, ou l’Un Éternel comme non personnel (religions non théistes). C’est à ce moment de sa réflexion qu’intervient Kant.
Hick veut faire la différente entre l’Un Éternel en soi, en tant qu’existant en soi, au-delà de toute relation à la création, et l’Un Éternel en relation à l’humanité et tel qu’il a été perçu et connu à partir des différentes cultures et situations humaines. Ainsi, il considère l’Un Éternel comme un noumène ou le Dieu nouménal : celui-ci ne peut pas être connu. Hick trouve dans les religions des enseignements allant dans ce sens. Dans le christianisme, Maître Eckhart distingue entre la déité et Dieu. Dans le taoïsme, le Tao qui peut être exprimé n’est pas le Tao éternel. Dans la cabale juive, il existe une distinction entre En Soph, la réalité divine absolue qui est au-delà de toute description humaine et le Dieu de la Bible. Chez les Soufis, il existe une distinction entre Al Haqq et Allah. Dans l’hindouisme, il s’agit de la distinction entre nirguna Brahman, l’ultime en soi, au-delà de toutes catégorie, et suguna Brahman, l’Ultime en tant que connu comme divinité personnelle, Isvara. Dans le bouddhisme Mahayana, c’est la distinction entre le dharmakaya, l’éternel cosmique Bouddha-nature, qui est aussi le vide infini (sunyata), et la réalité des figures divines du Bouddha (sambhogakaya) et leurs incarnations dans les Bouddha terrestres, (nirmanakaya)[19]. In fine, le Dieu connu par les humains n’est pas Dieu en soi, an sich, mais le Dieu en relation.
Quant au Dieu phénoménal, il est la perception qu’on a du Dieu nouménale à partir d’une culture et d’une histoire. Ainsi, Dieu peut être nommé Yahvé, Adonaï, Allah, le Père de Jésus, Krishna, Shiva, et bien d’autres noms. Cette perception particulière de l’Un Éternel s’inscrit dans un système religieux qui a ses dogmes, ses rites, sa liturgie, son éthique, etc. Mais cela reste phénoménal, puisque « nous n’avons pas conscience de la réalité divine telle qu’elle est en soi, mais seulement comme expérimentée de nos différents points de vue humains »[20]. « Nous sommes tous des peuples élus, mais choisis de différentes manières et pour des vocations différentes[21]. » Shiva et Yahvé ne sont pas des Dieux rivaux, mais des expressions différentes du divin. Donc toutes les religions adorent la même réalité divine, mais chacune à sa manière.
Hick admet que Kant n’aurait pas été d’accord avec cette manière d’utiliser sa théorie, d’autant plus qu’il traite la question de la religion d’une manière différente, à partir de la raison pratique. Il reconnaît que « Kant lui-même n’aurait pas accepté l’idée que nous pouvons, d’une quelconque manière, faire l’expérience de Dieu, même en tant que phénomène divin en distinction d’un noumène divin »[22]. Dieu est dans la morale pour Kant. Néanmoins Hick s’aventure dans cette interprétation de la philosophie de Kant, interprétation qu’il considère utile pour le pluralisme théologique.
Y a-t-il une meilleure religion ?
Considérer que chaque religion a son expérience propre de Dieu, et qu’elles participent toutes à la vérité pousse à la question qui consiste à savoir s’il en existe une qui est meilleure que l’autre. John Hick répond à cette question à partir de plusieurs propositions :
1- Dans l’histoire de toutes les religions, il y a du bon et du mauvais. Dans le christianisme par exemple, il y a François d’Assise et mère Teresa mais la haine exprimée à l’endroit des juifs pendant de longs siècles. Chaque tradition doit distinguer entre ce qui est bien ou moins bien dans son histoire.
2- C’est à partir de quatre grandes traditions religieuses que Hick poursuit sa réflexion autour de cette question : le christianisme, l’islam, l’hindouisme et le bouddhisme. Chacune de ces religions parle à sa manière du caractère mauvais de l’existence humaine présente. Il s’agit d’une vie de déchéance, vécue en aliénation vis-à-vis de Dieu, ou prisonnière de l’illusion du Maya, ou envahie par le dukkha. Mais ces religions proclament aussi, s’appuyant sur leurs bonnes nouvelles, que l’Ultime, le Vrai, le Véritable, sans lequel notre vie est hors de ses gonds, est la réponse à l’homme.
3- Si chaque chrétien et musulman, chaque hindou et bouddhiste, incarnent pleinement leurs idéaux respectifs, ils vivront dans l’acceptation et l’amour des autres humains : « Un monde qui pratique les idéaux éthiques communs de ces traditions réalisera la fraternité humaine sur terre[23]. » Seulement, cela fut accompli par si peu de gens. L’histoire des sociétés dérivées de ces traditions religieuse regorge de violence, de guerre, d’oppression, d’exploitation, d’esclavage, de malhonnêteté, de cruauté, d’une recherche de pouvoir…
4- Chaque religion a ses vices et ses vertus. Il est possible de considérer qu’un phénomène religieux est meilleur en l’inscrivant dans un espace-temps bien précis, mais il est impossible de dire quelle religion, dans sa totalité est meilleure. « Une grande tradition peut constituer dans certaines périodes de son histoire, et dans certaines régions du monde, et dans certaines de ses branches ou sectes, un meilleur contexte de salut/libération que les autres. Ainsi, il serait de meilleur augure de naître dans une religion bien déterminée durant une période bien précise de l’histoire que dans une autre[24]… »
Conclusion
La réflexion de Hick propose une lecture philosophico-théologique qui considère que la relativité de toute religion qui dépend de sa manière de percevoir Dieu, ne constitue guère une enfreinte à son authenticité. Car chacune a de Dieu une expérience authentique qu’elle effectue à sa manière. La diversité des religions n’est guère un problème dans la logique de Hick, au contraire, elle est nécessaire et ancrée dans la diversité humaine et culturelle. Mis à part l’exclusion de toute théologie prétendant à l’absoluité d’une religion, à quoi mènerait une telle réflexion ?
De prime abord, à la reconnaissance de l’autre dans sa différence religieuse. Il est possible d’appartenir à une autre religion et d’être complètement authentique dans sa foi. La particularité ne déforme pas l’universel, au contraire, elle révèle sa richesse.
Mais aussi, à un œcuménisme mondial, croit Hick, où l’engagement spirituel et la fraternité seraient primordiaux, et les différences des traditions religieuses moins significatives. La relation entre elles pourraient se constituer à l’image des relations tissées entre les différentes dénominations chrétiennes, c’est à dire de plus en plus amicales. Celles-ci se rendent visite librement durant leur culte et commencent même à se partager les mêmes édifices. Pour certaines, il existe même des échanges de ministres[25].
Hick considère que le christianisme a subi durant son histoire d’énormes changements, et que son avenir réside dans ce qu’il deviendra grâce aux interactions et influences mutuelles qu’il aura avec le bouddhisme, l’hindouisme et l’islam. Car si chaque religion reste attachée à sa vision comme étant la seule véritable, aucun dialogue en profondeur ne sera possible, mais uniquement des exposés et des comparaisons de systèmes incompatibles.
Enfin, Hick inscrit son système dans une vision qui englobe toute l’humanité, puisqu’il incite au partage des expériences différentes du divin à travers le dialogue interreligieux et les interactions entre les communautés religieuses. Cela ne se fonde pas sur les conversions (même si elles ne seraient jamais exclues), mais sur l’enrichissement mutuel et la coopération pour faire face au problème urgent de la survie humaine dans un monde et une société justes.
Il n’y a pas de doute que la réflexion de Hick peut être critiqué à plus d’un égard, notamment dans son utilisation de la philosophie de Kant (ce qu’il admit) et dans sa relativisation des religion, bien provocante pour bien des sensibilités. Mais il n’y a pas de doute qu’il pose l’une des questions les plus fondamentales en théologie et en philosophie, celle de l’autre, de son authenticité et de la légitimité naturelle de sa différence.
Antoine Fleyfel
Université catholique de Lille
II = John Hick, Problems of religious pluralism, Macmillan, London, 1994
I = John Hick, God has many names, Westminster Press, Philadelphie, 1982
[1] Il est à noter que Hick rédigea une autobiographie dont l’une des raisons était d’expliquer son cheminement intellectuel : John Hick, An autobiography, Oneworld, Oxford, 2005.
[2] La confession de foi de Westminster est une confession de foi calviniste. Établie par l’assemblée de Westminster en 1646 et largement approuvée par l’Église d’Angleterre, elle est le fondement doctrinal de l’Église d’Écosse et exerce une influence prépondérante sur les Églises presbytériennes à travers le monde.
[3] John Hick, God has many names, Westminster Press, Philadelphie, 1982, p. 18.
[4] John Hick, Problems of religious pluralism, Macmillan, London, 1994, p. 11.
[5] Ibid., p. 13.
[6] John Hick, God has many names, op. cit., p. 41.
[7] Cité in John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 51.
[8] Cf., Ibid., p. 53.
[9] Cf., John Hick, God has many names, op. cit., p. 18.
[10] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 71.
[11] Cf., John Hick, God has many names, op. cit., p. 19.
[12] Ibid., p. 74.
[13] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 47.
[14] Ibid., p. 50.
[15] John Hick, God has many names, op. cit., p. 72.
[16] Summa theologica, II/II, Q. 1, art. 2
[17] John Hick, God has many names, op. cit., p. 25.
[18] Ibid., p. 52.
[19] Cf., John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 40.
[20] John Hick, God has many names, op. cit., p. 67.
[21] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 57.
[22] John Hick, God has many names, op. cit., p. 104.
[23] John Hick, Problems of religious pluralism, op. cit., p. 83.
[24] Ibid., p. 87.
[25] Cf., Ibid., p. 77.

Article paru dans L’Homme nouveau n° 1559 du 1er février 2014
GÉOPOLITIQUE D’UNE CHRÉTIENTÉ
Titulaire de deux doctorats, l’un de philosophie, l’autre de théologie, obtenus dans les universités de Paris et de Strasbourg, Antoine Fleyfel vient de publier Géopolitique des chrétiens d’Orient (1) dont la lecture est vivement recommandable. L’auteur, franco-libanais, commence par s’interroger sur le bien-fondé de la formule globale « chrétiens d’Orient » appliquée à ces disciples du Christ dont les identités ethniques, religieuses et nationales sont multiples. Cette désignation ne manque pas d’ambiguïté non plus si l’on tient compte du fait que l’Orient chrétien s’étend bien au-delà des frontières du Levant, à l’est et au nord (on pense, entre autres, à l’Inde et aux pays slaves). Fleyfel choisit finalement de conserver l’appellation classique en limitant toutefois son étude aux chrétiens du monde arabe, répartis sur six territoires (Liban, Jordanie, Irak, Terre sainte, Egypte et Syrie). Avec clarté, il présente la position de ces communautés dans chacun de ces pays à l’époque moderne, expliquant leurs évolutions politiques à travers leur rapport à l’arabité (alors que beaucoup d’entre elles ne sont pas de souche arabe mais ont été arabisées à partir de la conquête musulmane) et leurs relations avec l’Islam contemporain, tout ceci sur le fond des bouleversements surgis ces dernières décennies au Proche-Orient (création d’Israël, guerres d’Irak, terrorisme, révoltes arabes, etc.).
Dans la liste des pays retenus, le Liban occupe la première place en raison du statut privilégié dont disposent ses citoyens chrétiens comparé à ceux du voisinage. L’auteur s’attarde sur les événements douloureux survenus au pays du Cèdre depuis 1975 et sur leurs conséquences dommageables pour les chrétiens. A cet égard, il faut lui savoir gré de montrer en quoi l’expression « guerre civile » trop souvent retenue en Occident pour qualifier ce conflit est erronée. A cause de sa fragilité congénitale, le Liban attire toutes sortes d’ingérences étrangères ; il est le réceptacle de tous les antagonismes régionaux, voire internationaux. Déprimés, frustrés, et surtout divisés, les chrétiens ont perdu beaucoup de leur influence politique mais, souligne l’auteur, ils manifestent une vitalité stimulante au niveau ecclésial et culturel.
En Jordanie, la bienveillance de la monarchie hachémite envers les Eglises suffit-elle à rendre leurs fidèles heureux ? Les chrétiens d’Irak et de Syrie pourront-ils survivre au chaos actuel ? Ceux d’Egypte obtiendront-ils enfin d’être pleinement respectés ? Comment les baptisés peuvent-ils survivre en Terre sainte ? Partout, l’islamisme croissant pèse lourd sur l’avenir. Face à de tels défis, Antoine Fleyfel souhaite pourtant que les chrétiens arabes résistent à la tentation du repli identitaire au profit du combat pour faire triompher les valeurs qui leur sont chères. D’après lui, c’est pour eux le seul moyen de servir la cause de ce monde arabe dont ils ont intérêt à se sentir solidaires.
Annie Laurent
_____
(1) L’Harmattan, 215 p., 23 €.
Antoine Fleyfel interviewé par le journal La Croix, le 27.01.2014
Propos recueillis par Anne-Bénédicte Hoffner

À la fois Français et Libanais, maître de conférences en théologie et philosophie à l’Université catholique de Lille et chargé des relations académiques à l’Œuvre d’Orient, Antoine Fleyfel considère la mention de la liberté de conscience dans la nouvelle Constitution tunisienne comme un « pas en avant » vers la construction d’une société pluraliste et démocratique.
« La question de la liberté de conscience est l’une des revendications majeures des chrétiens mais aussi des “laïques” – musulmans ou autres – dans les pays à majorité musulmane. Elle est aussi à ce titre une revendication du Saint-Siège, qui s’inscrit plus largement dans la logique des droits de l’homme. De fait, aujourd’hui, les conversions posent problème dans les pays majoritairement musulmans parce qu’elles sont interdites par la loi musulmane : sauf au Liban, un musulman qui se convertit au christianisme risque sa vie.
Reconnaître la liberté de conscience dans la Constitution, comme vient de le faire la Tunisie, est donc un pas vers la démocratie, qui n’est pas seulement le règne de la majorité mais aussi le respect d’un ensemble de valeurs contenues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il est important de noter que cette liberté de conscience ne bénéficiera pas seulement aux chrétiens mais à tous, en tant qu’elle favorise l’émergence d’une société pluraliste et respectueuse de tout être humain.
Certains sceptiques diront qu’il ne s’agit que d’une phrase, et que la réalité sociale restera la même… Quant à moi, j’y vois le signe d’un espoir dans le monde arabe. Il n’est pas étonnant que ce pas ait été franchi par la Tunisie, où la société civile qui croit dans ces valeurs humanistes est plus établie, et qui bénéficie d’un acquis laïque malgré la corruption de l’ancien régime.
Au passage, je précise que la laïcité dont on parle dans le monde arabe n’est pas une laïcité crispée, qui cherche à exclure la religion du domaine public, mais une laïcité “à l’orientale”, qui lui reconnaît une place dans la société, capable, par exemple, de s’inspirer des valeurs religieuses universelles, sans pour autant imposer la loi islamique à tous les citoyens. Je sais, bien sûr, que les choses se construisent sur de longues années, que les mécanismes juridiques qui rendront effective cette liberté de conscience sont encore à construire.
Le combat sera sans doute encore long : en Égypte, par exemple, le document publié par Al Azhar en 2012 sur la liberté religieuse, qui nous a tant réjouis, ne va pas jusqu’à évoquer la liberté de conscience. Mais il faut de tels pas. Ce qu’a réussi la Tunisie peut augurer une percée dans le reste du monde musulman. Plaise à Dieu qu’il soit contagieux. »

Je voudrais aujourd’hui présenter un livre récent publié par les éditions L’Harmattan sous le titre « Géopolitique des chrétiens d’Orient ». Son auteur, Antoine Fleyfel, Français d’origine libanaise, enseigne à l’Université catholique de Lille.
Dans la masse des nombreux ouvrages consacrés ces temps-ci aux chrétiens d’Orient, on peut se demander ce que celui-ci apporte de nouveau. Son propos est d’analyser la place et le rôle des chrétiens dans l’Orient arabe (Liban, Jordanie, Irak, Terre sainte, Egypte et Syrie), zone à laquelle l’auteur a choisi de se limiter. Cela exclut donc la Turquie et l’Iran, pays qu’on classe habituellement dans l’ensemble territorial désigné par « Proche-Orient ».
Ce choix a le mérite de préserver une unité culturelle fondée sur le concept d’arabité. Aujourd’hui, cette identité, qui s’est imposée par la conquête arabo-musulmane à partir du VIIème siècle, ne pose pratiquement plus de problème aux chrétiens de la région ; certains la revendiquent même avec fierté. Pourtant, les seuls qui soient vraiment de souche arabe sont ceux de Jordanie et une partie de ceux de Palestine, car ces deux territoires constituaient jadis le nord de l’Arabie. Les autres chrétiens du Proche-Orient ne sont pas tous de souche arabe. Ainsi, en Irak, les assyro- chaldéens se réfèrent à l’ancien peuple assyrien qui composait autrefois la Mésopotamie ; en Egypte, les coptes tiennent à leurs racines qui remontent à l’époque des Pharaons ; au Liban, les maronites aiment parfois se rattacher aux Phéniciens qui peuplaient encore le littoral méditerranéen au temps de Jésus. L’Evangile nous rapporte que le Christ en a rencontrés à Tyr et à Sidon.
Quant aux chrétiens de Syrie, bien que n’étant pas, eux non plus, à strictement parler de souche arabe, ils n’ont aucun problème avec cette identité. Cela provient du fait que l’idéologie du nationalisme arabe est née à Damas au début du XXème siècle ; elle a été conçue et portée par des chrétiens. Il s’agissait pour eux de promouvoir un système social et politique fondé sur l’arabité et non plus sur l’islam, donc sur un critère ethnique ou culturel et non religieux. Pour des communautés devenues minoritaires, cette option avait l’avantage de transcender les clivages confessionnels et devait, en principe, ouvrir la voie à l’égalité entre tous les citoyens. Le régime actuel qui gouverne la Syrie est d’ailleurs l’héritier de cette idéologie. Quel que soit le regard que l’on porte sur l’autoritarisme du président Bachar El-Assad, il faut reconnaître qu’il a su organiser des relations apaisées entre les communautés religieuses de son pays. Cela permet de comprendre la position inconfortable des chrétiens dans le contexte de crise actuel qui leur fait redouter un changement de régime. Antoine Fleyfel explique très bien leur situation, avec toutes les nuances qui s’imposent.
Il reste cependant au Proche-Orient des chrétiens qui ont résisté à l’arabisation. Tel est surtout le cas des Arméniens qui, tout en parlant l’arabe, ont conservé leur langue et leur culture propres.
L’auteur donne au Liban la première place. Et c’est normal, compte tenu du statut d’exception dont jouissent ses citoyens chrétiens, comparé à ceux du voisinage. A propos des crises que connaît le pays du Cèdre depuis 1975, il faut savoir gré à Fleyfel d’expliquer en quoi l’expression « guerre civile », trop souvent retenue en Occident, est erronée. A cause de sa fragilité congénitale, le Liban multiconfessionnel attire toutes sortes d’ingérences et de convoitises étrangères ; il est le réceptacle de tous les antagonismes régionaux, voire internationaux. Déprimés, frustrés, et surtout divisés, les chrétiens ont perdu beaucoup de leur influence politique mais, souligne l’auteur, ils manifestent une vitalité stimulante au niveau ecclésial et culturel.
Antoine Fleyfel montre comment, dans les six pays objet de son étude, l’islamisme triomphant, qui a vaincu l’arabisme laïcisant, pèse sur l’avenir des chrétiens. Face à un tel défi, il souhaite que les disciples du Christ résistent à la tentation du repli identitaire au profit du combat pour faire triompher les valeurs qui leur sont chères. D’après lui, c’est pour eux le seul moyen de servir la cause de ce monde arabe dont ils ont intérêt à se sentir solidaires.
Annie Laurent
Radio Espérance
15.01.2014
À Damas, la médiation subtile du nonce Mario Zenari

Dans la capitale syrienne, Mgr Zenari dispose d’un important réseau d’information et d’influence. Son rôle est notamment d’aider les responsables chrétiens à distinguer le spirituel du politique. Sortant de sa réserve, il n’a pas hésité à dénoncer les atteintes aux droits de l’Homme dans les deux camps.
Lorsque le Vatican a envoyé Mario Zenari en poste à la nonciature à Damas, le 30 décembre 2008, ce dernier était loin de s’imaginer qu’il assisterait trois ans plus tard, à la révolution la plus sanglante du Moyen-Orient. Né en Vénétie, à Vérone, le 5 janvier 1946, il avait acquis son expérience de nonce auprès de pays africains, en Côte d’Ivoire, au Niger et au Burkina Faso, puis en Asie, au Sri Lanka. En Syrie, il s’est trouvé confronté à une population chrétienne en forte diminution – leur nombre avait fondu de moitié depuis l’arrivée de Hafez al Assad au pouvoir –, et des églises d’Orient très divisées. Il a dû aussi – et doit encore plus que jamais – composer avec une hiérarchie religieuse chrétienne syrienne « largement gagnée à la cause du régime, ce n’est un mystère pour personne », souligne un observateur de la scène locale.
C’est dans ces conditions délicates que s’exercent ses qualités reconnues par tous « d’excellent diplomate, bien informé », mais aux moyens limités. En effet, de quel poids, sinon « de quelles divisions » pèse le Saint-Siège dans un conflit qui, en Syrie, oppose un régime doté d’une armée largement approvisionnée par Moscou et Téhéran, à des groupes djihadistes islamistes tout aussi déterminés ?
Le nonce, « puissance diplomatique soft »
« Le nonce apostolique représente le Saint-Siège, sujet de droit international ayant un statut unique, spirituel et moral, rappelle Antoine Fleyfel, maître de conférences à l’Université catholique de Lille. On peut le qualifier de « puissance diplomatique « soft » parce que privée de toute faculté d’exercice de pouvoir coercitif, si ce n’est celui de l’appel à l’opinion publique. Le Saint-Siège agit en Syrie, à travers la nonciature et les autorités catholiques, dans la mesure de ce que lui permet sa nature même, celle d’un État sans armée ou pouvoir économique, mais fort d’un poids moral consistant à représenter plus d’un milliard trois cent millions de catholiques, et d’un large réseau de relations. Il est la seule diplomatie qui agit sérieusement en faveur des chrétiens d’Orient, en mettant en avant la paix, les droits de l’homme, la liberté de conscience et la citoyenneté ».
Mais Monseigneur Zenari dispose sur le terrain d’un réseau d’évêchés et de chrétiens qui l’informent de la situation et peuvent servir de médiateurs. « Le rôle du nonce est aussi d’aider les responsables chrétiens à distinguer le spirituel du politique, ajoute Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient, une distinction difficile dans le monde arabe. D’un côté, l’islam ne fait pas cette différence ; de l’autre, les patriarches et les évêques ont hérité de l’empire ottoman d’être les représentants civils de leur communauté devant le Sultan ».
Interventions publiques et médiation interreligieuse
Il peut aussi dénoncer les atteintes aux droits de l’homme, de part et d’autre. Après les images relayées par les médias des attaques chimiques contre les civils, en août 2013, dans la banlieue de Damas, Mario Zenari est sorti de la réserve diplomatique d’usage : « Les Syriens appellent à l’aide la communauté internationale pour qu’elle les aide à en finir avec cette guerre. Ils lui disent : on en a assez, on n’en peut plus, on ne peut pas continuer plus longtemps », lançait-il alors. Plus récemment, il est intervenu publiquement lors de l’enlèvement des 11 religieuses du Monastère grec-orthodoxe de Mar Thecla (Sainte Thècle), à Maaloula.
En Syrie, Mgr Zenari a tenté à plusieurs reprises, de pousser les responsables des églises chrétiennes à faire une déclaration commune avec les chefs musulmans, en vain.
« En préparation de la conférence de Genève II, le 22 janvier prochain, une réunion des responsables chrétiens syriens est prévue au cours de laquelle ils réfléchiront à leur rôle de paix dans une transition ou un processus de paix. Ils ne sont pas invités en tant que tel à Genève, mais ils ont conscience qu’ils ont un rôle à jouer », explique Pascal Gollnisch. Selon lui, « au risque d’être taxé d’angélisme, qu’on le veuille ou non c’est la négociation et elle seule qui permettra d’aboutir à la paix ».
AGNÈS ROTIVEL
La Croix
13.01.2014
Intervention de Antoine Fleyfel sur France 2 dans le cadre de l’émission Le jour du Seigneur, pour parler de l’histoire des maronites le 22 décembre 2013.
Un avenir en clair-obscur pour les chrétiens d’Orient

Ébranlées par l’instabilité régionale, les communautés chrétiennes d’Orient sont loin d’être promises au déclin, même si leur présence tend à se resserrer.
Chrétiens d’Orient… En songeant aux maronites, aux melkites, aux coptes, aux arméniens ou encore aux chaldéens, on se figure des Églises d’un autre âge, dont les rites sibyllins font résonner des langues oubliées, puisant leurs racines dans les temps apostoliques, mais dont la disparition serait, à terme, inéluctable. Cette vision répandue est pourtant assez éloignée de la réalité.
Des situations très variables
S’il admet que la vitalité des communautés orientales est mise à mal par l’instabilité du monde arabe, le P. Jean-Marie Mérigoux ne souscrit guère aux prédictions les plus alarmistes. « Bien sûr, le contexte syrien ou irakien est extrêmement délicat pour les chrétiens, reconnaît ce dominicain qui a vécu quatorze ans à Mossoul, en Irak. Mais d’un pays à l’autre, les situations sont très variables. Nous devons garder à l’esprit que ces Églises ont toujours su surmonter leurs difficultés. »
En présence des patriarches orientaux réunis à Rome en novembre, le pape François lui-même a confié ne pas pouvoir se résigner « à penser le Moyen-Orient sans les chrétiens ».
Cette préoccupation se nourrit du traumatisme irakien. Après l’invasion américaine de 2003, ce pays a vu sa population chrétienne passer de 1 200 000 à moins de 500 000 fidèles. Le conflit syrien en aurait déjà poussé 450 000 sur les routes de l’exode. « En dépit de cette saignée, les chrétiens sont loin d’avoir déserté l’Orient. Leur présence reste importante au Liban, atténue Antoine Fleyfel, professeur à l’Université catholique de Lille. En Égypte, leur poids démographique – 8 millions de coptes – rend leur disparition impossible. » Pour ce chercheur franco-libanais, les chrétiens subissent souvent les conséquences de ces difficultés, au même titre que les autres communautés.
Un problème démographique
Directeur de l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman, à Paris, Bernard Heyberger avance une hypothèse originale pour démentir ce scénario d’un déclin programmé du christianisme en Orient, que beaucoup s’obstinent à lier à l’émergence de l’islam, au VIIe siècle.
« Si l’on se penche sur l’histoire démographique, développe-t-il, on constate que le XIXe siècle a été une période de progression de la proportion et du nombre de chrétiens par rapport aux musulmans dans les sociétés du Proche-Orient. La régression observée au XXe siècle n’est pas la conséquence d’une volonté intrinsèque de l’islam de faire disparaître le christianisme, mais celle d’un différentiel démographique. »
La transition démographique des chrétiens – comme celle des juifs – a été plus précoce que celles des musulmans, qui sont en train de la vivre à leur tour. « Je ne nie pas un affaiblissement du christianisme oriental, mais les causes ne sont pas celles que l’on avance habituellement. Évidemment, poursuit Bernard Heyberger, en Irak et en Syrie, des chrétiens émigrent parce qu’ils se sentent menacés. Mais dans tous ces pays, la question du pluralisme continuera de se poser. »
Trois défis à relever
Une certitude partagée par Antoine Fleyfel, qui soumet l’avenir de ces Églises à trois défis conjoints : maintenir une attitude de dialogue avec l’islam en dépit de la violence d’une minorité extrémiste ; œuvrer à l’unité de traditions parfois distantes (par exemple en unifiant la date de Pâques) ; et enfin s’engager en faveur de la citoyenneté.
« Leur force tient essentiellement à leur foi, observe de son côté Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient.Une foi solide, doublée d’un sens aigu de la famille. Sur le plan social, ils n’ont jamais perdu le lien entre la paroisse, le dispensaire et l’école. Ils savent articuler le soin du corps, de l’esprit et de l’âme. »
Leur engagement au service du bien commun en fait des acteurs de premier plan. Au Proche-Orient, leur influence déborde largement leur nombre réel. D’aucuns soulignent toutefois la nécessité d’une meilleure formation des laïcs, tant pour assumer les besoins de leurs Églises que pour peser sur l’avenir de ces sociétés.
FRANÇOIS-XAVIER MAIGRE
La Croix
20.12.2013
Les chrétiens arabes d’Orient : présence et conditions d’avenir
L’ampleur des crises qui traversent le Moyen-Orient révèlent de violents conflits dont les acteurs sont les différentes franges religieuses, politiques et confessionnelles de l’islam. Pourtant, les difficultés qu’affrontent les chrétiens d’Orient, une communauté estimée à environ 10 millions de personnes en 2013 et présente dans l’ensemble des pays arabes de la région, ne sont pas moindres : l’instabilité politique en Égypte et la guerre syrienne les touchent de plein fouet.
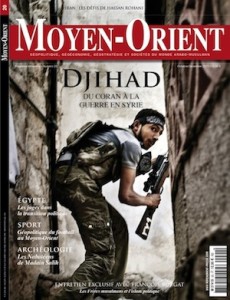
L’expression « chrétiens d’Orient » est ambiguë. L’histoire du concept et les différents contenus qu’on lui assigne en compliquent la compréhension. Nous aurions préféré nous en passer, mais son utilisation désormais généralisée nous en empêche. Soulignons cependant le fait que presqu’à chaque fois qu’il est question des « chrétiens d’Orient », on parle d’une manière plus précise des « chrétiens arabes », c’est-à-dire les citoyens chrétiens des six nations du Proche-Orient arabe, à savoir : le Liban, la Syrie, la Jordanie, l’Irak, l’Égypte et les Territoires palestiniens, liste à laquelle on peut ajouter Israël (cf. carte). Le qualificatif d’« arabes » n’est ni ethnique, ni politique, ni religieux, mais culturel et national. Ces chrétiens sont dans leur écrasante majorité de culture et de langue arabe ; et ils appartiennent, exception faite de l’État hébreu (1), à des pays arabes. Ainsi, c’est précisément d’eux qu’on parle lorsque qu’on utilise l’expression « chrétiens d’Orient », sans toutefois exclure le fait que ceux de Turquie, d’Iran ou d’autres pays de la région peuvent être appelés de la sorte.
La réalité des « chrétiens arabes » est variée ; elle dépend de la diversité des contextes politiques dans lesquels ils sont présents. Ainsi, tout discours qui en traite comme un phénomène uniforme est à écarter. La situation des Libanais n’a effectivement rien à voir avec celle des Égyptiens ou des Irakiens. Selon les différents États, ils sont bien ou mal représentés politiquement ; dans un pays ils vivent des difficultés alors qu’un autre les protège ; certains régimes les considèrent comme partenaires et d’autre agissent avec discrimination ; de certaines régions ils fuient et dans d’autres ils prospèrent. Enfin, ces chrétiens subissent en général des tensions, des bouleversements et des circonstances qui sont presque identiques pour tous, même si leur présence répond parfois à une logique politique et sociale propre. Cependant, au moins cinq traits concernent la majorité des « chrétiens arabes » : la grande diversité de leurs Églises et leurs histoires conflictuelles ; l’appartenance à l’arabité en tant que donnée culturelle et civilisatrice ; le partage de la terre avec l’islam ; le rapport à la cause palestinienne, ainsi que les conséquences du conflit israélo-arabe ; le rapport historique, heureux ou malheureux, avec l’Occident. Ces traits ont des répercussions évidentes sur leur présence et permettent de se faire une idée des défis que les « chrétiens arabes » auraient à relever pour l’avenir de leur présence au Machrek.
Géographie confessionnelle du Liban et de la Jordanie
Considéré comme le refuge des chrétiens en Orient, le Liban est un pays au système politique élaboré pour protéger les minorités, notamment les chrétiens. La formule protectrice dite « régime confessionnel » repose sur le Pacte national établi en 1943 entre chrétiens et musulmans. L’un de ses principes majeurs suppose la répartition du pouvoir entre les communautés religieuses : le président de la République et le chef de l’armée doivent être maronites, le Premier ministre sunnite et le président de la Chambre des députés chiite. Jusqu’à l’accord de Taëf de 1989, qui mit fin à la guerre civile (1975-1990), les chrétiens jouissaient d’une prééminence politique, notamment à travers les compétences du chef de l’État. Celui-ci avait de larges privilèges en matière de pouvoirs exécutifs et législatifs, mais le texte de Taëf en transféra la majorité au Conseil des ministres et au Parlement. La période d’occupation syrienne (1990-2005) n’arrangea guère les choses et priva les chrétiens de toute participation sérieuse à la gouvernance du Liban, où le pouvoir politique des sunnites et des chiites prit une considérable ampleur. En 2013, ils exercent une certaine influence, notamment avec le Bloc du changement et de la réforme, coalition qui représente le Courant patriotique libre de Michel Aoun et ses alliés.
Les Églises, témoins d’une grande vitalité, notamment la maronite (2), jouent toujours un rôle déterminant à bien des égards : universités, écoles, hôpitaux, centres de recherche et de dialogues, politique, maisons d’édition, médias, presse, patrimoine, etc. Par ailleurs, les chrétiens détiennent toujours un pouvoir économique considérable. En l’absence de recensement officiel, il est difficile d’avancer des chiffres fiables, mais les chrétiens représenteraient un peu moins de 40% de la population. Même si l’avenir des Libanais chrétiens n’est pas sombre, il dépend dans une large mesure des conséquences du conflit fratricide qui oppose le sunnisme et le chiisme politiques en Orient.
Les Jordaniens chrétiens sont parmi les moins connus. Si les autorités veillent, peu ou prou, sur ses eux, il existe des difficultés et des craintes de plus en plus amples face à une « islamisation » de la société. Le royaume est une monarchie héréditaire dotée d’un système gouvernemental. Même si sa religion est l’islam, l’État se porte garant de la liberté de culte et de religion, et reconnaît les communautés chrétiennes qui jouissent d’une certaine autonomie de droit privé. Ce positionnement de principe est pour les chrétiens source d’épanouissement, d’autant qu’il est complété par diverses mesures politiques « rassurantes ». Ainsi, ils sont surreprésentés au Parlement : sur les 60 sièges de la chambre haute, le roi nomma en 2010 six chrétiens (10%), presque trois fois leur poids démographique. Sur les 150 sièges de la chambre basse, 10 sont occupés par des chrétiens en 2013 (6,6 %).
Les estimations les plus optimistes avancent que les Jordaniens chrétiens seraient un peu moins de 4% de la population. La Jordanie reconnaît onze Églises qui forment un Conseil consultatif du gouvernement pour toutes les affaires chrétiennes. Les trois plus importantes sont la grecque orthodoxe, la grecque catholique et la latine. Elles témoignent d’un grand engagement social, notamment sur le plan de l’éducation. Par ailleurs, la communauté chrétienne détiendrait une partie considérable de l’économie jordanienne. Toutefois, elle éprouve divers malaises. Parmi les causes les plus importantes, nous pouvons citer le transit de nombre d’Irakiens chrétiens fuyant leur pays, la radicalisation islamiste de certaines franges de la société et l’absence de l’enseignement religieux dans les écoles publiques pour les élèves chrétiens.
L’Irak et la Palestine, lieux de souffrances et de résistance
La situation catastrophique vécue par les Irakiens chrétiens depuis l’invasion américaine de 2003 n’est pas le premier événement ayant causé un exode. Ils vécurent différents revers de ce genre durant l’histoire, pendant la période britannique (1914-1958) et celle du parti Baas (1968-2003). Ainsi, entre 1980 et 1988, ils subirent les conséquences de la guerre avec l’Iran (on estime à 10 000 les chrétiens irakiens morts sur le front), et souffrirent ensuite la politique restrictive de Saddam Hussein qui, en quête de légitimité, se recentra sur l’identité arabe et islamique du pays. Depuis l’occupation américaine en 2003, ils sont victimes d’assassinats et d’incidents graves, d’intimidations, des facteurs incitant au repli ou à l’exil. Toutefois, nombreux sont ceux qui restent certains relèvent le défi de la présence : en 2013, les chrétiens représenteraient entre 1 % et 1,5 % de la population. Les chaldéens (catholiques) sont les plus nombreux (plus des deux tiers) ; ils sont suivis par les syriaques et les assyriens. La Constitution de 2005, selon laquelle l’islam est religion d’État, leur offre des garanties culturelles et religieuses. Cependant, aucun quota ne leur est réservé au Parlement. L’interminable situation d’insécurité soulève de sérieuses inquiétudes quant à leur avenir.
En Terre sainte, c’est-à-dire sur le territoire correspondant à l’ancien mandat britannique de Palestine (1920-1948), les chrétiens subissent les lourdes conséquences du conflit, notamment dans les Territoires occupés. Suite au partage de 1947, de violents affrontements opposèrent juifs et arabes, ce qui rapprocha les chrétiens et les musulmans palestiniens qui subirent ensemble les exodes et les guerres. Certains firent partie intégrante de la résistance, dont des figures importantes, comme le prêtre latin Ibrahim Ayad, membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), l’évêque grec catholique Hilarion Capucci, les orthodoxes Georges Habache, fondateur du Front populaire de libération de Palestine (FPLP), et Nayef Hawatmeh, du Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP). Cependant, l’engagement chrétien ne se limite pas aux domaines politiques et idéologiques, beaucoup moins importants au XXIe siècle. Les Églises, à travers diverses figures et centres de recherches, sont engagées pour le dialogue et sont porteuses d’une mission sociale et éducative majeure. Leur engagement pour la cause palestinienne trouve sa meilleure expression dans le document Kairos-Palestine (2009).
Treize communautés chrétiennes sont reconnues par les autorités palestiniennes et israéliennes. Les Églises grecques orthodoxes et catholiques ont le plus de fidèles ; l’Église latine arrive en troisième rang. En 2013, dans les Territoires occupés, les chrétiens représentent environ 1,4% de la population, et en Israël 2,1%. La Loi fondamentale de l’Autorité palestinienne offre des garanties confessionnelles de droit privé aux chrétiens qui se trouvent surreprésentés au Parlement : sur les 66 députés, six doivent obligatoirement être chrétiens. De son côté, l’État hébreu, qui reconnaît la liberté de conscience et de culte, n’offre aucune garantie de représentativité politique.
L’Égypte et la Syrie : la citoyenneté face au conflit
Les Égyptiens chrétiens sont les champions de la démographie en valeur absolue : représentant presque 8 % de la population, ils seraient presque sept millions. Ainsi, deux chrétiens sur trois au Machrek arabe sont Égyptiens. Cependant, leur problème principal réside dans le fait qu’ils ne participent pas à la gouvernance de leur pays à hauteur de leur poids démographique, ni même historique. Au contraire, ils subissent une situation de sous-citoyenneté, notamment sous Gamal Abdel Nasser (1954-1970), les reléguant à un rang politique et social secondaire par rapport au citoyen type, le musulman sunnite. Cela fait du combat pour la citoyenneté leur cause par excellence, laquelle fait face à nombre de difficultés, notamment des violences qu’ils subissent depuis les années 1970.
Il existe plusieurs Églises en Égypte, mais la plus importante est la copte orthodoxe, qui représente 90 % des chrétiens. Elle est suivie par la copte catholique et la copte protestante. Les renouveaux monastiques et spirituels successifs menés au sein de l’Église copte orthodoxe – sous l’égide des deux papes, Cyrille VI et Chénouda III – à partir des années 1960 en firent une communauté vivante. Néanmoins, le revers de la médaille est un vécu de foi beaucoup plus déterminé par la piété que par la recherche théologique critique, ainsi que par une cléricalisation accrue.
Les différentes Constitutions témoignent de la problématique citoyenne et d’une tension entre une Égypte laïque et une autre islamique. Tous les textes ont jusque-là souligné l’égalité des citoyens devant la loi « en droits et en devoirs publics, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de dogme ». Cependant, ce principe se heurte toujours à l’article 2 qui stipule : « L’islam est la religion de l’État, la langue arabe sa langue officielle, les principes de la loi islamique constituent la source principale pour légiférer ». Ainsi prend place une tension entre citoyenneté et islamité qui se manifeste par un statut de sous-citoyenneté pour les chrétiens. Ceux-là se trouvent presque exclus des hauts postes de la fonction publique et largement sous-représentés : dans l’Assemblée du peuple issue des élections de 2011-2012, ils avaient 11 sièges sur 508. Par ailleurs, ils subissent de nombreuses discriminations. Les Égyptiens chrétiens participèrent en grands nombres à la révolution en 2011. Depuis, ils se rangent en majorité du côté de l’armée, ce qui leur a valu des attaques violentes effectuées par des islamistes présumés, dans le cadre des événements relatifs à la destitution du président Mohamed Morsi le 3 juillet 2013.
En Syrie, après plus de deux années de guerre, il est difficile de parler de la situation des chrétiens. Il convient néanmoins de souligner que le Baas, au pouvoir depuis 1970, a une dette historique envers eux : l’orthodoxe Michel Aflak (1910-1989) est l’un des fondateurs et idéologues du parti. Ce dernier voulait créer une assise laïque commune aux chrétiens et aux musulmans, sur fond d’arabisme teinté d’islamité et de socialisme révolutionnaire. En outre, ce régime, ayant à sa tête des alaouites, une minorité qui représente un peu plus de 10 % des Syriens, trouve en la communauté chrétienne un allié naturel. Celui-ci se complait dans cette alliance garante d’une liberté absolue de pratique religieuse, et d’un considérable épanouissement social, économique et politique. Le prix à payer est l’appui indéfectible au régime, ce que la plupart font par conviction ou par nécessité.
La Syrie, un pays laïque, est dotée d’une Constitution teintée d’islamité : la religion du président de la République est obligatoirement l’islam, et la Charia « jurisprudence islamique » est une source de législation. Cependant, les chrétiens jouissent de garanties constitutionnelles respectant leur spécificité culturelle et religieuse. En outre, ils sont présents presque partout dans la fonction publique, même jusqu’à la tête de l’armée (3). Dans la société, ils jouent un rôle économique important, notamment dans les domaines industriels, commerciaux, mais aussi dans les professions de médecins, avocats, professeurs, ingénieurs et journalistes.
Les grecs orthodoxes sont de loin les plus nombreux parmi les chrétiens. Ils sont suivis par les grecs catholiques, les arméniens orthodoxes et les syriaques orthodoxes. Les hiérarchies religieuses se sont toujours rangées du côté du régime d’une manière explicite, voire militante, ce qui leur a valu beaucoup de critiques après le début des soulèvements en 2011. Mis à part quelques opposants, dont Michel Kilo, il ne semble pas que les Syriens chrétiens aient changé de bord, moins par attachement excessif à un régime qui doit se réformer à leur yeux, que par la crainte de l’insurrection islamique, d’une insurrection fortement teintée d’islamisme, qui ne les a pas encore rassurés d’une manière significative. Leur avenir est aussi trouble que celui du pays.
Le combat de l’autre dans la société
La question de la présence chrétienne au Proche-Orient arabe ne se résume pas par les simples dimensions religieuses ou culturelles. En soi, les « chrétiens arabes » constituent une richesse inestimable, mais leur présence dans la société représente une réalité politique fondamentale, celle de l’altérité. Ils sont dans les sociétés arabes, presque toutes déterminées par la vision théologique musulmane du monde, l’« autre », le « différent » et le « miroir » peut-être. Ainsi, s’engager pour leur cause ne se réduit pas à un engagement religieux ou confessionnel, mais correspond à engagement humain et citoyen qui concerne tous les Arabes. Par conséquent, le combat pour la présence chrétienne au Proche-Orient arabe devient un combat laïque afin d’édifier des sociétés citoyennes garantes de la diversité religieuse et culturelle.
Toutefois, répondre à la question sur quel sera le futur des communautés chrétiennes est très difficile à formuler puisqu’on est toujours incapable d’apprécier l’avenir de toute la région, eu égard aux bouleversements successifs qui y prennent place. Il reposera au moins sur la responsabilité d’eux-mêmes, des musulmans et de l’Occident.des appuis, à l’Occident et à l’Est. Il dépendra de leurs engagements divers dans leurs pays, aux niveaux économiques, politiques, associatifs, éducatifs, sanitaires ; des actions de leurs Églises, notamment du dialogue œcuménique et du rapprochement, car il n’est pas question pour une communauté seule de relever le défi de la présence. Si avenir il y a pour les « chrétiens arabes », c’est un avenir qu’ils devraient faire ensemble, mettant de côté les lourds héritages historiques de schismes et de rejets dogmatiques. Par ailleurs, la question du dialogue avec l’islam doit être toujours primordiale : pas de salut politique pour les chrétiens en Orient sans cela. Ainsi, les attitudes de rejet de la religion musulmane et des musulmans – amplifiées dans le contexte des événements en Syrie –, ou les idéologies fantasmagoriques magnifiant un Orient chrétien glorieux sont des plus nuisibles à l’avenir des « chrétiens arabes ». Il incombe à l’islam, durant cette période trouble, d’effectuer de nombreux efforts qui se révèlent cruciaux dans certains pays. Les musulmans proche-orientaux sont responsables de l’avenir des chrétiens, et les deux communautés ont tout intérêt à œuvrer conjointement pour l’avenir, d’autant plus qu’ils ont besoin les uns des autres pour l’édification d’une cité humaine fondée sur la justice, la démocratie et la diversité. Les entreprises de dialogue et d’action commune avec l’islam sont une tradition au Proche-Orient, mais se trouvent teintées d’un certain essoufflement, voire de beaucoup d’aspects folkloriques qui nuisent aux exigences de ces exercices. Il appartient aux « chrétiens arabes » de poursuivre leur engagement dans cette voie, avec le plus grand sérieux, d’autant que le dialogue franc et authentique est l’un des antidotes majeurs à la violence du fanatisme.
Antoine Fleyfel
NOTES
(1) Bien que la majorité des chrétiens de nationalité israélienne (environ 161 000 personnes en 2013) sont de culture arabe.
(2) Deux Libanais chrétiens sur trois sont maronites. En importance numérique, les Églises grecque orthodoxe et grecque catholique arrivent en deuxième et troisième rang.
(3) On retiendra par exemple le général Youssef Chakkour, chef d’état-major entre 1972 et 1974 ?, ancien vice-ministre de la Défense, et le général Daoud Rajha, ministre de la Défense assassiné le 18 juillet 2012 lors d’un attentat.
|
|