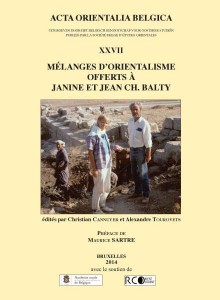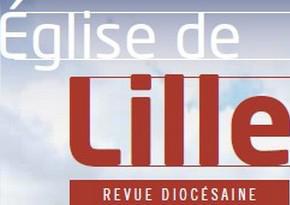|
|
La crucifixion existe aujourd’hui en Syrie

Réalité ou montage ? Des cadavres couverts de sang, ligotés sur une croix et exposés au regard de la foule… Visibles sur des centaines de sites Internet, ces images effraient par leur barbarie et la charge symbolique qu’elles renvoient.
Mais que faut-il en penser en l’absence des moyens classiques de vérification : crédit photo, témoins directs ?
La guerre qui déchire la Syrie se livre aussi sur Internet où toutes les manipulations sont possibles. En effet, une même photo suggère une lecture totalement différente en fonction de son lieu d’hébergement : présenté sur tel site djihadiste comme un musulman expiant sa faute au nom d’une prétendue loi islamique, le même « crucifié » apparaît ailleurs comme un chrétien martyrisé en raison de sa foi. Prudence, donc.
Le chercheur franco-libanais Antoine Fleyfel, professeur à l’université catholique de Lille, a néanmoins accepté de se livrer pour La Croix à une recherche à partir de quelques mots clés sur des sites arabophones et francophones. « La crucifixion existe aujourd’hui au Proche-Orient, confirme le chercheur. Ces actes sont le plus souvent commis par les djihadistes ultras de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et visent des musulmans. »
Deux types de pratiques
Photos ou films à l’appui, deux types de pratique peuvent être relevés sur la toile. Dans le premier cas, la « crucifixion » n’entraîne pas la mort et vise surtout à humilier un individu en public afin de le punir pour son comportement. « Il faut écarter les représentations autour de la croix du Christ avec des clous, poursuit le chercheur. Ici, il s’agit plutôt d’exposer le condamné dans une posture cruciforme en l’attachant à un support qui n’est pas forcément une croix. »
L’Observatoire syrien de droits de l’homme rapporte le cas – repris par quantité de sites – d’un homme exposé durant huit heures, le 30 juin dernier à Al-Bab, dans la banlieue d’Alep, avant de recevoir vingt coups de fouet.
Dans le second cas, le plus répandu, la torture et/ou l’assassinat par balles précède la crucifixion. Là encore, les victimes sont des musulmans. Selon la même ONG syrienne, huit rebelles syriens ont été tués, puis leurs corps crucifiés, sur la place de Deir Hafer, un village de la province d’Alep, au mois de juin dernier.
« L’EIIL reproche à ces rebelles, dont certains appartiennent à l’Armée syrienne libre ou au front Al-Nosra, la branche syrienne d’Al-Qaida, d’être trop ‘mous’ et de ne pas prêter allégeance au califat », explique Antoine Fleyfel. Ces affrontements entre le groupe ultra-radical et les autres rebelles, excédés par les volontés hégémoniques de l’EIIL, ont déjà fait 6 000 morts depuis janvier dernier.
Des témoignages difficiles à vérifier
A l’occasion, l’EIIL déchaîne sa cruauté contre ses propres membres. Une série de photos diffusées sur les sites djihadistes montre un homme portant une barbe, avec du sang sur la tête et une pancarte. « Coupable : Abou Adnane al Anadali. Sentence : exécution et crucifixion durant trois jours. Motif : extorsion aux barrages des conducteurs en les accusant d’apostasie. » « L’EIIL prétend instaurer une justice sociale très stricte en se fondant sur la loi islamique », poursuit Antoine Fleyfel.
Les chrétiens sont-ils eux aussi victimes de ces pratiques barbares ? « Si la crucifixion de chrétiens – par des musulmans avec un motif religieux – est historiquement établie au Proche-Orient, elle avait à peu près disparu avec l’effondrement de l’empire ottoman », explique le P. Jean-Marie Mérigoux, ancien membre de l’Institut dominicain d’études orientales (Ideo) du Caire.
La réapparition de crucifixions dans le sillage de l’EIIL s’est accompagnée de témoignages difficiles à vérifier. Sœur Raghida Al-Khoury, ancienne directrice d’une école gréco-catholique à Damas, aujourd’hui réfugiée en France, a ainsi fait état sur Radio Vatican, en avril dernier, de la crucifixion de deux chrétiens par des djihadistes à Maaloula, au motif qu’ils refusaient de se convertir.
Sans exclure que de telles atrocités puissent être commises, Aide à l’Eglise en détresse n’a pas pu confirmer. Idem du côté de l’Œuvre d’Orient, qui a sondé deux évêques sur place, à Alep et Hassaka. « Aucune famille chrétienne de la région n’a jusqu’à présent témoigné de telles pratiques », explique Catherine Beaumont, responsable de la communication.
Cela n’a pas empêché le pape François lui-même de confier, le 2 mai dernier, avoir pleuré en apprenant dans la presse que « des chrétiens (étaient) crucifiés dans un certain pays non chrétien », sans citer explicitement la Syrie.
Quant à la présidence du Conseil des conférences épiscopales d’Europe (CCEE), elle a exprimé sa « vive indignation » après la crucifixion des rebelles syriens de Deir Hafer.
————————————————
L’EIIL cible les minorités religieuses
Plusieurs informations circulent sur des mesures prises par l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) à l’égard des chrétiens en Irak. « Un ’N’, la première lettre du mot arabe ’nazaréen’ signale les maisons des chrétiens à Mossoul, qui sont vides. Pour les autres, leurs occupants ont été contraints de les abandonner, de devenir musulmans ou de payer l’impôt de protection prévu par la dhimma », indique ainsi l’agence catholique italienne SIR. « Nous n’avons pas entendu parler d’impôts spéciaux levés sur les chrétiens pour le moment, parce qu’il reste très peu de chrétiens à Mossoul », affirmait toutefois la semaine dernière Mgr Amel Shamon Nona, archevêque chaldéen de Mossoul.
L’information selon laquelle l’EIIL aurait suspendu « toute fourniture d’aliments et de gaz pour les quelques chrétiens restant dans la ville, les chiites et les Kurdes » a, elle, été confirmée à l’agence SIR par le vicaire patriarcal de Bagdad, Mgr Shlemon Warduni.
Selon l’association Fraternité en Irak, ces restrictions s’étendent également aux Yezidis, autre minorité religieuse du pays.
Samuel Lieven
La Croix
17.07.2014
Éditorial du numéro 2, 2014, de la revue universitaire de L’Œuvre d’Orient, Perspectives & Réflexions.

Un an s’est déjà écoulé, et Perspectives & Réflexions est de retour, fidèle à son rendez-vous annuel, afin de proposer à ses lecteurs de nouvelles études sur les chrétiens d’Orient. Le démarrage de notre revue a été remarquable : presque 2000 fascicules demandés, ce qui est exceptionnel pour une publication de nature universitaire. Nous sommes reconnaissants à nos auteurs pour la qualité exceptionnelle de leurs textes, mais aussi à tous ceux, engagés et sympathisants, qui s’intéressent à la noble mission de l’Œuvre d’Orient.
Ce deuxième numéro met l’accent sur les relations des chrétiens d’Orient avec le monde, arabe et occidental, et les questions qui en découlent, en suivant trois de leurs aspects : la dimension œcuménique, le lien à l’islam et le rapport à l’Occident. Deux articles apportent une vue philosophique, historique et géopolitique sur la présence des chrétiens au Moyen-Orient.
Le premier article parle de la Syrie et de ses chrétiens, un sujet que nous avions choisi d’éviter l’année dernière, en espérant des jours meilleurs et plus de clarté sur la situation. Mais le conflit s’enlisant tous les jours dans une spirale de violence absurde et interminable, nous avons décidé de présenter les réflexions d’un fin connaisseur de la géopolitique du Moyen-Orient, Georges Corm, qui nous fournit une lecture de l’histoire, de l’actualité et des horizons de la présence chrétienne en Syrie. Mouchir Aoun nous livre la suite de son étude sur « Le réveil identitaire arabe et le destin du christianisme oriental contemporain » paru dans le numéro 1. Son texte présent entend « esquisser les grandes lignes d’une réflexion critique sur la condition d’existence individuelle et collective des chrétiens d’Orient ».
Les quatre articles suivants abordent la problématique des relations des chrétiens d’Orient. Gabriel Hachem souligne la grande importance de l’œcuménisme pour l’avenir de la présence chrétienne dans la région, tout en s’appuyant sur l’expérience du Conseil des Églises du Moyen-Orient. La question de la relation avec l’Occident est traitée par Bernard Heyberger. Il s’appuie sur une étude historique qui souligne les influences de l’Occident sur l’identité chrétienne orientale, notamment à travers les protections diplomatiques, l’érudition et la tension vécue entre la tradition et la modernité. Quant à l’islam, sujet qui soulève autant de passion en Orient qu’en Occident, il est abordé à travers deux angles différents. Michel Younès évoque ce qu’il considère être la vocation des chrétiens d’Orient dans leur rapport à l’islam et aux musulmans, et Georges Massouh étudie la place qu’occupent les chrétiens dans l’État islamique prônée par différents courants théologiques « islamistes ».
Je ne puis qu’exprimer une fois encore ma gratitude à l’Œuvre d’Orient qui permet, à travers ce projet, à nombre de lecteurs français et francophones de connaître encore mieux l’Orient et ses chrétiens. Toute ma reconnaissance aussi aux collègues et amis qui ont généreusement accepté d’écrire pour nous leurs précieuses réflexions.
Tout en n’oubliant pas les hommes et les femmes qui souffrent partout dans le monde, notre regard est particulièrement fixé en ce moment sur la Syrie pour laquelle nous espérons la paix, non celle qu’imposent la force, les intérêts politiques et économiques ou la destruction, mais celle qui prend source dans les cœurs des gens de bonne volonté…
Antoine Fleyfel
Rédacteur en chef
Perspectives et réflexions N°2-2014, Œuvres d’Orient, Les chrétiens de France au service des chrétiens d’Orient, Ouvrage co-écrit par Georges Corm, Mouchir Aoun, Gabriel Hachem, Bernard Heyberger, Michel Younes, Georges Massouh, mars 2014.
Article publié le 10/07/2014 sur le site www.lesclesdumoyenorient.com
Compte rendu de Ines Zebdi

« Œuvres d’Orient : les chrétiens de France au service des chrétiens d’Orient » est le deuxième numéro de la revue Perspectives et Réflexions, publiée pour la première fois en avril 2013. Six auteurs ont participé à l’écriture cet ouvrage consacré aux relations entre les chrétiens d’Orient et le monde arabe et occidental, à leurs liens avec l’islam et à la dimension œcuménique.
Le premier article, écrit par Georges Corm, s’intitule « Quels horizons pour la présence chrétienne en Syrie ? ». L’auteur, ancien ministre des Finances de la République libanaise entre 1998 et 2000 et professeur à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, livre une analyse historique et actuelle de l’enjeu de la présence chrétienne en Syrie.
Les chrétiens représentent aujourd’hui 7 à 8% de la population syrienne, ce qui est en proportion très inférieur à la situation libanaise, mais en valeur absolue, les deux populations sont équivalentes, aux alentours de 1,5 million de personnes.
Lorsque la Syrie se convertit au christianisme sous l’Empire romain, de nombreuses tensions confessionnelles apparaissent. Ces querelles vont faciliter la conquête du pays par les Arabes qui feront de Damas la capitale des Omeyyades en 661. Les chrétiens et les musulmans vivent alors en communauté, les chrétiens ont toujours été bien intégrés dans la société ; ils ont notamment participé à la lutte pour l’indépendance du pays à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L’auteur pose alors la question de l’identité même de ces chrétiens : sont-ils des « chrétiens de Syrie », ou des « Syriens chrétiens » ? Il cite le père Jean Corbon [1], qui parle plutôt d’un christianisme arabe en général, lequel existe dans un même milieu culturel, géographique et socio-économique. Il ne faudrait plus alors considérer ce que l’on nomme « la question d’Orient » comme des majorités musulmanes opprimant des minorités chrétiennes, mais plutôt l’envisager sous l’angle de l’instrumentalisation des sociétés minoritaires par les Européens dans l’Empire ottoman avant qu’il ne disparaisse. L’Occident a eu de fait une influence dans la région, notamment en Syrie et Liban, placés sous mandat français après les accords Sykes-Picot. La présence française au Liban a été assez marquante, alors qu’en Syrie, elle a été plus marginale, ou du moins s’est manifestée différemment. La France a joué la carte chrétienne au Liban, alors qu’en Syrie, elle a plutôt misé sur les minorités alaouites. Même si les communautés chrétiennes des deux pays ne sont pas si différentes, leur place dans la société n’est pas la même. En Syrie, les chrétiens se sont mieux fondus dans la population, l’université est unique et publique, si bien qu’il n’y a pas de communautarisme au niveau de l’éducation, et il n’y a pas non plus de répartition communautaire des fonctions publiques. La société syrienne connaît un point de rupture au moment de l’arrivée du parti Baas au pouvoir, puis lors de sa monopolisation par la famille Assad dans les années 1970, qui donne naissance à un mouvement de communautarisme. Beaucoup de chrétiens syriens vont alors émigrer face à l’ampleur que prend le parti Baas dans le pays.
Lorsque les révoltes éclatent en Syrie en 2011, les chrétiens vont se retrouver dans une situation délicate. On observe une instrumentalisation des identités communautaires (pseudo-alliance entre alaouites et chrétiens face à la majorité sunnite), laquelle cache en fait des enjeux de puissance qui n’ont rien à voir avec la religion, comme le rappelle l’auteur, mais qui consacrent un affrontement géopolitique majeur dans la région. Les chrétiens payent de plus en plus le prix d’une discrimination qui n’existait pas auparavant. George Corm préconise un plus grand rapprochement de toutes les Églises du Levant, et des Églises arabes en général, avec les Églises européennes et américaines. Il faudrait faire de la diversité ethnique et religieuse au Proche-Orient un rempart et une force face au fanatisme religieux, et ne plus laisser des puissances régionales ou internationales instrumentaliser cette diversité à des fins « profanes », géopolitiques. Avec le déclin de la présence chrétienne au Levant et en Syrie notamment, c’est ce pluralisme ethnique et religieux qui est en péril.
Le second article, intitulé « Le malaise de l’identité brisée : Epreuves et traumatismes de l’inconscient arabe collectif », a été rédigé par Mouchir Aoun, philosophe franco-libanais et professeur d’histoire de la philosophie allemande et d’herméneutique à l’Université libanaise de Beyrouth.
Cet article s’inscrit dans la continuité de son étude « Le réveil identitaire arabe et le destin du christianisme oriental contemporain » parue dans le premier numéro de la revue, et esquisse « les grandes lignes d’une réflexion critique sur la condition d’existence individuelle et collective des chrétiens d’Orient ». Selon Mouchir Aoun, les chrétiens sont dans une situation de non-transparence vis-à-vis de leur propre histoire. Ils seraient victimes d’une certaine schizophrénie, d’une ambiguïté identitaire structurelle, tiraillés entre l’arabité, au sens ethnique et culturel du terme, et le christianisme dans ses différentes formes d’expression culturelle. Lorsque l’islam s’est répandu dans la péninsule arabique, l’arabité est apparue comme le vecteur exclusif de cette religion naissante, et les chrétiens savaient alors qu’une assimilation à l’arabité entraînerait une « confrontation » avec l’islam. L’auteur explique que les chances de réussite de la « greffe » du christianisme arabe dépendent des capacités de l’islam à s’ouvrir à cela. Même si un dialogue entre les élites existe, les relations entre islam et christianisme dans la région ont souvent été conflictuelles. Selon l’auteur, les chrétiens sont aujourd’hui « au seuil de la phase ultime de leur survie dans le monde arabe » : ils leur faut dénoncer un islam intégriste dont ils pâtissent, et ils doivent s’impliquer pleinement dans le redressement du monde arabe, mais ils ne peuvent le faire seuls.
La déception ressentie par les chrétiens s’explique d’une part par une islamisation massive en Orient, et d’autre part par la colonisation par l’Occident, tout au long de l’histoire, alors même que l’Occident ignore la cause des communautés chrétiennes orientales, aujourd’hui sur le déclin. Durant la colonisation, ces minorités chrétiennes furent un prétexte d’ingérence, et les musulmans ont vu en elles des alliés de l’Occident, ce qui aurait développé une sorte de « paranoïa collective » et de complexe d’infériorité démographique chez les chrétiens d’Orient. Ils savent que leur sort dépend de ce que le monde arabe fera de la modernité, qui semble être leur voie de salut, mais les sociétés arabes se trouvent aujourd’hui aux prises avec le fanatisme religieux. Les chrétiens se doivent de promouvoir un esprit d’ouverture et de communion multiconfessionnelle, mais ils craignent de se heurter à une majorité intolérante, et de disparaître. Ils aspirent à la modernité, mais appréhendent de s’y aventurer seuls, leur seul espoir étant une nouvelle ère de promotion de la cause de l’homme arabe libre.
Les chrétiens se sentent dépendants des intérêts géopolitiques des grandes puissances, et voient leur destin scellé dans un monde arabe qu’ils ont pourtant défendu. Souvent propulsés hors de la sphère politique, ils savent que leur présence relève parfois du miracle. Pourtant, l’auteur refuse de conclure sur une disparition certaine des chrétiens d’Orient, même si leur survie dépend de la dynamique visible et invisible des agents qui participent à la reconfiguration du monde arabe.
« L’avenir de la présence chrétienne au Moyen-Orient : une perspective œcuménique » est le troisième article de l’ouvrage, écrit par Gabriel Hachem. Ce prêtre grec-melkite catholique, professeur d’ecclésiologie et d’œcuménisme à l’Université Saint-Esprit de Kaslik, au Liban, insiste sur la nécessité de l’œcuménisme dans la région, et illustre ses propos par l’expérience du Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO).
L’auteur part de trois remarques pour asseoir son raisonnement : il faut prendre en compte les relations entre toutes les communautés chrétiennes ; la présence juive et musulmane dans la région place les chrétiens face au défi de la pluralité ; enfin, les événements au Moyen-Orient ne sont pas dirigés contre eux, mais ils en subissent les conséquences. Le CEMO regroupe toutes les familles de chrétiens orientaux, et a permis de promouvoir l’esprit œcuménique dans la région. De l’Empire Ottoman à l’application de la sharia dans certains pays, beaucoup de chrétiens d’Orient ont été poussés à l’émigration, ce qui a considérablement diminué leur nombre dans la région.
Gabriel Hachem rappelle l’actualité de la présence chrétienne et ses défis dans le monde arabe, qu’il analyse selon trois axes. Il aborde dans un premier axe la situation des chrétiens dans les pays musulmans du Golfe, où les chrétiens sont souvent étrangers au monde arabe, venant de pays asiatiques, européens ou américains. Souvent privés de service pastoral, ils ne peuvent pas pratiquer leur religion en public. Selon l’auteur, la reconnaissance de la liberté religieuse dans ces pays devient une nécessité. Dans le deuxième axe, la région du croissant fertile est analysée, excepté au Liban. Les chrétiens sont une minorité, mais ils peuvent exercer leur foi librement, même s’ils sont parfois soumis à certaines restrictions concernant les métiers de l’armée et la fonction publique. Dans les pays concernés, les chrétiens, souvent très attachés à leur patrie, nouent des liens solides avec les musulmans et les juifs et il faut souligner que la cohésion sociale qui existe aujourd’hui entre les trois monothéismes dans cette région est unique au monde. A l’origine de courants politiques, les chrétiens ont joué un rôle important dans les réformes culturelles, sociales et politiques, et ils doivent perpétuer cet effort d’enracinement.
L’auteur s’arrête ensuite sur dans son troisième axe sur le cas particulier du Liban, où la coexistence entre chrétiens et musulmans est sans équivalent et où les chrétiens sont des partenaires nationaux, même si cette cohésion nationale peut paraître ébranlée depuis la guerre civile. Le système confessionnel en place, qui autorise les chefs religieux à entrer en politique, permet de rassurer les fidèles de chaque communauté, mais selon l’auteur il faudrait dépasser cet esprit purement confessionnel au profit d’une procédure plus démocratique. Le CEMO permet de créer un lien entre tous ces chrétiens, et une relation entre les représentants régionaux et nationaux, mais n’ayant pas été suffisamment utilisé comme intermédiaire entre les Églises, il connaît une crise depuis quelque temps. Pourtant, l’auteur rappelle que l’avenir des chrétiens dans la région tient à l’existence d’une vision œcuménique, qui devrait être portée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient chargé d’assurer la communion entre les Églises locales, lesquelles incluent toutes les catégories de la population. Gabriel Hachem prône également une communion au niveau international, telle qu’amorcée avec la création du Forum chrétien mondial à laquelle une délégation moyen-orientale a participé. Le dialogue interreligieux devrait également jouer un rôle plus important dans cette région du monde, où le fondement abrahamique des trois monothéismes rend leur cohabitation exceptionnelle et leur forge un avenir commun malgré les obstacles. Les Conseils d’Églises seraient la clé de l’avenir des chrétiens dans cette région, et l’auteur ajoute que pour les renforcer, il conviendrait d’y intégrer davantage de laïcs, de jeunes et de femmes.
Le quatrième article s’intitule « Les chrétiens orientaux et l’Occident ». Il est écrit par Bernard Heyberger, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et à l’Ecole pratique des Hautes Etudes en sciences religieuses.
Ces relations entre chrétiens d’Orient et Occident qui reposeraient beaucoup sur le rapport à la modernité, sont décrites par l’auteur dans une étude qui appuie les influences de l’Occident sur l’identité chrétienne orientale. En Orient, les chrétiens sont souvent les premiers à avoir été au contact de l’Occident, et même si leur culture orientale n’a pas été effacée, on leur reproche parfois d’être « occidentalisés ». Pourtant, les chrétiens partagent souvent les discours antioccidentaux que peuvent tenir leurs compatriotes musulmans. La relation à l’Occident remonte au XVIème siècle, où la papauté a sollicité les Eglises orientales. Suite à cela, beaucoup de chrétiens sont allés étudier dans les grandes universités italiennes, et au fil du temps une immigration chrétienne orientale s’est formée à travers l’Europe, Paris devenant la capitale des opposants politiques au sultan ottoman à la fin du XIXème siècle. Ces intellectuels joueront un rôle important dans la diffusion de la culture occidentale en Orient et du nationalisme arabe.
Depuis le XVIIIème siècle, les puissances européennes prennent en charge la protection des chrétiens d’Orient, comme la France le fera en envoyant un corps expéditionnaire afin d’assurer la protection des chrétiens ottomans. Une francophonie et une francophilie se développe et aboutira à un mandat français au Liban et en Syrie à la fin du premier conflit mondial. Très tôt, les Occidentaux ont ressenti le besoin de connaître et découvrir l’Orient, et les chrétiens orientaux installés en Occident sont de précieux intermédiaires dans ces recherches. Beaucoup de documents arabes ont servi à la culture (philosophie, mathématiques…), mais on découvre aussi qu’il y a un lien très fort entre la langue arabe et l’islam, ce qui pose une question d’identité aussi aux chrétiens. La civilisation occidentale et la civilisation arabo-islamique sont souvent mises en opposition comme un rapport entre modernité et tradition, qui n’apparaissait pas impossible auparavant. Pourtant, cette question de la modernité se pose très tôt aux chrétiens d’Orient en contact avec l’Occident et ceux-ci ont cherché des compromis entre la modernité et leurs traditions, ce qui provoqua des conflits comme au niveau de la pratique des rites religieux par exemple.
A partir de 1860, une « conscience critique d’une identité orientale » se répand avec l’idée que tout n’est pas positif ou négatif dans l’Occident et qu’il faut savoir faire un choix. Cette identité se renforce avec des intellectuels qui rappellent les caractéristiques de l’Orient, les valeurs arabes sur lesquelles il faut se développer. Ce qui apparaît paradoxal est que ces intellectuels se basent sur des écrits occidentaux pour appuyer leur propos propres à l’Orient, tels que les travaux de Gustave Le Bon, qui avait l’idée que les peuples ont un caractère propre à leur « race ». Les chrétiens ont participé à la lutte pour l’indépendance des pays de la région, et ont souvent exprimer la volonté de s’émanciper de Rome et de l’Occident, pour s’enraciner dans les sociétés arabes.
Le malaise qui existe actuellement au Proche Orient ne les pousse pas non plus à se rapprocher de l’Occident, et beaucoup de chrétiens d’Orient ne comprennent pas la politique menée par les puissances occidentales en ce qui concerne le conflit en Syrie. Selon l’auteur, les chrétiens d’Orient seraient finalement plus proches des musulmans que des chrétiens d’Occident : au fondamentalisme religieux, ils répondent par un fondamentalisme également, et ne comprennent pas forcément la politique européenne en matière de religions et de minorités. Au temps de la colonisation, les Européens ont appris à s’adapter aux sociétés qu’ils dominaient et à les connaître. Réciproquement, dominés ne sont pas restés passifs, et ont répondu parfois sous forme de mimétisme. Admettre ces relations entre Orient et Occident pourraient permettre selon l’auteur un débat plus serein entre les deux entités.
Michel Younes, franco-libanais, professeur de théologie et directeur du Centre d’Etudes des Cultures des Religions de l’Université catholique de Lyon, signe un article intitulé « La vocation des chrétiens d’Orient dans leur rapport à l’islam et aux musulmans ».
La situation actuelle au Proche-Orient place les chrétiens au cœur d’un certain nombre de débats et d’enjeux. Ayant autrefois le statut de minorité, gage de stabilité, ils sont aujourd’hui quelquefois assimilés à des « étrangers », dans un contexte de fanatisme religieux grandissant, et cela a poussé beaucoup d’entre eux à émigrer. L’auteur, s’interrogeant sur la vocation des chrétiens dans leur rapport à l’islam, cherche à savoir ce qui permettrait de rompre le repli sur soi des chrétiens, et se demande si l’appui des chrétiens d’Occident ou des chrétiens d’Orient vivant en Occident ne pourrait pas transformer le rapport entre chrétiens et musulmans.
Pour répondre à ces questions, Michel Younes procède en cinq étapes : après une relecture des événements dans un contexte marqué par « l’exaspération du fondamentalisme », il dresse un état de la situation des chrétiens d’Orient, présente les ressources dont disposent les musulmans pour lutter contre le fanatisme, puis il examine le rôle des chrétiens à partir de leur ancrage historique et de leur vocation théologique, enfin il définit les conditions qui permettraient de conjuguer une réforme interne chez les musulmans et l’exercice de la vocation évangélique chez les chrétiens afin de garantir leur vivre-ensemble. L’auteur relève que le fondamentalisme religieux touche quasiment toutes les régions marquées par l’islam, en quête d’identité, depuis les années 1990. Il rappelle les signes avant-coureurs observés tout au long du XXème siècle dans la région, comme la création des Frères musulmans, l’avènement du parti Baas, la création de l’Etat d’Israël, le choc pétrolier, la révolution iranienne, etc. Dans la région, le nombre de musulmans a considérablement augmenté, alors même que la proportion des chrétiens a diminué, même si leur nombre a quelque peu progressé. Dans tous les pays, les chrétiens ont à un moment ou à un autre pris position dans la vie politique aux côtés des musulmans, et aujourd’hui, la montée de l’islam politique (sauf en Terre Sainte) les inquiète. Selon l’auteur, ni les chrétiens, ni l’action politique de l’Occident ne peuvent à eux seuls endiguer l’islamisme : c’est aux musulmans eux-mêmes qu’il revient d’y faire face, en puisant dans leurs ressources. Pour Michel Younes, la clé de la lutte contre ce fondamentalisme réside dans la diversité interne à l’islam, qu’elle concerne l’interprétation du Coran, les approches juridiques ou les positions vis-à-vis des autres religions, car toutes les lectures ne sont pas aussi rigoristes. L’islam est aujourd’hui en proie à des tensions internes et il pourrait bénéficier de l’expérience d’altérité propre à la tradition chrétienne, l’œcuménisme ayant permis la reconnaissance d’une diversité interne. Les musulmans ont recherché l’unité avec la vision de l’Oumma, mais pour l’auteur, cette unité paraît illusoire. L’expérience des chrétiens d’Orient ayant vécu en Occident peut également être un levier pour l’islam et les musulmans, et un soutien pour les chrétiens d’Orient. Leur engagement permettrait de faire obstacle au « fanatisme religieux rigide et exclusiviste », qui est une menace pour tous.
Selon Michel Younes, une réalité nouvelle est possible, pour autant que chrétiens et musulmans se mobilisent, et à deux conditions : l’une politique, le partage du pouvoir, signe d’égalité citoyenne ; l’autre éducative, l’éducation à la différence étant fondamentale. L’auteur voit par exemple dans la fête islamo-chrétienne de l’Annonciation célébrée chaque année au Liban un signe d’espoir. Il conclut en rappelant que la présence des chrétiens aux côtés des musulmans peut être porteuse de salut. En effet, malgré les crises douloureuses, ils ont vocation à vivre, pas seulement à survivre, et ils représentent un gage d’ouverture face à la montée du fondamentalisme. Partageant la même culture, ils sont la preuve que l’altérité n’est pas forcément synonyme de menace extérieure. Michel Younes conclut que si l’islam veut pouvoir assumer la modernité, les musulmans doivent prendre conscience que la survie des chrétiens d’Orient est vitale.
Le dernier article intitulé « Lecture du statut des chrétiens sous le régime islamique » est écrit par Georges Massouh, prêtre grec-orthodoxe et directeur du Centre d’études islamo-chrétiennes à l’Université de Balamand à Tripoli, au Liban. L’auteur livre une étude de la notion de citoyenneté dans un État islamique ainsi que des relations entre islam et nationalismes arabes, en se fondant sur de nombreux exemples d’écrits de penseurs islamistes.
Dans les sociétés musulmanes, la citoyenneté a toujours été l’objet de débats. La dhimmitude, c’est-à-dire le statut de ceux qui sont protégés par l’État islamique, trouve son origine dans le verset du Coran de la gizya, qui signifie la soumission des non-musulmans à la Loi islamique. Après la chute de l’Empire ottoman, la fin du califat islamique, et l’apparition de l’État national, certains penseurs religieux ont admis l’idée de citoyenneté, se montrant favorables à ce que chrétiens et juifs soient considérés comme des citoyens. Mustafa Mashhur, Guide Suprême des Frères musulmans, affirme que tout musulman ou chrétien est « fils de la patrie », et doit avoir les mêmes chances d’accession aux fonctions publiques. Pourtant, cette citoyenneté apparaît limitée, notamment lorsqu’il s’agit des postes politiques et administratifs auxquels peuvent accéder les non-musulmans dans un État islamique. En réalité, les « ministères de plein pouvoir », qui marquent directement l’identité et la nature islamique de l’État, sont le plus souvent réservés aux musulmans. Fadlullah par exemple, s’exprimant sur le statut des chrétiens dans un potentiel État islamique au Liban, précise que les postes miliaires et législatifs ne seraient pas ouverts aux chrétiens, incapables de légiférer sur la Loi islamique. C’est donc une citoyenneté tronquée qui se dessine. La notion de nationalisme fait également débat, notamment en ce qui concerne la relation à l’islam et la place des chrétiens. Pour l’Égyptien Youssouf al-Qaradi, les musulmans ne doivent pas se concentrer sur le lien patriotique et le sentiment national, mais sur la religion. Le panarabisme est toléré dans sa doctrine, mais seulement comme une étape permettant d’arriver à une unité islamique in fine. Al-Ghazali pour sa part dénonce le nationalisme comme un produit du colonialisme occidental qui rappellerait les croisades, et si sentiments nationalistes il y a, ils ne peuvent pas être dissociés de l’islam et de la Loi islamique. Pour Sa’id Hawwa, Syrien leader des Frères musulmans dans les années 1970-80, les non-musulmans doivent s’adapter, car les musulmans n’abandonneront jamais l’islam. Tout ce qui touche à l’État moderne, c’est-à-dire la citoyenneté, la démocratie, est rejeté, et les islamistes voient dans la violence un moyen d’éradiquer ces principes « anti-islamiques », comme l’affirme Sayyid Qutb. Certains reviennent sur la notion même de « citoyenneté », en la rejetant comme impossible car « les gens du livre » et les musulmans ne seraient pas égaux.
L’unité nationale serait un moyen pour les autres religions, et notamment les chrétiens dans le cas de l’Orient, d’accéder à une égalité citoyenne avec les musulmans. On voit cette tension actuellement à l’œuvre dans la pensée islamique, tiraillée entre la mise en place de la Sharia et l’adoption d’un État constitutionnel et démocratique. Les réponses islamistes, modérées ou extrémistes, mettent en relief les ambiguïtés propres à cette problématique, même dans les pays où certains défendent la citoyenneté et l’égalité. L’Égyptien d’origine néerlandaise Christian van Nisspen soulève un autre point important : dans les pays où les musulmans sont majoritaires, ils ont le droit d’appliquer le programme qu’ils souhaitent, comme le fait un parti majoritaire dans n’importe quel régime démocratique. L’auteur conclut donc sur la singularité de la question de la citoyenneté dans la pensée islamiste et sur les aspects contradictoires qu’elle peut y revêtir.
Cet ouvrage collectif apporte un éclairage instructif sur la situation des chrétiens en Orient. Les auteurs abordent cette problématique en la replaçant dans son contexte historique, théorique, théologique et politique. Bien que minoritaires dans les pays musulmans, les chrétiens sont une pièce importante sur l’échiquier des conflits et des enjeux qui agitent actuellement le monde arabe.
[1] Jean Corbon, L’Église des Arabes, Éditions du Cerf, Paris, 2007.
Article paru dans Acta Orientalia Belgica, XXVII, 2014, p. 87-95
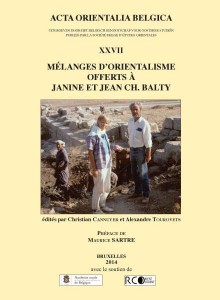
La critique de l’orientalisme par Edward Said
et la théologie contextuelle arabe dans son modèle libanais
Introduction
La comparaison entre la thèse de Said sur l’orientalisme et la pensée théologique contextuelle arabe dans sa version libanaise n’a jamais été effectuée. Pourtant, un grand nombre d’éléments plaide en faveur d’un grand rapprochement entre ces deux mondes qui abordent des questions similaires, mais à partir de disciplines différentes. Si Said s’appuie principalement sur la littérature pour démontrer ses thèses, mais aussi sur des analyses politiques d’actualité, des théologiens libanais fondent leurs démonstrations sur des éléments théologiques et religieux, tout en se versant, eux aussi, sur la chose politique. La cause palestinienne est sans doute le point commun par excellence, mais il est intéressant de constater que des réflexions théologiques sur l’œcuménisme peuvent aussi rejoindre la pensée de Said.
Qu’est-ce que la théologie contextuelle arabe dans son modèle libanais ?
Il s’agit d’une réflexion théologique locale qui se fait au Liban depuis les années 1970. Celle-ci rejoint dans sa logique les mouvements de théologies contextuelles mondiaux, et s’appuie, pour élaborer sa réflexion, sur le contexte libanais et arabe qu’elle considère comme un lieu théologique qui s’ajoute à l’Écriture et aux traditions ecclésiales. La théologie contextuelle libanaise repose sur les éléments suivants : le dialogue islamo-chrétien, l’œcuménisme, la réforme et le renouveau des Églises et de la théologie, ainsi que la théologie politique (arabité, cause palestinienne, sionisme, laïcité, confessionnalisme). C’est à partir de ces lieux théologiques que le rapprochement avec la pensée de Said sur l’orientalisme s’effectuera. Quant aux théologiens sur les travaux desquels ce travail s’appuiera, il s’agit de : Georges Khodr (1923 -), Youakim Moubarac (1924 – 1995), Michel Hayek (1928 – 2005), Jean Corbon (1924 – 2001), Mouchir Aoun (1964 -)[1].
Rappel de la thèse de Said
Il ne s’agit aucunement d’évoquer en ce lieu toute la critique saidienne de l’orientalisme ni d’évaluer sa réflexion dans sa globalité. Cela est un sujet qui fait actuellement tradition et qui est peut-être, à bien des égards, épuisé. L’important pour cette étude consiste à rappeler l’essentiel de la thèse de Said ainsi que les éléments qui convergent avec les données essentielles de la théologie contextuelle libanaise.
Said définit l’orientalisme de diverses manières. Retenons les trois sens principaux qu’il lui donna. Premier sens : « Est orientaliste toute personne qui enseigne, écrit ou fait des recherches sur l’Orient en général ou dans tel domaine particulier – cela vaut aussi bien pour l’ethnologue que pour le sociologue, l’historien, le philologue –, et sa discipline est appelée orientalisme[2]. » Deuxième sens : « Style de pensée fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre ‘‘l’Orient’’ et (le plus souvent) ‘‘l’Occident’’[3]. » C’est toutefois le troisième sens qui intéresse le plus cette recherche, et qui est d’ailleurs au centre de la thèse de Said : « L’orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d’autorité sur l’Orient[4]. » Son but est de « montrer que la culture européenne s’est renforcée et a précisé son identité en se démarquant d’un Orient qu’elle prenait comme une forme d’elle-même inférieure et refoulée[5]. » Cet orientalisme qui est donc domination de l’Occident sur l’Orient changea de main à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale : « Du début du dix-neuvième siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l’Angleterre ont dominé l’Orient et l’orientalisme ; depuis la guerre, l’Amérique a dominé l’Orient et l’aborde comme l’ont fait auparavant la France et l’Angleterre[6]. »
La réflexion de Said autour de l’orientalisme relève de la démythologisation. Celui-ci paraît effectivement comme une création culturelle et politique de l’Occident qui n’a rien à voir avec « l’Orient réel ». La suite de cet article examinera les lieux de convergence de l’orientalisme Saidien avec la théologie contextuelle libanaise.
Une domination politique et culturelle de l’Orient par l’Occident.
L’orientalisme est, selon Said, « une espèce de projection de l’Occident sur l’Orient et de volonté de le gouverner », ayant comme source l’orientaliste qui « est, à ses propres yeux, un héros qui sauve l’Orient de l’obscurité, de l’aliénation et de l’étrangeté qu’il a lui-même convenablement perçues »[7]. La religion fut jadis l’un des véhicules majeurs de ce processus, à travers les institutions missionnaires. Bien que celles-ci eussent contribué largement à bien des épanouissements dans la région (imprimeries, éducation et œuvres sanitaires), « du fait de leur caractère spécifiquement impérial, et parce qu’elles étaient soutenues par le gouvernement des États-Unis, ces institutions n’étaient pas différentes de leurs symétriques anglaises et françaises en Orient »[8].
La théologie contextuelle libanaise évoque ce genre de domination qui se traduit, selon ses perspectives théologiques et ecclésiales par le mouvement uniate évalué à partir des appartenances communautaires des théologiens.
S’agissant des orthodoxes ils le perçoivent d’un très mauvais œil. Khodr est leur porte parole à cet égard : « Il faudrait que Rome opérât un changement majeur dans son comportement avec les Églises orientales pour que celles-ci soient convaincues que la douceur des discours œcuméniques n’est pas une autre façade de l’hégémonie romaine »[9], ou en d’autres termes, un projet de la domination de l’ecclésiologie orientale par une occidentale qui est contraire à la tradition de l’Église en Orient. Le théologien en arrive à parler d’une « invasion catholique » des territoires orthodoxes, même jusqu’en Europe. Cela relève selon lui d’un prosélytisme catholique qui s’effectue sur un territoire patriarcal qui n’est pas du ressort de Rome.
Du côté catholique, les positionnements sur la question ne sont pas forcément plus doux. Jean Corbon, théologien grec-catholique, évoque ce même problème dans son projet d’une Église des Arabes[10]. Il y qualifie les Églises latine et protestantes présentes en Orient de racines adventices, et considère qu’il leur appartient de ne plus y agir pour appuyer leurs propres intérêts, mais pour aider les Églises locales à retrouver leur unité. Quant aux Églises uniates, produits de l’activité missionnaire occidentale, il leur appartient de régulariser leur situation avec leurs Églises mères.
Enfin, Youakim Moubarac, le théologien maronite, prônait le projet d’un synode antiochien qui eût été une éventuelle solution au problème œcuménique au Proche-Orient. Pour que celui-ci fût possible, il faudrait que l’Église maronite prît des distances avec la bureaucratie vaticane, en d’autres termes, avec une certaine forme d’hégémonie ecclésiale occidentale qui compromet, peu ou prou, l’identité orientale de l’Église maronite.
Une dépréciation de la langue arabe
Edward Said considère que « toute l’histoire de l’orientalisme montre qu’il s’est employé à faire, d’insinuations et d’hypothèses, des ‘‘vérités’’ indiscutables. La plus indiscutable et la plus bizarre de ces idées (puisqu’il est difficile de croire qu’on puisse la soutenir pour n’importe quelle autre langue) est peut-être que l’arabe, en tant que langue, est une idéologie dangereuse »[11].
Dans une perspective se rapprochant de celle de Said, la langue arabe revêt une importance majeure pour la théologie contextuelle arabe, d’autant qu’elle est la constituante essentielle d’une notion centrale, celle de l’arabité, en tant que donnée culturelle déterminante pour l’identité de la région.
À l’encontre d’une vision dépréciative et idéologique de la langue arabe, Moubarac considère l’arabité comme une notion profondément humaniste se distinguant de « l’arabisme »[12] qu’il considère « mâle et non dégrossi, sans discernement et à prédominance raciste »[13]. L’arabité, est constituée de deux composantes principales, religieuse et culturelle : les chrétiens et les musulmans. Ensemble, ils doivent répondre « à un certain nombre d’injonctions majeures sur le devenir politique et social des pays de la Révélation »[14], dont : la « désionisation » de la Palestine, la libération de tout confessionnalisme chrétien et musulman, l’instauration d’une justice sociale, l’insistance sur le pluralisme, la résistance à la violence par une politique de non-violence ; enfin, souligner l’importance de la langue arabe qui est la langue culturelle de tous depuis le VIIIe siècle, sans laisser tomber les autres idiomes linguistiques. « Il revient donc à la langue arabe de devenir le véhicule privilégié de la foi et de la culture pour tous, sans refuser les apports des langues locales ou interrégionales pratiquées par telle ou telle fraction de la population[15]. »
Si pour Moubarac, en opposition à la conception que se fait l’orientalisme de la langue arabe, l’arabité est un facteur culturel et politique déterminant pour l’évolution saine de la région, Jean Corbon l’aborde selon une perspective œcuménique en la concevant comme le signe du renouveau des Églises et le motif de leur recherche de l’unité. En devenant l’Église des Arabes, les Églises antiochiennes relèvent le défi de leur rôle et de leur témoignage au Moyen-Orient, car elles ne seraient plus les Églises d’un passé prestigieux, mais celles d’un présent au sein duquel elles sont appelées à la plus grande implication. Les chrétiens jouèrent un rôle déterminant durant la Nahda (Renaissance arabe)[16], surtout pour la modernisation de la langue arabe, ce qui créa des liens étroits entre les chrétiens et l’arabité. Ainsi, « la Nahda préparait l’Église de demain : l’Église des Arabes »[17]. Que le chrétien soit d’origine culturelle syriaque ou byzantine, il est, comme le musulman, « arabe dans la complexité de ses structures et de ses valeurs »[18].
Enfin, Khodr souligne l’importance de l’arabité qui, « sans préjuger d’une solution politique, d’une forme étatique quelconque […] [est] une aire culturelle et géographique, un mouvement de rénovation auquel sont invités dans la diversité, tous les hommes qui vivent dans ce cadre, fussent-ils arabes ou non »[19]. L’arabité est une synthèse de plusieurs époques, cultures, traditions, ethnies et religions, dont la Nahda a montré l’universalité et la diversité[20].
Mais si l’islam donne à l’arabité son impulsion première, l’élément chrétien est très important pour celui-ci puisqu’il lui apporte beaucoup de richesses. Celles-ci ne concernent pas seulement les propres héritages des chrétiens ramenés à l’arabité, mais surtout leur contribution centrale pour la création du mouvement arabe moderne. Les chrétiens ont sorti l’arabité moderne de la sphère purement religieuse à la sphère politique et culturelle, et ont permis de faire la distinction entre l’islam et l’arabité. Khodr pense essentiellement à tout le mouvement de la Nahda arabe qui a montré l’universalité de l’arabité et ses aspects de diversité.
Une diabolisation de l’Arabe et de l’islam
Said décrit sans ambiguïté une vision occidentale diabolisant de l’Arabe et de l’islam. « Le cinéma et la télévision associent l’Arabe soit à la débauche, soit à une malhonnêteté sanguinaire »[21], et « l’islam en est venu à symboliser la terreur, la dévastation, le démoniaque des hordes des barbares détestés. Pour l’Europe, l’islam a été un traumatisme durable. Jusqu’à la fin du dix-septième siècle, il y a eu un ‘‘péril ottoman’’ latent dans toutes l’Europe, représentant un danger constant pour la civilisation chrétienne »[22]. Et Said d’évoquer des caricatures bien communes : « On imagine les Arabes, par exemple, comme montés sur des chameaux, terroristes, comme des débouchés au nez crochu et vénaux dont la richesse imméritée est un affront pour la vraie civilisation[23]. »
Par son insistance sur l’arabité, la théologie contextuelle libanaise rejette de facto toute diabolisation de l’Arabe et s’oppose de même à toute diabolisation de l’islam. Mieux, elle le réhabilite dans l’histoire du salut à travers différentes réflexions théologiques qui appartiennent à deux logiques, l’un relevant d’une théologie inclusive, et l’autre d’une théologie pluraliste.
Le théologien maronite Michel Hayek et Georges Khodr réhabilitent l’islam dans le cadre d’une théologie inclusive. Le premier le réhabilite dans le cadre dans le l’histoire du salut, à travers la figure d’Ismaël. Celui-ci, même dans le désert, reste l’héritier de son père, Abraham. Ainsi, les musulmans que Hayek identifie comme les descendants d’Ismaël font partie de l’histoire du salut. Cependant, leur destinée n’aboutira à son fait que lorsqu’ils rencontreront le Christ, sortie de leur désert. Quant à Khodr, il réhabilite l’islam à partir de la théologie des semences du Verbe de Justin. Celles-ci sont présentes dans toute la création et l’islam ne leur échappe pas. C’est dans cette pespective que Khodr considère que l’islam participe à la vérité de Dieu. Néanmoins, cette participation ne s’effectue que dans la mesure où cette vérité révèle le Christ, puisque Khodr cherche dans l’islam le Christ qui sommeille.
Youakim Moubarac et le philosophe Mouchir Aoun réhabilitent l’islam dans le cadre d’une théologie pluraliste. Moubarac considère l’islam comme un monothéisme authentique, sans pour autant considérer qu’il lui manque quelque chose pour aboutir à sa plénitude. Quant à Mouchir Aoun, il inscrit l’islam dans le cadre d’un dialogue interreligieux qui ne considère aucune religion comme supérieure à l’autre, puisque toutes sont comprises à partir d’une théologie pluraliste qui reconnaît l’authenticité de l’expérience spirituelle de chaque religion.
La cause palestinienne
Enfin, relevons un trait saillant de critique de Said, un élément auquel il est bien sensible, eu égard à ses origines : le sionisme et la Palestine. Said souligne la manière dont la cause palestinienne permit de détériorer l’image de l’Arabe en faveur d’Israël : « Après la guerre de 1973, les Arabes ont partout paru plus menaçants. […] L’animosité antisémite populaire est passée en douceur du juif à l’Arabe, puisque l’image est presque la même. […] On le voit comme l’élément perturbateur de l’existence d’Israël et de l’Occident, ou, sous un autre aspect de la même chose, comme un obstacle, qui a pu être surmonté, à la création de l’État d’Israël en 1948[24]. » Et Said de poursuivre son diagnostique en considérant que même en militant pour sa cause, le Palestinien est déconsidéré : « Dans sa résistance aux colonialistes étrangers, le Palestinien arabe est, ou bien un sauvage stupide, ou bien une quantité négligeable, du point de vue moral et même du point de vue existentiel[25]. »
La théologie contextuelle libanaise s’inscrit dans une opposition radicale à une telle vision, et se constitue en défenseur de la cause palestinienne, de manière à dénoncer les lectures occidentales et de s’opposer d’une manière claire au « sionisme ».
Moubarac, fervent héraut de la Palestine en Occident, estimait que le problème palestinien est central au Moyen-Orient. Il qualifiait même le Liban qu’il disait « malade de la Palestine », comme l’arme principale dans le combat du « sionisme », à travers « la concorde de toutes les croyances qui le composent, cet idéal pluraliste de l’arabité tendanciellement non violente »[26]. Par ailleurs, il insistait sur la différence entre les juifs et les sionistes en considérant le sionisme comme nuisible à la théologie et à la pensée juive : « Le sionisme qui a assassiné l’Espérance d’Israël assassine notre propre Espérance, celle d’une réconciliation judéo-arabe en Palestine, comme vous savez[27]. » Les sionistes commettent des injustices à l’égard des Palestiniens au nom d’une lecture théocratique de la Bible. De plus, ce mode d’action et de pensée exclut autrui et fonde une pensée monolithique qui rejette la diversité.
Quant à Khodr, il fut pendant plusieurs décennies l’un des farouches défenseurs de la cause palestinienne au Liban, notamment à travers un grand nombre d’articles. À des milliers d’années lumières des thèses que prête Said à l’orientalisme, Khodr considère d’abord que la cause palestinienne est essentiellement une question morale. Le chrétien ne peut pas se taire face aux atrocités qui ont lieu en Palestine, blessure au sein du monde arabe qui se trouve mis à l’épreuve, « parce que la résolution juste de ce problème est une épreuve pour la sincérité des Arabes »[28]. Enfin, le Libanais Khodr prend des positions extrêmes que l’Américo-Palestien Said n’aurait probablement pas pu prendre sans se compromettre sérieusement, puisqu’il rejette l’idée même de l’État israélien en considérant Israël comme « conçu dans le mal, et né dans le péché »[29] ; ses agissements sont injustes. Par ailleurs, il s’oppose farouchement à ce qu’il qualifie de « philosophie sioniste », au nom de ces principes d’arabité, en considérant que l’Israélien ne veut pas une égalité citoyenne avec l’Arabe : « Notre guerre avec le sionisme est une guerre contre un complexe de supériorité, de colonisation et d’expansion[30]. » Cette guerre ne touchera à sa fin que lorsque la ségrégation opérée par Israël entre juifs et Arabes finira. C’est à cet égard que Khodr parle de l’importance du modèle libanais de convivialité entre les religions. Le pays du Cèdre est une image de la vie arabe unifiée. Il faut donner cet exemple aux Israéliens et refuser de normaliser les relations avec eux s’ils n’acceptent pas une convivialité similaire entre les religions[31].
Conclusion
La lecture Saidienne de l’orientalisme fut sujette à maintes critiques. Néanmoins, force est de constater que la réflexion de Said n’est pas isolée, et qu’elle est porteuse de bien des éléments de convergence, toujours d’actualité, au sein de la pensée chrétienne contextuelle arabe, dans sa version libanaise. Celle-ci rejette, à partir d’une réflexion théologique, des modes pensée qu’elle considère erronées, et qui touchent à l’islam, à l’arabité, à la Palestine et au rapport avec l’Occident. Cependant, force est de souligner que pour cette pensée chrétienne contextuelle, l’Occident n’est pas toujours abordé sous cet angle, puisqu’il est considéré aussi, comme porteur de beaucoup d’éléments positifs qui ont participé et qui participent toujours à l’épanouissement de bien des communautés chrétiennes au Proche-Orient arabe.
[1] Pour une étude détaillée des pensées de ces théologiens consulter : Antoine Fleyfel, La théologie contextuelle arabe, modèle libanais, L’Harmattan, Paris, 2011.
[2] Edward Said, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2005, p. 14.
[9] Georges Khodr, « Autour de l’unité chrétienne » (حول الوحدة المسيحيّة), in An-Nahar, 25 avril 1998.
[10] Cf. Jean Corbon, L’Église des Arabes, Paris, Cerf, 1977.
[11] Edward Said, op. cit.., p. 345.
[12] Pour plus d’informations sur la notion d’arabisme, se référer à Mahmoud Kamel, L’Arabisme, Le Caire, L’Organisation Égyptienne Générale du Livre, 1977.
[13] Youakim Moubarac, Les Chrétiens et le monde arabe, Pentalogie Islamo-Chrétienne, Tome IV, Beyrouth, Édition du Cénacle Libanais, 1972, p. 242.
[16] Georges Corm rappelle que le mouvement de la Nahda était un effort commun des chrétiens et des musulmans : « La Nahda a présenté deux caractéristiques remarquables : une participation active des chrétiens, qui réaffirmèrent ainsi leur appartenance pleine et entière à la civilisation arabo-islamique contemporaine ; et l’émergence d’un courant réformiste religieux chez les musulmans qui vise à rénover la jurisprudence islamique, figée et rigoriste, pour l’adapter aux exigences de la modernité » (Georges Corm, Le Liban contemporain, histoire et société, Paris, La Découverte, 2005, p. 150).
[17] Jean Corbon, op. cit., p. 44.
[19] Georges Khodr, « L’arabité », in Youakim Moubarac, Palestine et arabité, Pentalogie islamo-chrétienne, Tome V, Beyrouth, éditions du Cénacle Libanais, 1972-1973, p. 186.
[20] C’est à cet égard que Khodr considère le Liban comme un exemple vivant de la diversité dans l’arabité : « Le Liban, malgré sa petite taille […] est une image de la vie arabe unifiée » (Georges Khodr, « Les arabes » (العرب), in An-Nahar, 30 mars 2002).
[21] Edward Said, op. cit.., p. 320.
[26] Youakim Moubarac, Palestine et arabité, Pentalogie islamo-chrétienne, Tome V, Beyrouth, éditions du Cénacle libanais, 1972-1973, p. 138.
[27] Youakim Moubarac, « Lettre à François Mauriac », 20 juin 1967, in Georges Corm, Youakim Moubarac, un homme d’exception, op. cit., p. 294.
[28] Georges Khodr, « Les Arabes » (العرب), in An-Nahar, 30 mars 2002.
[30] Georges Khodr, « L’homme venant de la Palestine » (الإنسان الطالع من فلسطين), in An-Nahar, 20 avril 2002.
Entretien autour de la visite du pape François en Terre sainte.
Antoine Fleyfel interviewé par la Revue diocésaine de Lille le 04.06.2014
Propos recueillis par Tiphaine de Lachaise.
Pour télécharger l’article, cliquer sur la photo :
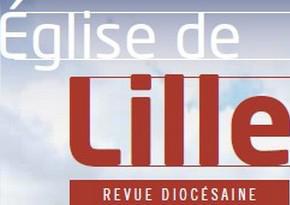
Antoine Fleyfel interviewé par Radio Vatican, 26.05.2014
Titre de l’interview : «En dehors de l’Irak, on ne peut pas parler d’un exode des chrétiens d’Orient»
Alors que le pèlerinage du Pape François en Terre Sainte arrive à sa fin, il n’est pas inutile de se poser la question du futur des chrétiens d’Orient. Doit-on craindre leur diminution inexorable ? Leur situation se pose-t-elle dans les mêmes termes que l’on soit en Irak, en Syrie, au Liban, en Egypte ou en Terre Sainte ? Nous avons posé la question à Antoine Fleyfel, théologien et philosophe franco-libanais, maître de conférences à l’Université catholique de Lille. Il a publié Géopolitique des chrétiens d’Orient (L’Harmattan 2013). Il est interrogé par Bernard Decottignies

(RV) Entretien – Alors que le pèlerinage du Pape François en Terre Sainte arrive à sa fin, il n’est pas inutile de se poser la question du futur des chrétiens d’Orient. Doit-on craindre leur diminution inexorable ? Leur situation se pose-t-elle dans les mêmes termes que l’on soit en Irak, en Syrie, au Liban, en Egypte ou en Terre Sainte ? Nous avons posé la question à Antoine Fleyfel, théologien et philosophe franco-libanais, maître de conférences à l’Université catholique de Lille. Il a publié Géopolitique des chrétiens d’Orient (L’Harmattan 2013). Il est interrogé par Bernard Decottignies :
Il y a beaucoup de crainte autour de l’avenir des chrétiens dans la région. On évoque aussi souvent les discriminations. Est-ce aussi simple ?
On parle toujours de la mort des chrétiens d’Orient, de la disparition des chrétiens d’Orient. Un chrétien d’Orient est un générique qui ne veut rien dire parce que s’il faut comprendre la situation des chrétiens de cette région, il faut aller voir dans chaque pays ce qui se passe.
L’Irak est le pays où la situation est la plus difficile pour les chrétiens de la région et c’est peut-être le seul pays où nous pouvons craindre une certaine disparition d’ici quelques années, si la situation sécuritaire ne change pas. Mais en dehors de l’Irak, loin de là, en Égypte, il y a une grande population de chrétiens, six ou sept millions qui sont loin de disparaître mais certes, ils vivent des situations que nous souhaitons largement meilleures et qui ont trait au manque de citoyenneté. C’est à ce plan que les chrétiens d’Égypte sont discriminés.
Certes, en Syrie, les chrétiens vivent aussi des situations très difficiles à cause des événements mais ils vivent des situations difficiles comme les autres Syriens. Après cette guerre, qui je l’espère va finir le plus vite possible, ils auront à rebâtir la Syrie avec les autres. Il y a des difficultés mais ces difficultés, ces chrétiens les vivent depuis plusieurs décennies, même depuis plusieurs siècles.
Selon vous, il est bon de rappeler que les chrétiens, la plupart du temps, souffrent autant que les populations locales lors de conflits, de soulèvements ou de turbulences.
Ils souffrent parfois moins que les populations locales. En Irak, pour chaque chrétien qui meurt à cause d’un acte de violence, il y a plusieurs dizaines de musulmans qui meurent à cause des actes de violence, notamment des chiites. En Syrie aussi, il ne faut pas croire que les chrétiens sont pris pour cibles. Ils l’ont peut-être été dans certaines circonstances très particulières mais la violence qu’il y a en Syrie touche tout le monde et il y a largement plus de musulmans qui sont morts. Alors qu’en Egypte, nous ne pouvons pas parler d’une telle situation puisque le pays n’est pas en guerre, même si çà et là, il y a des violences qui coûtent la vie à certains.
Concrètement, si on veut aider les chrétiens, qu’est-ce que ça veut dire ?
Du point de vue de l’Occident, une aide est possible. Premièrement, c’est certainement la solidarité morale et la prière. Et là, je parle d’un langage de foi mais l’aide peut-être aussi une aide financière, en appuyant des missions, en appuyant des institutions scolaires, des institutions humanitaires, des universités et aussi en exerçant une certaine pression auprès des pouvoirs politiques, occidentaux qui ont comme partenaires des pouvoirs politiques arabes et de faire en sorte que ces pressions occidentales poussent les partenaires arabes à respecter les minorités chrétiennes qui vivent dans leurs pays. Et ceci afin de leur garantir plus de liberté, assurer plus de droits aux minorités et plus de respect des droits de l’homme et surtout, là je rejoins l’un des points majeurs de la politique du Saint-Siège, pour la liberté de confiance qui reste l’un des problèmes majeurs qu’affronte une grande partie de ces chrétiens d’Orient.
Depuis une dizaine d’années, on s’inquiète beaucoup de l’exode des chrétiens. On peut imaginer que cet exode n’est finalement pas inexorable.
Alors, le terme exode est un peu fort. Nous pouvons penser à cette situation dramatique qu’il y a en Irak. Effectivement, en Irak, nous pouvons parler d’un exode, d’un grand départ puisque de plus d’un million de chrétiens qui existaient en Irak dans les années 90, il y en a guère plus de 300 ou 400 000 actuellement. Et je suis optimiste en avançant ces chiffres. En dehors de l’Irak, on ne peut pas parler d’un exode des chrétiens d’Orient. Il n’y a pas d’exode des chrétiens d’Orient en Égypte. Sept millions de chrétiens sont là. Certes, ils vivent une situation que nous souhaitons meilleure mais ils sont là. Il n’y a pas d’exode au Liban et il paraitrait qu’actuellement, il y a plus de musulmans qui émigrent que de chrétiens pour des raisons purement économiques.
En Syrie, on ne peut pas bien se prononcer parce qu’il y a un exode syrien. Tous les Syriens partent. Les chrétiens faisant partie de cette population, ils partent en Jordanie. On en parle pas ou presque pas parce que ça se passe très bien ou disons au moins bien. Il n’existe pas d’exode. Alors, il y a une saignée en Terre Sainte qui dure depuis plusieurs décennies. Effectivement, la démographie des chrétiens, soit en Palestine soit en Israël, atteint des proportions très petites. Presque 1% de chrétiens en Palestine et un peu plus de 2% en Israël. Mais il paraitrait aussi que cela se stabilise. C’est pour cela que je refuse de parler d’exil des chrétiens d’Orient mais je veux bien en parler lorsqu’il s’agit d’évoquer le cas de l’Irak.
Traduction arabe de l’article effectuée par le site Aleteia
ليل / أليتيا (aleteia.org/ar). مع انتهاء رحلة حج البابا فرنسيس إلى الأراضي المقدسة ، لا بد من التساؤل عن مستقبل مسيحيي الشرق. هل يجب أن نخشى تضاؤلهم المحتوم؟ هل وضعهم هو نفسه في العراق أو سوريا أو مصر أو الأراضي المقدسة؟ طرحنا السؤال على أنطوان فليفل، اللاهوتي والفيلسوف الفرنسي اللبناني، والأستاذ المحاضر في جامعة ليل الكاثوليكية، ومؤلف كتاب “الجغرافيا السياسية لمسيحيي الشرق”. ننشر في ما يلي المقابلة التي أجراها معه برنار دوكوتينيي:
هناك خشية كبيرة حيال مستقبل المسيحيين في المنطقة. كثيراً ما يتم التحدث أيضاً عن أعمال التمييز. هل الأمر بهذه البساطة؟
يتم التحدث دوماً عن موت مسيحيي الشرق، وعن زوالهم. مسيحيّ الشرق هو مصطلح عام لا يعني شيئاً لأنه في سبيل فهم وضع مسيحيي هذه المنطقة، لا بد من النظر إلى ما يحدث في كل بلد على حدة.
العراق هو البلد الذي تسود فيه أكثر الأوضاع صعوبة بالنسبة إلى مسيحيي المنطقة، وربما هو البلد الوحيد الذي يُخشى فيه زوال معين خلال السنوات القليلة المقبلة إذا لم يتغير وضعه الأمني. ولكن، بعيداً عن العراق، هناك في مصر شريحة كبيرة من السكان المسيحيين البالغ عددهم ستة أو سبعة ملايين نسمة والذين لا يُتوقع زوالهم، إلا أنهم يعيشون طبعاً في ظل ظروف نتمنى كثيراً لو كانت أفضل، وترتبط بانعدام المواطنة. على هذا المستوى، يتعرض مسيحيو مصر للتمييز.
بالطبع، في سوريا، يعيش المسيحيون أيضاً في أوضاع صعبة جداً بسبب الأحداث، وإنما شأنهم شأن السوريين الآخرين. بعد هذه الحرب التي أرجو أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، سوف يتوجب عليهم إعادة إعمار سوريا مع الآخرين. هناك صعاب لكن المسيحيين يعيشون هذه الصعاب منذ عدة عقود، وحتى منذ عدة قرون.
برأيكم، لا بد من التذكير بأن المسيحيين يعانون في أكثر الأحيان كسائر السكان المحليين خلال الصراعات أو الانتفاضات أو الاضطرابات؟
أحياناً، يعانون أقل من السكان المحليين. في العراق، يموت في أعمال العنف عشرات المسلمين، بخاصة من الشيعة، مقابل كل مسيحي يموت نتيجة عمل عنف. في سوريا أيضاً، يجب عدم الاعتقاد بأن المسيحيين مستهدفون. لربما استُهدفوا في بعض الظروف الاستثنائية جداً، لكن العنف القائم في سوريا يطال الجميع، ويسبب مقتل عدد من المسلمين يفوق عدد غيرهم من السكان. أما في مصر، فلا يمكننا التحدث عن وضع مماثل لأن البلاد لا تعيش حالة حرب، على الرغم من أعمال العنف المتفرقة التي تودي بحياة البعض.
بصورة ملموسة، ماذا عن الرغبة في مساعدة المسيحيين؟
من ناحية الغرب، المساعدة ممكنة. تحصل أولاً من خلال التضامن المعنوي والصلاة. هنا، أتحدث عن لغة الإيمان. ولكن، يمكن للمساعدة أن تكون مالية أيضاً من خلال دعم إرساليات ومؤسسات مدرسية وإنسانية وجامعات، بل أيضاً من خلال ضغط تمارسه القوى السياسية الغربية التي تجمعها شراكة بقوى سياسية عربية، والسعي لكي تدفع هذه الضغوطات الغربية الشركاء العرب إلى احترام الأقليات المسيحية المقيمة في بلدانهم. ذلك كله في سبيل ضمان المزيد من الحرية والحقوق للأقليات، والمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان. هنا، أضم بخاصة إحدى النقاط الرئيسية في سياسة الكرسي الرسولي وهي احترام حرية الضمير التي تبقى إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها شريحة كبيرة من مسيحيي الشرق هؤلاء.
منذ نحو عشر سنوات، هناك قلق شديد حيال هجرة المسيحيين. يمكننا أن نتخيل أن هذه الهجرة ليست محتومة في النهاية؟
إن مصطلح الهجرة قوي قليلاً. يمكننا التفكير بهذا الوضع المأساوي في العراق. ففي تلك البلاد، يمكننا التحدث عن هجرة، عن نزوح هائل لأنه ومن بين أكثر من مليون مسيحي كانوا في العراق في التسعينيات، لم يعد هناك حالياً أكثر من 300 أو 400 ألف. وأشعر بالتفاءل عندما أقدم هذه الأرقام. خارج العراق، لا يمكن التحدث عن هجرة لمسيحيي الشرق. ففي مصر، لا وجود لهجرة لمسيحيي الشرق إذ يوجد فيها سبعة ملايين مسيحي. من المؤكد أنهم يعيشون وضعاً نتمنى لو كان أفضل لكنهم حاضرون. ولا وجود للهجرة في لبنان حيث يبدو حالياً أن المسلمين المهاجرين هم أكثر من المسيحيين، وذلك لدواع اقتصادية بحتة.
في سوريا، لا يمكن إبداء رأينا بشكل جيد لأن هناك هجرة سورية. جميع السوريين يرحلون. والمسيحيون الذين يشكلون جزءاً من هؤلاء السكان يغادرون إلى الأردن. لا كلام عن ذلك لأن الأمور تحصل بشكل ممتاز أو أقله بشكل جيد. لا هجرة. وهناك استنزاف في الأراضي المقدسة يدوم منذ عدة عقود. فإن ديموغرافيا المسيحيين، سواء في فلسطين أم في إسرائيل، تبلغ نسباً ضئيلة جداً. تبلغ حوالي 1% في فلسطين وأكثر بقليل من 2% في إسرائيل. لكنها تستقر على ما يبدو. لهذا، أرفض التحدث عن هجرة مسيحيي الشرق، وإنما أتحدث فقط عن هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بالعراق.
Rencontre sur France Culture à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Antoine Fleyfel, Géopolitique des chrétiens d’Orient, le 25.05.2014.
Émission Foi et Tradition, présentée par Sébastien de Courtois.
Interview de Brigitte Masurel
Passer en revue la présence des chrétiens dans six contextes politiques du Proche-Orient arabe exclut tout discours supposant une unité géopolitique des “chrétiens d’Orient”. L’étude montre à quel point ceux-ci appartiennent au devenir de leur pays et vivent des situations uniques. Vont-ils disparaître comme le suggèrent certains ? Non, les “chrétiens arabes” ne sont pas en train d’écrire leur dernier chapitre en Orient et leur avenir au Machreq leur appartient toujours.
Recension du livre de Hugues PUEL, Les Souverainetés, Paris, Cerf, 2012, 286 pages, in MSR, janvier-mars, 2014, p. 78.

Les réflexions théologiques qui s’élaborent à partir d’une analyse pluridisciplinaire, incluant, en plus de l’histoire, l’économie, le droit international et la géopolitique, se font assez rares de nos temps. Dans une période mondialement tendue à cause de bien des circonstances, dont les mutations du religieux et ses tendances à des renfermements, Hugues Puel, dominicain, nous livre une analyse qui ne manque pas de prendre comme objet des instances qu’on ne critique presque plus de l’intérieur, depuis que les théologiens de la libération et bien d’autres furent tus. Rappelant son âge avancé que laisse deviner une lecture attentive de son champ d’étude, l’auteur met à notre disposition « un travail théologico-politique d’enquête sur les souverainetés et les imaginaires sociaux qui les accompagnent ». Sa démarche tente de les comprendre dans leurs relations aux questions de Dieu, du pape, de l’individu, de l’État, du peuple et de l’argent.
Cet ouvrage qui se débite en quatre parties rend compte de plusieurs périodes historiques nécessaires pour la compréhension de la lutte entre les pouvoirs religieux et séculiers, depuis la Rome antique jusqu’au concile Vatican II. L’auteur rappelle que la souveraineté « est un concept d’origine religieuse », transféré, à l’issue d’un long processus, au pouvoir politique. Cet ouvrage de valeur examine ce transfert et son application dans un monde qui ressemble désormais à un grand village bien dépendant de la techno-économie. Toutes ces mutations devraient être pour l’Église comme institution, confrontée à des difficultés, l’occasion d’une interrogation « sur les remèdes qu’elle doit envisager pour elle-même ».
Antoine Fleyfel
Université catholique de Lille
|
|