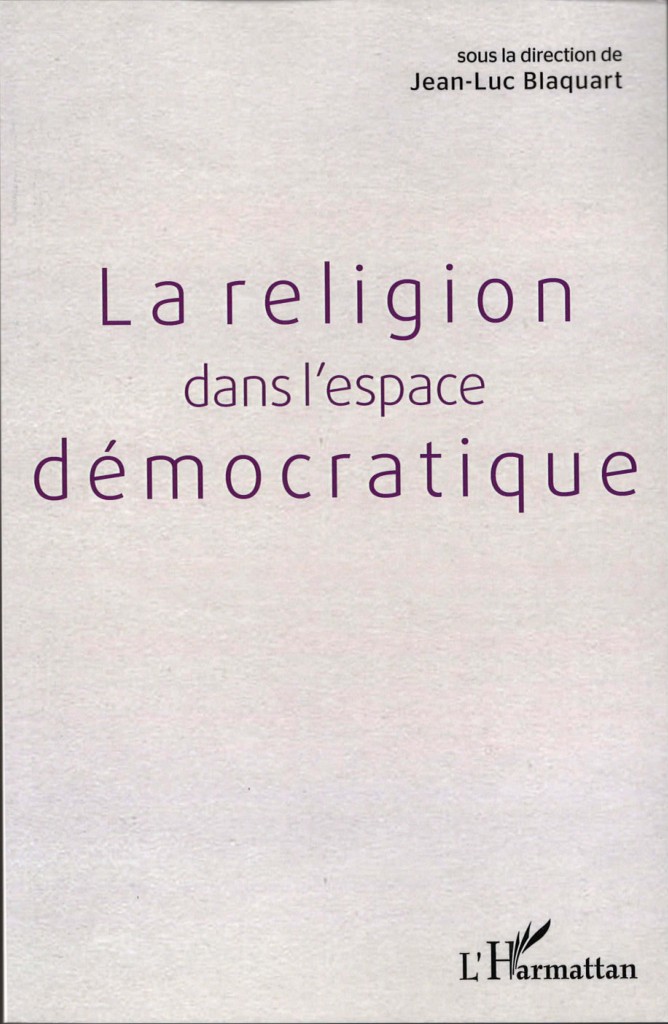Antoine Fleyfel, ”Monde arabe et démocratie, approches religieuses et anthropologiques”, in Religion dans l’espace démocratique, L’Harmattan, Paris, 2015, p. 91-107.
|
||||
|
انطوان فليفل ضيف أجراس المشرق على شاشة الميادين 2015 09 06 Antoine Fleyfel, Reconnaissance de la Palestine par le Saint Siège, France 24 arabe, 15.05.2015 Éditorial du numéro 3, 2015, de la revue universitaire de L’Œuvre d’Orient, Perspectives & Réflexions.« Le gouvernement jeune-turc n’a pu réaliser qu’en partie son plan de profiter de la Grande Guerre pour établir la turquification radicale de l’Empire ottoman. Il a toutefois réussi à détruire environ un million d’Arménien, et des centaines de milliers de Grecs, de Libanais et d’Assyro-Chaldéens[1]. »
Le troisième numéro de Perspectives & Réflexions paraît dans une année 2015 doublement difficile pour les chrétiens d’Orient : sur le plan de la mémoire, elle fait état de blessures de plus de deux millions de chrétiens qui perdirent la vie, il y a un siècle, à cause de la politique barbare et raciste des Jeunes-Turcs. Cette mémoire est à certains égards reconnue – mais pas suffisamment –, et à d’autres, oubliée ou ignorée. Un long travail reste à faire à ce sujet. Son actualité est marquée par la poursuite des violences criminelles dans le monde arabe, particulièrement en Irak et en Syrie. Des agissements atroces qui consistent à tuer au nom de Dieu, utilisant parfois de viles méthodes, détruisent ce qu’il y a de plus sacré : l’homme ! Citoyens des différents États du monde arabe, les chrétiens souffrent avec leurs partenaires de vie, sunnites, chiites, druzes, alaouites, yézidis et laïcs, des conséquences de la destruction et de la haine aveugle. L’année écoulée fut sinistre pour nombres d’Églises, notamment en Irak dans des foyers historiques comme Mossul ou Qaraqosh.
Pour faire mémoire de la funeste année 1915, mais aussi les conséquences de la Première Guerre mondiale sur les chrétiens d’Orient, nous avons choisi de consacrer cette revue à l’histoire pour rendre compte de plus d’un génocide perpétré contre les chrétiens au Proche-Orient. Sur ce plan, trois dossiers doivent être évoqués : le génocide arménien, ce que nombre de spécialistes dénomment génocide assyro-chaldéo-syriaque et la famine du Mont-Liban.
Le dossier arménien se débite en quatre articles. Il rappelle l’histoire générale de l’Arménie (M. Yévadian), traite des circonstances du génocide (M. Varoujan), met en lumière la situation de l’Église dans l’Arménie soviétique de 1920 à 1938 (P. Sukiasyan) et évoque la présence arménienne dans la Machreq (T. Yégavian). Quant au dossier assyro-chaldéo-syriaque, il est composé de trois articles. Ceux-ci étudient les circonstances de cet autre génocide méconnu de 1915 (J. Alichoran), les drames qui se succédèrent par la suite sur les communautés assyro-chaldéo-syriaques à travers exodes et exactions (J. Yacoub) et les difficultés récentes des chrétiens dans le nord de l’Irak (C. Lochon). Enfin, un dernier article traite de la grande famine du Mont-Liban (1915-1918), provoquée par le blocus ottoman et ayant coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de chrétiens.
Depuis trois ans, nous espérons dans cet éditorial des jours meilleurs pour le Moyen-Orient. Mais depuis trois ans, la situation n’a jamais été aussi meurtrière et critique. Cela ne peut être pour nous que l’occasion d’une activité encore plus intense. En dépit de la haine et de la mort, nous osons espérer, comme le dit saint Paul, contre toute espérance…
Antoine Fleyfel Rédacteur en chef
[1]André-N. Mandelstam, Le sort de l’Empire ottoman, Payot, Lausanne-Paris, 1917, p. 29. Antoine Fleyfel, invité du Journal télévisé de Fr 3 pour parler de l’affiche des chrétiens d’Orient à la RATP, 06.04.2015. La longue tragédie des chrétiens d’Orient.. Trois scénarios d’avenir et beaucoup d’incertitudes Aujourd’hui, la situation des chrétiens d’Orient est catastrophique en Syrie ou en Irak, fragile en Terre sainte, relativement préservée en Égypte ou au Liban. Comment la situation politique de ces pays va-t-elle évoluer ? L’émigration va-t-elle se poursuivre? Les experts en sont réduits à des hypothèses
Les conflits perdurent, l’émigration aussi « Des turbulences extrêmes, comme les chrétiens d’Orient n’en ont jamais connu même sous l’Empire ottoman. » C’est par ces termes que Joseph Maïla, ancien directeur de la prospective au ministère des affaires étrangères français, décrit la situation actuelle. À ses yeux, l’« ébullition » des sociétés orientales dans leur ensemble s’explique par deux raisons majeures: l’effondrement de l’État, consécutif aux « printemps arabes », et la radicalisation islamiste. En raison de la faillite de l’État-nation, les minorités sont en effet « encore plus livrées à elles-mêmes, encore plus marginalisées », voire victimes de persécutions religieuses. « Dans un contexte d’islamisation, le chrétien étouffe et, même sans persécution, il part… », ajoute Antoine Fleyfel, maître de conférences à l’Université catholique de Lille. Le risque est réel que, « dans deux ou trois générations », les chrétiens exilés « oublient leurs racines orientales », fait valoir Joseph Maïla. À l’inverse, ils pourraient aussi fournir, depuis l’étranger, « un formidable réseau d’aide et de solidarité, voire de lobbying politique ». Pour l’historien Bernard Heyberger, cette émigration pourrait également faire évoluer la présence chrétienne au Moyen-Orient, la faire passer d’un christianisme d’identité à un christianisme plus « optionnel »: « On entend parler de conversions au christianisme en Iran; on voit aussi des Églises syriaques renaître grâce à l’apport de fidèles locaux en Indonésie ou en Arabie saoudite,par l’accueil de Philippins… Bien sûr, ils ne remplaceront pas ceux qui sont partis mais eux aussi pourront dire qu’ils sont des chrétiens d’Orient… » Les conflits s’étendent, les chrétiens disparaissent Le scénario d’un Moyen-Orient à feu et à sang pour encore quelques années n’est pas à exclure. « Le pire du pire serait une quasi-disparition des chrétiens en Irak, réduits à quelques vestiges comme en Iran ou en Turquie », reconnaît Antoine Fleyfel. Le pays, qui accueillait encore 1,2 million de chrétiens avant l’invasion américaine de 2003, n’en compterait déjà plus que 300000, dont la moitié sont réfugiés dans des conditions précaires au Kurdistan irakien… La menace de Daech, qui pourrait s’élargir au Liban, à la Jordanie, à l’Égypte, paraît la plus dangereuse. « Personne ne veut plus d’interventions occidentales au Moyen-Orient. Mais cette fois encore, l’Occident doit agir parce que l’insécurité est devenue telle que les pays de la région ne maîtrisent plus la situation », prévient Antoine Fleyfel. La paix s’installe, les chrétiens reviennent La clé d’une stabilisation de la région se trouve en Syrie, estime Nael Georges, chercheur à l’université de Genève. « Il faudrait que Russie et Occident parviennent à se mettre d’accord, qu’un gouvernement d’unité nationale se constitue, que la communauté internationale accentue sa pression sur le régime de Damas pour mettre fin aux crimes contre l’humanité et permette une transition politique et une réconciliation nationale fondée sur les principes de la justice transitionnelle », considère-t-il. Alors l’élimination de Daech en serait facilitée à ses yeux, « parce que l’armée et la population lutteraient ensemble ». Plus largement, une évolution politique serait nécessaire dans l’ensemble des pays à majorité musulmane pour permettre aux chrétiens de devenir partie intégrante de la société. « Elle suppose l’affirmation d’une citoyenneté unique, et donc de l’égalité des droits, la création d’un environnement de libertés publiques reconnues et défendues par un État de droit, et enfin la reconnaissance et la préservation du pluralisme sociétal », résume Joseph Maïla. La citoyenneté et l’enracinement national prendraient alors le pas sur l’appartenance religieuse comme ciment de la société.
Anne-Bénédicte HOFFNER La Croix, 18.02.2015 Attention, nous ne sommes pas des « noun »
Suite à la prise de la ville de Mossoul par les terroristes de l’organisation dite État islamique (EI), les maisons des chrétiens de la ville furent marquées par la lettre « noun » en langue arabe « ن », abrégeant le terme « nasrani » qui se traduirait en français par « nazaréen ». Daech voulait signaler par ce signe discriminatoire et humiliant qu’elle soumettait les chrétiens au régime de dhimmitude[1], et que leurs propriétés sont désormais siennes. Par conséquent, ceux-ci ne tardèrent pas à évacuer la ville qui se trouva, pour une première fois depuis presque deux millénaires, privée de sa composante chrétienne. En signe de solidarité dans biens des endroits du monde, des chrétiens ou des sympathisants brandirent le noun discriminatoire pour dire leur refus de cette barbarie et leur désapprobation. Le symbole d’humiliation se transformait en symbole d’union et d’indignation face à l’absurde. En France, le noun prit très vite de l’ampleur, et bien au-delà des premières réactions improvisées qui l’affichèrent avec fierté, il se transforma vite en slogan pour nombre d’associations et de groupes, à telle enseigne que d’aucuns le considèrent désormais comme le « symbole des chrétiens d’Orient ». Il était tout à fait compréhensible qu’on eût utilisé le noun comme signe de protestation aux agissements de l’EI à Mossoul. Les intentions de ceux qui brandirent et qui brandissent toujours le noun sont plus que louables ; elles sont reçues avec beaucoup d’affection par les intéressés. Cet article ne voudrait point en douter, mais tout simplement, souligner l’aspect problématique de ce symbole. Plusieurs raisons invitent à le manier avec beaucoup de prudence et de recul ; je m’explique : Primo. Le christianisme oriental est incommensurablement plus riche en symboles deux fois millénaires que ce noun, piètre invention de terroristes. Que de croix ou de calligraphies, des icônes ou des fresques, syriaques, arméniennes, assyriennes, byzantines ou arabes disent d’une manière tellement profonde leur histoire et leur héritage. Sur ce plan, considérer le noun comme leur symbole est excessivement réducteur. Secundo. L’un des arguments avancés pour l’utilisation de ce noun est le sens du mot qu’il abrège, que d’aucuns traduisent avec fierté, nazaréen. Or, le terme arabe, nasrani, pouvant effectivement être traduit de la sorte, est discriminatoire pour les chrétiens d’Orient. Ceux-ci protestent depuis toujours en disant : nous ne sommes pas des nasara (pluriel de nasrani), mais des masihiyyin (chrétiens). Plus d’un théologien oriental a soulevé la différence entre les deux. Nasrani est le chrétien selon la vision musulmane, coranique. L’un deux, Georges Khodr (théologien antiochien orthodoxe), proteste en disant : « Nous ne sommes pas les nasara du Coran ». Ceux-ci auraient effectivement été hérétiques. Michel Hayek (théologien maronite) quant à lui considère que Mahomet ne rencontra aucun chrétien, mais uniquement des nasara. Tout cela eut comme résultat une mécompréhension du christianisme, puisque l’islam primitif n’en connut que des versions « hérétiques ». Ajoutons que l’utilisation de ce vocable de « nasara » évoque pour les chrétiens le régime politique musulman discriminatoire de la dhimma qui les relègue à une citoyenneté de seconde zone au sein de la cité musulmane. Ainsi, le terme nasrani répugne en général le chrétien d’Orient. Les comportements et discours de Daech et ses sœurs ne font qu’augmenter le malaise. Tertio. L’utilisation du noun est liée à un événement très particulier ayant eu lieu à Mossoul en 2014, et ayant concerné quelques milliers de chrétiens. Or, au Proche-Orient habitent presque onze millions de chrétiens, vivant des situations extrêmement diverses qui n’ont parfois rien à voir avec tout ce qu’il se passe en Irak. Les chrétiens de l’Égypte, du Liban, de Jordanie de Terre-Sainte, d’autres régions de l’Irak, et même nombre de ceux de Syrie, vivent des réalités politiques tout à fait différentes et font face à des difficultés autres, bien éloignée du danger de Daech voulant envahir leurs villes et leurs bourgs pour les réduire à la dhimmitude. Considérer le noun comme leur symbole équivaudrait à faire d’eux ce qu’ils ne sont pas. Je ne voudrais guère par cet article sommer ceux qui brandissent le noun d’arrêter de le faire ; chacun est libre et responsable de ses choix. J’appelle tout simplement à ce qu’on tienne compte des éléments susmentionnés qui vont à l’encontre de la considération de cette lettre comme le « symbole des chrétiens d’Orient ». Oui, il fallait absolument être solidaire après la prise de Mossul ; je le fus ! Mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin que le noun dans sa solidarité, en empruntant des chemins qui tiennent compte de toutes les richesses et de la profondeur des identités des chrétiens d’Orient. [1] Régime juridique musulman soumettant les chrétiens à une citoyenneté de seconde zone au sein d’un État musulman. La plupart des chrétiens d’Orient subirent ce régime (ou ses dérivées, comme les millets par exemple) pendant plus d’un millénaire. Ce n’est principalement qu’avec la fondation des États-nations dans le monde arabe, au XXe siècle, qu’il disparut. Antoine Fleyfel Décembre 2014 Recension paru sur le site des Chrétiens de la Méditerranée le 27 septembre 2014 Antoine Fleyfel, franco-libanais, docteur en théologie et en philosophie, est maître de conférences à l’Université catholique de Lille. Responsable des relations académiques à l’OEuvre d’Orient, il est rédacteur en chef de sa publication annuelle : Perspectives et réflexions. Son livre, Géopolitique des chrétiens d’Orient, est consacré à une analyse de la situation des chrétiens dans 6 pays arabes, pour chacun desquels il retrace l’histoire de leur relations avec l’Etat et la société de leur pays, la place qui leur est reconnue (ou pas) au sein des institutions, la forme que prend leur « dialogue de vie » avec l’islam, et il énonce les défis qu’ils ont à affronter. Après avoir précisé la notion de « géopolitique », prise au sens de l’espace géographique, historique, politique et culturel dans lequel les chrétiens s’inscrivent dans ces pays arabes, il consacre un premier chapitre à expliciter le terme de « chrétiens d’Orient » (équivalent pour son étude à celui de « chrétiens arabes ») et à présenter la diversité des Eglises d’Orient, dont il propose un regroupement en 7 grandes familles (cf pages 24 à 26). Bien qu’elles soient loin de constituer un ensemble homogène, ces communautés sont pour lui réunies par 3 caractéristiques essentielles : Chacun de ces chapitres constitue une passionnante étude associant un rappel des principaux évènements historiques ayant durablement façonné la situation des chrétiens dans ce pays ; une estimation de leur poids démographique et politique ; leurs rapports avec les institutions de l’Etat ; leur rôle éducatif, culturel et social ; et les enjeux actuels de leur présence et des questions auxquelles ils sont confrontés. C’est une très utile présentation du contexte historique et politique de ces pays et des relations islamo-chrétiennes qui s’y sont établies, ainsi qu’une aide précieuse à la compréhension des évènements, y compris les plus difficiles voire tragiques, auxquels ces communautés ont pu être confrontées. A noter, bien que l’écriture du livre ait été achevée à l’été 2013, le chapitre consacré à l’Irak qui s’avère particulièrement éclairant sur les causes et les étapes d’une « longue descente aux enfers qui n’en finit pas » (p. 99) et d’un « chaos sécuritaire poussant violemment et rapidement à l’exode » (p. 115) malgré les efforts des Eglises pour préserver une présence chrétienne dans ce pays. La question que pose l’auteur pour les chrétiens d’Irak (et qui peut valoir pour d’autres pays arabes) est dès lors la suivante : « Le gouvernement central et l’islam politique auront-ils le courage de relever le défi du pluralisme, de la citoyenneté et des droits de l’homme ? Seul ce défi peut actuellement prévaloir sur le fanatisme et le terrorisme » (p. 121). Dans la plupart des pays décrits par l’auteur cette question est d’autant plus d’actualité que la légitimité du pouvoir politique est souvent fragile, constituant ainsi une source d’insécurité et un facteur d’émigration pour les minorités (dont les chrétiens). Et par ailleurs la société dans laquelle vivent les chrétiens arabes est confrontée à l’influence croissante d’un islam radical, qui fragilise les formes historiques du dialogue interreligieux qui a pu être établi avec un islam modéré. C’est notamment le cas en Egypte, auquel l’auteur consacre un chapitre très éclairant sur les discriminations subies par les coptes et l’évolution des relations entre l’église copte et le pouvoir politique. La question de la permanence de la présence de chrétiens dans ces pays se pose donc souvent de façon aiguë, surtout lorsque, comme en Palestine, une situation économique très précaire laisse peu d’alternative à l’exil. Dans la conclusion du livre, A. Fleyfel souligne que les chrétiens d’Orient représentent « l’Autre » dans l’Orient arabe, « l’élément qui pousse à sortir de soi, qui provoque à la recherche de régimes politiques citoyens, garants de la diversité humaine et de la liberté de conscience » (p. 212). Relativement court pour un aussi vaste sujet, d’une écriture dense mais claire, cet ouvrage s’appuie sur une solide documentation complétée par de nombreuses notes de bas de page. Celles-ci fournissent de nombreuses pistes d’approfondissement (par exemple en ce qui concerne les positions des églises chrétiennes arabes sur la Palestine, ou sur l’engagement des communautés chrétiennes dans l’action éducative et sociale). Voici donc un livre qui apporte d’indispensables et passionnantes clés de compréhension historique sur les situations si diverses dans lesquelles se trouvent ces communautés chrétiennes, qu’elles soient importantes quantitativement (Egypte) ou proportionnellement à la population (Liban), ou, au contraire, devenues très minoritaires. Ce livre ouvre des pistes de réflexion très éclairantes quant à l’avenir possible de la présence et du témoignage des chrétiens sur le sol arabe. Bertrand Wallon Chrétiens de la Médierranée 27.09.2014 Important village situé au nord est du Liban, de 40 000 habitants (et ± de 100 000 réfugiés syriens), Ersal subit actuellement les débordements liés à la crise syrienne. Principalement sunnite, cette région est baignée dans un environnement chiite. Le 2 août 2014, les combattants islamistes venus de Syrie (dont la frontière est distante de quelques kilomètres seulement), appartenant au Front al-Nosra, la branche syrienne d’al-Qaïda, font une incursion dans le village. De violents combats opposent depuis cette date le Front al-Nosra à l’armée libanaise qui a repris les positions précédemment conquises par les islamistes dans le village. Ceux-ci restent positionnés dans les vastes hauteurs qui se situent sur la frontière libano-syrienne. De retour d’un séjour d’un mois au Liban, Antoine Fleyfel (professeur à l’université catholique de Lille) témoigne. Propos receuillis par Armelle Milcent Œuvre d’Orient 21.09.2014 UN PARCOURS SANS FAUTE Compte-rendu du pèlerinage du pape François en Terre-Sainte Le pèlerinage du pape François en Terre sainte, du 24 au 26 mai dernier, est un événement particulier dans une région en quête d’une paix qui se fait tellement désirer. La compréhension de cette visite, désormais traditionnelle au sein de la papauté , exige la prise en compte d’un contexte compliqué. Un contexte en perpétuelle mutation Quelques semaines après le voyage de François en Terre sainte, cet événement paraît lointain tant la situation s’est dégradée depuis. En effet, Palestiniens et Israéliens, ceux-là même que le pape avait invités au dialogue et à la paix, sont derechef en train de s’affronter dans des combats d’une violence particulièrement meurtrière, surtout à Gaza, causant la mort de bien des innocents. Plus à l’Est, l’organisation dite État islamique en Irak et au Levant (EIIL) a occupé, avec une brutalité rare, de très larges parties de l’Irak qui s’ajoutent aux régions qu’elle occupait déjà en Syrie. Ce fut pour elle l’occasion de proclamer un supposé rétablissement du califat et de se rebaptiser État islamique (EI). L’unité du pays se trouve plus que jamais compromise, d’autant plus que les Kurdes évoquent officiellement l’indépendance de leur territoire . En Syrie, les combats font toujours rage, entre l’armée qui continue à gagner du terrain et les insurgés d’une part, et les différents groupes djihadistes entre eux d’autre part. Au Liban, le supposé « rétablissement du califat » fut reçu avec une euphorie potentiellement déstabilisante par des milieux islamistes, et ont entrainé une insécurité qu’on avait presque oubliée depuis quelques mois. Tous ces problèmes politiques et sécuritaires sont parfois vécus très difficilement par des communautés chrétiennes locales, notamment en Irak et en Syrie. Un voyage en continuité avec celui de Benoît XVI, mais… Il n’y a pas de doute, le voyage de François est en continuité avec celui de Benoît XVI. On y retrouve, à travers les discours et les rencontres officiels, les traits majeurs de la politique du Saint-Siège concernant le Moyen-Orient. Ils ne sont un mystère pour personne, puisque les trois derniers papes n’ont cessé de les rappeler. Ils reposent sur les principes suivants : promouvoir l’œcuménisme et le dialogue interreligieux ; œuvrer pour la résolution du conflit israélo-palestinien à travers la solution des deux États ; insister sur le respect des principes de la Charte des droits de l’homme et plus particulièrement la liberté de conscience ; s’engager par tous les moyens possibles pour l’avenir des communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Sur le fond, François n’a rien ajouté de substantiel mais s’est inscrit dans une continuité franche avec la politique de ses prédécesseurs. Cependant, il faut relever trois éléments d’une importance considérable, indispensables pour comprendre la portée de cette visite. Comparons cette visite avec celle de Benoît XVI en 2009 : Les messages forts de la visite En Jordanie : dialogue islamo-chrétien et urgence de la paix En Palestine : reconnaissance de la cause palestinienne et invitation des présidents au Vatican En Israël : reconnaissance du droit d’Israël à exister, nécessité du dialogue interreligieux, impératif de l’œcuménisme L’insistance sur le dialogue interreligieux ne s’est pas limitée à la visite en Jordanie. François poursuivit son engagement dans ce sens en rencontrant le grand mufti de Jérusalem et les deux grands rabbins d’Israël. Aux uns et aux autres, il rappela l’appartenance commune à Abraham et insista derechef sur le message de la paix. Mais l’apothéose du voyage fut sans aucun doute la rencontre avec le patriarche œcuménique Bartholomée au Saint-Sépulcre. Cinquante ans après la rencontre du pape Paul VI avec le patriarche Athénagoras, François insista sur la réalité œcuménique qui ne constitue pas seulement une nécessité pour l’avenir des chrétiens en Orient, mais qui est une obligation ecclésiale. Ce moment fut très rare et unique, parce qu’on y vit rassemblées les plus hautes autorités des Églises chrétiennes traditionnelles. La pentarchie du premier millénaire était là, présente à travers différentes branches des familles catholiques et orthodoxes. Ainsi, Rome, Constantinople, Jérusalem, Antioche et Alexandrie étaient représentés par leurs évêques, dits pape, patriarche œcuménique ou patriarche tout court ! En ce lieu le plus sacré du christianisme, dénommé « cathédrale de la Résurrection » par les chrétiens arabes, François et Bartholomée prièrent ensemble, se prosternèrent ensemble et se tinrent l’un à côté de l’autre avec piété et humilité exprimant le désir d’en finir avec une rupture de la communion qui blesse le témoignage chrétien. Car la recherche de la communion correspond à l’une des confessions primordiale du christianisme : « Chaque fois que, dit le pape François, ayant dépassé les anciens préjugés, nous avons le courage de promouvoir de nouvelles relations fraternelles, nous confessons que le Christ est vraiment ressuscité ! ». Et c’est dans ce contexte œcuménique que le pape rappela les difficultés vécues par les chrétiens au Moyen-Orient, tout en disant des paroles qui exhortent aussi, à leur manière, à l’unité : « Quand des chrétiens de diverses confessions se trouvent à souffrir ensemble, les uns à côté des autres, et à s’entraider les uns les autres avec une charité fraternelle, se réalise un œcuménisme de la souffrance, se réalise l’œcuménisme du sang, qui possède une particulière efficacité non seulement pour les contextes dans lesquels il a lieu, mais aussi, en vertu de la communion des saints, pour toute l’Église. Ceux qui, par haine de la foi tuent et persécutent les chrétiens, ne leur demandent pas si ce sont des orthodoxes ou des catholiques. Ce sont des chrétiens. Le sang des chrétiens, c’est le même. » Conclusion Les temps forts de ce pèlerinage rappellent les engagements de la papauté mais soulignent aussi le charisme propre de François. Les événements actuels n’invalident en rien son importance et la portée des actes posés. Dussent-il rester enfouis dans le silence de la souffrance et l’espérance d’un avenir meilleur, ils sont indubitablement les fondements d’un futur que tellement de proche-orientaux espèrent… Antoine Fleyfel septembre 2014 |
||||
|
Copyright © 2025 Antoine Fleyfel - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||||