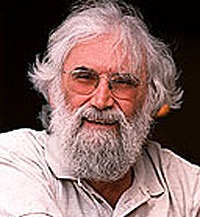|
|
Le « tsunami iraquien » au Liban. Entretien avec Michel Kassarji, évêque chaldéen de Beyrouth
Les chrétiens d’Irak y émigrent dans des conditions misérables en attendant l’obtention d’un visa qui achève leur fuite vers les États-Unis, le Canada ou l’Australie.
Loin de prendre fin avec leur exode des terres de leurs ancêtres, les douleurs des chrétiens d’Iraq prennent souvent des formes diverses avant l’achèvement du périple les déchirant de leur terre d’origine. Le Liban fait partie des États tremplin que les chrétiens d’Iraq visitent pendant quelques temps en attendant l’obtention d’un visa qui achève leur fuite vers les États-Unis, le Canada ou l’Australie. Michel Kassarji, évêque chaldéen de Beyrouth que nous avons rencontré à Paris, nous parle de la situation difficile des réfugiés chrétiens iraquiens au Liban et du rôle central que joue l’Église pour les soutenir.
– Combien de réfugiés iraquiens chrétiens existe-t-il au Liban ?
Il y a un tsunami iraquien au Liban ! Les réfugiés ont commencé à arriver en 1990 suite aux différentes guerres du Golfe, mais c’est surtout après la fin du régime de Saddam Hussein que leur exode s’est fortement accéléré. Le plus grand nombre des réfugiés chrétiens iraquiens sont chaldéens, ce qui est représentatif de leur pourcentage en Iraq où 90% des chrétiens sont chaldéens. Pour ne donner qu’un exemple : on dénombre 30 églises chaldéennes à Bagdad pour seulement 2 syriaque-catholiques. Il existe actuellement 1500 familles chaldéennes (12 000 personnes) au Liban et 75 familles syriaques – catholiques. Notre évêché a la responsabilité des familles chaldéennes.
– Quelle est leur situation humanitaire ?
La situation humanitaire de ces réfugiés est difficile, voire alarmante parfois. Lorsqu’ils arrivent au Liban, ils sont complètement délaissés, et ne peuvent pas accéder convenablement aux écoles ou aux soins médicaux, surtout que certains arrivent gravement malades. Ils vivent dans de très petits espaces, une ou deux chambres qu’ils doivent louer cher, pour y loger à dix ou douze. L’État libanais ne les aide en rien. À cela s’ajoute leur peur de se déplacer à cause de l’illégalité de leur situation puisqu’ils n’ont pas de cartes de séjour. Il y a quelques temps, 450 chaldéens étaient en prison parce qu’ils n’avaient pas de permis de séjour. Normalement, à leur arrivée au Liban, ils obtiennent un visa d’un mois à l’aéroport, renouvelable 3 fois. Mais après cela, ils se retrouvent sans papiers à cause des conditions d’obtention d’un permis de séjour, impossibles pour presque tous les réfugiés. En outre, cela n’est pas le cas en Syrie ou en Jordanie où les conditions sont complètement différentes, puisque ces deux États les prennent en charge. Au Liban, la plus grosse responsabilité repose sur l’évêché.
– En quoi consiste cette responsabilité ?
De prime abord, en tant qu’évêché, nous avons un rôle spirituel à assurer. Le grand nombre des réfugiés a rendu nos locaux insuffisants, c’est pour cela que deux communautés ont mis à notre dispositions leurs églises (les assyriens et les grec-catholiques). Cependant, loin de nous limiter au spirituel, nous assumons beaucoup de rôles humanitaires. Chaque mercredi et vendredi, l’évêché accueille les nouveaux réfugiés en leur créant des dossiers et en leur donnant des aides matérielles et des papiers de reconnaissance. Après cela, il faut les aider à trouver du travail, ce qui n’est pas facile, surtout qu’ils « travaillent au noir ». Cependant, le résultat est largement satisfaisant, puisqu’en attendant leur visa pour l’Occident, 90% de ces réfugiés trouvent un travail temporaire. Quant à la scolarisation d’enfants, l’évêché prend en charge plus de 150 élèves chaldéens. De plus, nous distribuons des aides alimentaires. Pour Pâques 2011, nous leur en avons distribué sous forme de cartons contenant 22 genres d’aliments. Il nous a fallu 120 000 $ pour financer ce projet. Cependant, ces aides sont difficiles à réaliser parce que l’évêché est pauvre et sans revenus, ce qui implique une recherche continuelle de sources de financement. L’Œuvre d’Orient nous aide tous les ans, et de manière ininterrompue. Localement, certains diocèses des différentes Églises catholiques et orthodoxes, apportent de même leur soutien financier. Trouver des fonds est capital pour nous, surtout que le projet d’édification d’un centre médico-social dont bénéficieraient surtout les chrétiens d’Irak est en cours.
– De quel centre parlez-vous ?
Les problèmes de santé vécus par certains réfugiés iraquiens et les complications qu’ils doivent affronter pour accéder au traitement sont à la source de l’idée de ce centre. Le « Centre médico-social Saint Michel », fondé par l’Église chaldéenne au Liban selon les normes internationales des centres de santé, a été inauguré en 2011. Le but de ce projet est d’aider nos frères démunis, surtout les Iraquiens réfugiés au Liban. Effectivement ce centre est ouvert à tout le monde, mais ces derniers ont de larges privilèges et leurs consultations se font à très bas prix. Par exemple, l’échographie qui coûte 100 $ normalement leur coûterait 10 $ chez nous. Le centre, toujours en construction, fonctionne actuellement de manière partielle, et accueille tous les jours presque 20 personnes. Les services médicaux qu’il assure concernent la cardiologie, la pédiatrie, les maladies digestives, l’endocrinologie, la dermatologie, l’urologie, la gynécologie, l’ophtalmologie, l’électrocardiographie, l’échographie, la physiothérapie et bien d’autres domaines. Cependant, il manque toujours des fonds pour qu’il soit complètement fonctionnel, notamment pour acheter du matériel médical nécessaire. Jusqu’au 7 août 2011, date de l’inauguration du centre, la valeur des contributions et des donations avait atteint les 1 120 000 $, et le montant restant pour compléter le projet s’élève à 680 000 $ qu’il faut trouver d’urgence. Cela est le but actuel de mon voyage en France, lever des fonds servant à l’urgence humanitaire des réfugiés iraquiens au Liban.
– Quels sont les horizons d’avenir des chrétiens d’Iraq ?
Je ne partage pas l’optimisme de certains évêques iraquiens. À mon avis, d’ici 25 ans, la situation des chrétiens d’Iraq sera semblable à celle actuelle des chrétiens de Turquie ou de la Terre Sainte, parce que les conditions de vie actuelles des chrétiens iraquiens ne permettent pas une présence durable, surtout avec l’absence d’une vision et d’une stratégie d’avenir. On a l’impression que dès qu’un chrétien naît, son but ultime est d’obtenir un passeport afin d’émigrer. La politique occidentale est partiellement responsable de cet état d’esprit, puisqu’elle encourage l’émigration, du moment qu’il faut penser à une stratégie pour rester. Dans le temps, il a été question d’acheter un grand bout de terrain au Liban pour que 3000 à 4000 familles iraquiennes chrétiennes puissent y habiter et travailler (écoles, usines, commerces). Mais les volontés politiques et ecclésiales n’ont pas convergé, et le but ultime des réfugiés iraquiens au Liban est resté d’émigrer aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Ainsi, le périple des réfugiés iraquiens au Liban va durer probablement 25 ans, le temps que tous les chrétiens d’Iraq émigrent. Chaque vague de réfugiés reste en général entre 1 et 2 ans au Liban.
– Mais qu’en est-il de la situation actuelle des chrétiens en Iraq, et est-ce qu’il y a vraiment une volonté de les exterminer ?
Des 1 400 000 chrétiens qui vivaient en Iraq, dans de bonnes conditions, sous le règne de Saddam Hussein, il reste actuellement 400 000. Quelques 100 000 vivent à Bagdad et le reste est surtout au Kurdistan. Mais la situation est différente selon les régions. À Bagdad par exemple, sur 30 églises chaldéennes, seulement 10 fonctionnent. Les autres sont désaffectées ou n’ont plus de prêtre, et parfois on n’ose tout simplement plus les ouvrir. Cependant, au Kurdistan où les chrétiens immigrent beaucoup, la situation est stable, mais je crois que c’est temporaire. Par ailleurs, il ne me semble pas qu’une volonté générale d’une extermination des chrétiens d’Iraq existe. Ce sont plutôt de petites cellules fondamentalistes qui profitent de la situation instable pour commettre des attentats.
En plus, le conflit entre sunnites et chiites en Iraq provoque une déstabilisation fortement défavorable aux chrétiens qui n’ont ni programme politique ni armes.
Antoine Feyfel
L’Œuvre d’Orient
08.12.2011
Lors de la conférence de presse organisée par l’Œuvre d’Orient et la CEF à l’occasion sa visite en France, les propos tenus par le patriarche maronite Bechara Raï ont suscité une importante polémique au Liban et des réactions contrastées tant en France qu’aux États-Unis. Son discours concernant la Syrie et le Hezbollah, remis dans son contexte, prend un tout autre sens que celui donné par les journalistes libanais accompagnant la délégation.
Antoine Fleyfel, libanais, Docteur en Théologie (Strasbourg) et en Philosophie (Paris 1 – Sorbonne) a assisté à cette conférence de presse le mercredi 7 septembre 2011 pour l’Œuvre d’Orient. Il nous résume, sans parti pris, ce que le patriarche a vraiment dit.
La visite du patriarche maronite Bechara Raï s’inscrit dans le cadre d’une ancienne tradition, consistant en ce que le président français adresse au prélat nouvellement élu une invitation officielle pour visiter la France. Cette visite met en exergue des rapports d’amitié historiques, véhicules de la francophonie au Liban qui partage avec la France des valeurs communes, comme la liberté, les droits de l’homme, la démocratie, la pluralité et l’ouverture.
Les chrétiens au Liban et au Moyen-Orient
Le patriarche a exposé la situation des chrétiens au Liban, où la communauté maronite, qui a eu une contribution significative pour la renaissance du monde arabe, joue un rôle politique important. Celui-ci dérive de la nature de la République libanaise, fondée sur un pacte oral établi entre les chrétiens et les musulmans, qui partagent le pouvoir politique à égalité, dans le cadre d’un État civil respectueux du pluralisme religieux. Cela fait exception parmi les pays du Moyen-Orient, gouvernés par des régimes théocratiques ou totalitaires.
« La guerre a été dépassée au Liban, dit le patriarche, les blessures ont été pansées. Il n’y a plus de problèmes de convivialité entre les chrétiens et les musulmans. Nous sommes en train de reconstruire notre pays ensemble ! ». Cependant, c’est au niveau politique que les choses se compliquent, puisque le « problème actuel, lié aux conjonctures régionales et internationales, se résume au Liban par un conflit entre musulmans chiites et sunnites. Par conséquent, nous vivons une crise politique au niveau du gouvernement, à cause des deux forces qui cherchent chacune à paralyser l’autre, et nous payons le prix… parce que cela crée aussi des divisions entre les chrétiens, à cause des options qu’ils ont prises en s’alliant aux sunnites ou aux chiites ».
L’Église maronite joue un rôle pour apaiser cette tension intra-chrétienne et intra-libanaise. Mgr Raï évoque les réunions mensuelles qu’il organise avec les responsables de deux camps chrétiens en vue de leur rapprochement et de la résolution de leurs problèmes communs, comme les ventes de terrain, l’absence des chrétiens de certains postes de la fonction publique, la loi électorale, etc. Par ailleurs, suite au souhait des musulmans, un sommet des responsables religieux musulmans et chrétiens s’est tenu au siège du patriarcat maronite au mois de mai. L’organisation d’un sommet islamo-chrétien moyen-oriental, qui déboucherait sur une déclaration commune de convivialité, est en cours. Cela devrait avoir des conséquences bénéfiques pour la convivialité islamo-chrétienne au Moyen-Orient, surtout en Égypte et en Iraq.
Par ailleurs, le patriarche a rappelé que les chrétiens moyen-orientaux contribuent au développement de leurs pays, mais subissent cependant des régimes théocratiques. Cela est la source du problème des chrétiens dans les pays du monde arabe, où ils sont réduits à être des citoyens de « second degré ». C’est pour cela qu’ils conçoivent le Liban comme leur espérance, parce que sa formule de convivialité constitue un espoir d’avenir.
Le printemps arabe
Les injustices au monde arabe mènent aux réclamations justes des peuples qui veulent vivre dignement : « Nous sommes avec toutes les réformes, dit le patriarche, mais nous avons exprimé nos craintes aux hautes autorités françaises », et elles sont au nombre de trois.
1. La crainte de remplacer des régimes actuels par d’autres plus durs et intégristes.
2. La crainte d’aller vers des guerres civiles de type confessionnel comme en Iraq.
3. La crainte du « fameux projet du nouveau Moyen-Orient » qui mènerait à la partition, voire à l’effritement des pays arabes en petits États confessionnels.
Concernant la Syrie, Mgr Raï rappelle les principes et les constantes de l’Église qui respecte les droits des peuples et leur liberté, qui condamne la violence et la guerre, et qui ne prend pas position en soutenant un régime ni en s’y opposant. Cependant, « nous ne nous soucions pas seulement des peuples des pays voisins… mais aussi de nos chrétiens parce que nous payons toujours le prix ». C’est dans ce cadre que le patriarche déclare : « Nous avons enduré le régime Syrien au Liban, je ne l’oublie pas. Mais M. Assad a commencé une série de réformes politiques. Il fallait lui donner plus de chances pour soutenir les réformes internes, et surtout pour éviter la violence ».
Le Hezbollah et l’appui de la France
« Le Hezbollah pose un problème à cause de ses armes qu’il dit porter pour défendre sa terre ». Pour résoudre ce problème, le patriarche maronite demande de l’aide à la France, afin d’invalider les trois arguments utilisés par le Parti de Dieu pour justifier la présence de ses armes, à savoir : a) l’occupation d’Israël d’un bout de territoire du sud libanais, b) le problème des réfugiés palestiniens armés au Liban, c) et les faibles capacités militaires de l’armée libanaise qui serait incapable de protéger le territoire national. En appliquant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies a) sur le retrait entier d’Israël du Liban, b) sur le retour des réfugiés palestiniens, c) et en armant convenablement l’armée libanaise, Mgr Raï considère qu’on éliminera les causes pour lesquelles le Hezbollah justifie le maintien de ses armes.
Enfin, Sa Béatitude Béchara Raï rappelle que le Synode des évêques pour le Moyen-Orient est un acte prophétique qui donne un élan et une poussée aux chrétiens d’Orient. Il promet de poursuivre son activité dans le sens de cet élan, en agissant sur un plan pastoral, avec les responsables politiques de la région et avec la communauté internationale.
Les schismes des Églises orientales ne cessent de surprendre par leurs subtilités. Ils perdurent dans les textes, les esprits et les espaces, mais aussi dans la pierre. Si la partition confessionnelle du Saint Sépulcre étonne le touriste non avisé, la visite de la cathédrale de saint Nicolas à Sidon (Liban) provoque la stupéfaction des croyants.

Un mur en pierre taillée jouxte la droite de l’iconostase de la cathédrale grecque orthodoxe de saint Nicolas à Sidon. Un mur, qui ne paye pas de mine, même s’il est décoré d’icônes. Il cache pourtant… la partie catholique de la cathédrale depuis longtemps abandonnée. Ce mur est ainsi le symbole puissant d’un schisme qui a donné naissance à l’Église grecque catholique en 1724. Il incarne les subtilités des divisions des Églises orientales, dans un sanctuaire qui serait la trace la plus ancienne du christianisme au Liban. Effectivement, selon la tradition, la cathédrale actuelle – datant du VIIIe siècle – aurait été bâtie sur les ruines d’une ancienne église que saint Paul aurait visitée en allant de Jérusalem à Antioche.
Une ancienne histoire
Il n’est pas facile de trouver son chemin vers l’ancienne cathédrale. Elle est située dans l’ancien souk de Sidon, encombré et non accessible aux voitures. Les entrées des deux parties de l’édifice sont séparées par plus de trente mètres de souk qu’il faut traverser ; et si l’accès au côté orthodoxe est indiqué, il est nécessaire de s’informer auprès des marchands pour connaître l’emplacement de l’entrée catholique. La cathédrale est tellement encastrée dans les habitations et les boutiques, qu’une infime partie seulement transparaît vers l’extérieur.
Les fidèles des deux communautés ont des points de vue plutôt convergents. Tous manquent d’informations précises sur les débuts de cette querelle qui leur paraît très ancienne. Mais tous espèrent que le mur disparaîtra. Georges (orthodoxe) souhaite la réalisation d’une unité véritable qui « ne dépend malheureusement pas de nous, mais des autorités ecclésiastiques. Nous souhaitons la destruction du mur comme il en a été avec celui de Berlin. Les prêtres devraient nous écouter : nous le peuple voulons la paix, l’unité, la charité, le pardon. Si cela n’en tenait qu’à nous, nous aurions dès à présent démoli le mur. Mais il y a les hiérarchies ecclésiastiques, et la question du mur ne se réduit pas à la pierre, elle évoque le dogme. Cela nous dépasse ». Joseph (catholique) va dans le même sens en disant que le mur divise la religion : « À Sidon, les chrétiens sont très peu nombreux, et la destruction du mur dont j’ignore les origines nous donnera de la force. Distinguer et séparer est un signe de fanatisme, ce que nous devons rejeter en nous unissant ».
Certains fidèles, comme Nadia rencontrée à la porte de la nouvelle cathédrale grecque catholique, ignorent l’existence d’un côté catholique dans l’ancienne cathédrale. D’autres comme Nizar, ne s’y sont jamais rendus.
Mais que s’est-il vraiment passé à cet endroit il y a presque trois siècles ? C’est en 1724 qu’éclate le conflit entre les chrétiens de la ville de Sidon, lorsque l’évêque Aftimos Saïfi et nombre de fidèles quittent l’Église orthodoxe antiochienne et rejoignent la communion catholique. La cathédrale fut le témoin principal de la querelle qui a bien duré, puisqu’elle était le seul sanctuaire disponible dans la région. Il a fallu que l’Empire ottoman intervienne pour trouver une solution à ce différend. Un décret impérial datant du 5 novembre 1819, ordonne la division de l’édifice en deux parties, un tiers pour les grecs orthodoxes et deux tiers pour les grecs catholiques, politiquement plus puissants. Ainsi, on édifie un mur qui isole le bruit et qui sépare les frères d’antan. L’architecture de l’église se trouve défigurée par cette modification, notamment l’autel qui se situait en son milieu et qui a dû être déplacé, et l’iconostase qui a dû être démolie.
En 1895, la communauté grecque catholique se déplace vers une nouvelle cathédrale – qui porte le même nom que l’ancienne ! – et qui est située à quelques centaines de mètres. Cette dernière ne suffisait plus au nombre croissant des fidèles de la communauté et ne s’utilisait que lors des grandes célébrations de l’année. Désaffecté durant plusieurs années, le côté catholique est actuellement en cours de restauration par la « fondation Hariri », dans le cadre d’un projet culturel et touristique.
Schisme ou diversité ?
Les fidèles des deux communautés trouvent que le mur est une entrave à leur témoignage chrétien, et qu’il est parfois un signe de discrimination et de manque de charité. Nancy (orthodoxe) proteste énergiquement en disant qu’il « est bien temps de détruire ce mur parce que l’unité est une nécessité. Je ne suis pas du tout fanatique, mais il y a des gens fanatiques qui nous regardent d’un œil discriminant parce que nous sommes orthodoxes. Oui, il est vrai que nous sommes très attachés à notre doctrine orthodoxe, mais il est très important que ce mur se détruise parce que le Christ n’a pas dit à ses fils : tu es maronite, tu es orthodoxe, tu es catholique ! ». Emile (catholique) dit dans le même sillage que « ce mur n’aurait jamais dû exister, parce que Dieu nous a donné l’unité, et parce que nous confessons tous le même Christ, maronites, orthodoxes et catholiques. Ce qui nous sépare n’est pas une question de foi, mais des mesures ecclésiastiques ».
C’est en s’adressant aux responsables ecclésiaux que les divergences se manifestent de manière flagrante. Fady, diacre de la cathédrale orthodoxe, rappelle que son Église considère la construction de ce mur comme un schisme. Il trouve que les initiatives sont lentes, et que la volonté de destruction du mur ne dépasse jamais le stade des paroles. Cependant, « même si cela se fait, il faut que les murs qui sont dans les cœurs soient détruits aussi, ces murs qui sont sources de faiblesse dans le témoignage ». Quant au père Joseph, curé de la cathédrale Saint Nicolas, il prend un ton plus dur que son diacre en disant : « Nous divisons cet endroit qui est supposé être le symbole de notre unité en Christ ! ». Il rappelle que plusieurs propositions ont été faites pour la disparition de ce mur, notamment celle de l’enlever et de faire de manière à ce que l’Église ne soit la propriété de personne. De la sorte les deux communautés organiseront leurs temps de prière. Il n’y a pas eu d’échos positifs à ce sujet du côté catholique. Le curé se consterne et ajoute : « Quel n’a été le choc des orthodoxes lorsqu’ils ont appris que cet endroit allait être transformé en musée ecclésial. C’est un lieu sacré dédié à la prière et non à l’exposition. C’est la première fois qu’on apprend au Liban qu’une église se transforme en musée ». Et enfin, le prêtre orthodoxe évoque les pourparlers avec le côté catholique : « À chaque fois que nous leur demandons pourquoi ce mur n’est pas détruit, nous obtenons la même réponse : il s’agit d’un symbole pour l’Église grecque catholique, parce qu’en 1724, c’est ici que tout a commencé ».
Symbole
Père Jihad, curé de la cathédrale grecque-catholique, confirme les dires de son homologue orthodoxe : « Le mur est un symbole, non seulement de séparation, mais aussi de la fondation d’une Église, il y a trois siècles ». À l’encontre de l’avis du diacre Fady, le prêtre melkite trouve qu’il n’y pas d’obstacle qui sépare les catholiques et les orthodoxes, « car ce mur nous l’avons détruit dans nos cœurs et dans nos esprits depuis longtemps ». Cependant, le mur de la cathédrale témoigne à son sens d’une époque passée dont il faudrait oublier l’aspect polémique. Mais comme histoire et archéologie, le mur « est important pour nous, parce qu’il témoigne de la fondation du premier ordre monastique des grecs catholiques ». Et le curé de dire explicitement : « Nous ne sommes pas très intéressés par la destruction du mur, et nous ne comprenons pas la division de la cathédrale en deux comme une blessure, mais comme un symbole historique et archéologique qui raconte l’histoire de la naissance de notre Église ». Père Jihad craint que la destruction du mur mène à l’oubli de cette histoire.
Récemment, l’évêque grec orthodoxe de la région, Élias Kfoury, a dit que le nouvel évêque grec catholique, Élie Haddad, lui a promis, lors de leur première réunion qui a eu lieu dans la cathédrale, de réunifier l’édifice. Haddad affirme de son côté que des pourparlers ont lieu avec Kfoury dans le but de résoudre le problème en détruisant au moins, une partie du mur. L’installation d’une porte qui s’ouvrirait durant certaines occasions ou célébrations communes est l’une des solutions qu’envisage l’évêque grec catholique.
Cet article a paru le 24.05.2011 sur le site Internet de L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Le Saint-Siège mène, sous le pontificat de Benoît XVI, une action diplomatique évidente en faveur des chrétiens d’Orient. Comprendre cette action passe par un examen de la nature de la diplomatie vaticane en général, et par un recours à certains écrits et activités pontificaux récents. La subtilité d’une telle diplomatie réside surtout dans le fait que des actes pastoraux et spirituels revêtent un caractère politique.
1- Pastorale et politique
Le pape unit en sa personne trois fonctions différentes : il est primat de l’Église catholique, monarque absolu de l’État du Vatican et évêque du Saint-Siège. Cependant, même si cette même personne jouit de ces trois pouvoirs, il est nécessaire de distinguer l’Église catholique du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican.
Si l’Église catholique est la communauté des baptisés ayant comme pasteur suprême l’évêque de Rome, le Saint-Siège est l’incarnation du pouvoir spirituel de cette Église, de la souveraineté abstraite qu’a le pape sur tous les catholiques du monde. Quant à l’État de la Cité du Vatican, créé à la suite des accords du Latran, il est le support territorial du Saint-Siège, sa représentation temporelle. Il existe pour lui assurer une indépendance réelle et visible dans son gouvernement de l’Église universelle et dans ses activités.
Cependant, ce n’est pas avec l’État du Vatican que les États entretiennent des liens diplomatiques, mais avec le Saint-Siège qui est sujet souverain de droit international, qui siège au sein de certaines organisations internationales et qui possède à l’Organisation des Nations unies (ONU) le statut d’observateur permanent. Tous les ambassadeurs des États sont accrédités près le Saint-Siège, et non auprès de l’État de la Cité du Vatican.
La négociation internationale menée par l’Église catholique est l’activité diplomatique du Saint-Siège. Toutefois, l’activité de cette diplomatie est d’une nature différente que celle des activités diplomatiques des États : les nonces apostoliques sont avant tout les représentants de l’Église catholique, le Saint-Siège n’est pas une puissance temporelle ou géopolitique, mais une puissance spirituelle et morale, et ses motivations principales sont la protection des chrétiens, notamment des catholiques, et la promotion des valeurs de la justice, de la paix et des droits de l’homme.
2- Jean Paul II, pèlerin en terre d’Orient
La cause des chrétiens d’Orient fait partie des combats majeurs du Saint-Siège. À la fin du XXe siècle, cela était évident sous le pontificat de Jean-Paul II, qui a visité la Terre Sainte, et qui a insisté sur la nécessité de trouver l’équilibre entre de bonnes relations avec les juifs et Israël (en raison surtout de l’intérêt pour les Lieux Saints), et la promotion de l’entente islamo-chrétienne (facteur incontournable pour la présence chrétienne en Orient). En outre, le pape polonais a manifesté un attachement particulier au Liban. Celui-ci avait été la cause d’un grand malaise au Vatican dans les années 1970 puisque la seule puissance catholique au Moyen-Orient, les maronites, s’étaient engagés dans une guerre qui avait pu être très facilement interprétée sous le signe de l’hostilité vis-à-vis de l’islam. Cela nuisait aux rêves de la papauté voulant faire du Liban, identifié avec l’avenir des chrétiens orientaux, un modèle de convivialité pour les autres pays de la région, et rendait les maronites impopulaires parmi les musulmans, ce qui aggravait le danger d’un islamisme montant, très dangereux aux yeux du Vatican pour l’avenir des chrétiens orientaux.
C’est dans le cadre de ces éléments historiques qu’il convient de comprendre l’Exhortation Apostolique de Jean-Paul II, « Une espérance nouvelle pour le Liban » (1997), qui considère les chrétiens du Liban comme la clef de voute et la condition sine qua non de tout redressement possible du christianisme moyen-oriental. Beaucoup d’éléments de ce document s’inscrivent d’une manière évidente dans le cadre des grands traits de la diplomatie du Saint-Siège qui seront traités derechef par Benoît XVI, à savoir : les dialogues œcuménique et interreligieux, le dialogue de vie entre les religions dans un cadre social et moral, les droits de l’homme et la liberté de conscience, le combat de l’émigration et la mise en garde contre tout extrémisme. Tout en délivrant un message essentiellement pastoral, Jean-Paul II ouvre tout un horizon politique à son activité spirituelle.
3 – De Jean Paul II à Benoît XVI, la continuité de l’engagement
Le pèlerinage en Terre Sainte (8-15 mai 2009)
Les débuts du pontificat de Benoît XVI sont marqués par des évènements qui ont été interprétés comme des erreurs diplomatiques : le discours de Ratisbonne (septembre 2006) qui a suscité de vives réactions politiques et religieuses dans le monde musulman, et la réhabilitation de l’évêque intégriste négationniste Williamson (janvier 2009) qui a heurté le monde juif.
La visite du pape en Terre Sainte (Jordanie, Territoires Palestiniens, Israël), du 8 au 15 mai 2009 est bien liée à ces deux évènements. Elle pourrait être considérée comme une clarification majeure, voire un rappel des positions du Saint-Siège aux endroits de l’islam et des musulmans, du judaïsme et des juifs. Cependant, c’est dans le cadre d’un apaisement du monde musulman et de l’État d’Israël, et d’un rappel des positions du Saint-Siège en faveur de la cause palestinienne, que le pape mène avec la plus grande prudence diplomatique un pèlerinage qui a comme but principal l’appui des chrétiens d’Orient.
Cette visite complexe qui a duré huit jours s’est effectuée dans une ambiance de tensions plus vives que celles qui existaient lors de la visite de Jean-Paul II en 2000. Même si le pape donnait à sa visite un sens spirituel, la dimension politique était inévitable : «Chaque journée, chaque geste, chaque rencontre et chaque visite : tout aura une connotation politique», disait Fouad Twal, le patriarche latin de Jérusalem.
Dans son entretien aux journalistes, accordé au cours de son vol en direction de la Terre Sainte le 8 mai 2009, Benoît XVI rappelait le caractère de l’action diplomatique du Saint-Siège, fondement de son appui pour les chrétiens d’Orient : « Je cherche certainement à contribuer à la paix non en tant qu’individu mais au nom de l’Église catholique, du Saint-Siège. Nous ne sommes pas un pouvoir politique, mais une force spirituelle et cette force spirituelle est une réalité qui peut contribuer aux progrès du processus de paix ». Et d’ajouter, afin de souligner le but essentiel de son pèlerinage : « Nous voulons surtout encourager les chrétiens en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient à rester, à apporter leur contribution dans leurs pays d’origine »[1]. C’est dans ces perspectives que trois messages politiques majeurs peuvent être relevés lors cette visite :
1- Rassurer le judaïsme et l’État d’Israël sur le fait que le Saint-Siège ne professe aucune forme d’antisémitisme et s’y oppose.
2- Tourner définitivement la page de Ratisbonne et approfondir les relations avec les musulmans.
3- Plaider en faveur de la solution des deux États.
Insister à plusieurs reprises sur ces trois positionnements politiques crée les conditions nécessaires pour appuyer les chrétiens d’Orient. Benoît XVI insistera durant ce voyage, sur leur présence en Terre Sainte, et sur les difficultés qu’affrontent ceux qui habitent toujours dans les endroits les plus sacrés du christianisme. Le Saint-Siège cherche effectivement, depuis l’établissement des liens diplomatiques avec Israël en décembre 1993, à avoir un libre accès aux Lieux Saints et la possibilité d’y agir pastoralement, sans limitations ni empêchements. De plus, le pape souligne le fait que la construction du « mur de sécurité » a causé la détérioration de la situation des chrétiens à Bethléem et aux alentours, et que l’immigration, sur fond économique, ne cesse de s’aggraver : il y a toutes les semaines des familles qui immigrent en Amérique, ce qui fait que les chrétiens représentent moins de 15% des habitants de Bethléem[2]. Face à cette situation alarmante, Benoît XVI consacre la part du lion de son voyage à consolider les communautés chrétiennes en Jordanie, dans le Territoire palestinien et en Israël. Il n’est pas question de déserter cette terre, de démissionner de la société ou de quitter le Moyen-Orient, puisque le christianisme a toujours un rôle majeur à y jouer, notamment entre les juifs et les musulmans, et un témoignage à rendre sur cette région des origines.
Le Synode pour le Moyen-Orient
Benoît XVI annonce durant son voyage à Chypre (4-6 juin 2010), qu’il « représente, sous de nombreux aspects, la continuation du voyage […] accompli l’an dernier en Terre Sainte ». Même s’il déclare ne pas venir avec un message politique, mais religieux et prônant l’ouverture à la paix, le pape rappelle le rôle diplomatique du Saint-Siège en disant : « Nous pouvons également aider à travers les conseils politiques et stratégiques, mais le travail essentiel du Vatican est toujours d’ordre religieux, touche le cœur »[3]. L’un des objectifs principaux de ce voyage est la remise de l’Instrumentum laboris du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Sans s’étendre sur les détails de ce document, soulignons les éléments qui mettent en lumière le sujet de cet article :
1- L’implication personnelle du pape pour les chrétiens d’Orient et pour le renouveau de leurs Églises.
2- L’insistance sur les dialogues œcuménique et interreligieux.
3- Le rappel que les chrétiens sont des « citoyens indigènes » qui participent à la formation de l’identité culturelle de leurs pays.
4- La proposition d’une « laïcité positive » et le rejet du repliement sur soi et de la peur.
5- La question démographique liée à l’immigration et l’encouragement des familles nombreuses.
6- La liberté de religion (culte) et de conscience (choix de religion) sont des droits humains inaliénables qui ont comme cadre idéal la société démocratique.
7- La mise en garde contre l’islamisme et la violence qu’il suppose.
8- Le rappel de la position du Saint-Siège sur la solution des deux États.
9- L’avenir du Moyen-Orient est la responsabilité commune des chrétiens et des musulmans.
10- Le chrétien pourrait avoir une contribution spéciale pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Par le dialogue, il peut jouer le rôle de pont entre les juifs et les musulmans. Malgré leur petit nombre, les chrétiens peuvent devenir une présence qui compte.
La lecture des propositions finales (Propositionum) de l’Assemblée des évêques n’ajoutent pas grand-chose à ce que dit l’Instrumentum laboris. L’essentiel de ce qui a été dit et écrit depuis 2006, en Turquie, en Jordanie, en Palestine, en Israël et à Chypre est repris, mais reformulé et contextualisé par l’Assemblée des évêques moyen-orientaux. Cependant, il est difficile de séparer le pastoral du politique, car si certaines propositions relèvent de considérations « spirituelles » pures (la parole de Dieu ou la liturgie par exemple), d’autres propositions débouchent clairement sur des questions aux horizons politiques (les droits de l’homme ou la forme de l’État). Cela souligne encore une fois la subtilité de l’action diplomatique du Saint-Siège où tout acte « spirituel » échappe difficilement à la dimension politique. En voulant encourager les chrétiens d’Orient, et en les raffermissant dans leur foi, le Saint-Siège pose forcément un acte politique majeur qui suppose au moins la résistance à l’affaiblissement des chrétiens d’Orient et leur disparition, et au plus, un redressement de ce christianisme qui fait de lui un facteur de vie indispensable dans tous les pays arabes où il existe.
Les Propositionum montrent à quel point le Synode des évêques pour le Moyen-Orient dépend de la politique internationale que le Saint-Siège pratique depuis plusieurs décennies. Celle-ci insiste surtout sur l’attachement à la terre, sur les droits de l’homme et sur les dialogues œcuménique et interreligieux.
Conclusion
Il n’y a pas de doute que le Saint-Siège joue un rôle majeur en faveur des chrétiens du Moyen-Orient. Cependant, au vu des mutations très rapides et peu favorables à ces chrétiens durant ces dernières décennies, une question fondamentale ne cesse de s’imposer à tout observateur averti de cette région du monde : est-ce que la diplomatie vaticane et les efforts des communautés locales, pourraient occasionner un véritable renouveau du christianisme oriental, ou du moins, une stabilisation de certains acquis positifs que ces communautés possèdent encore aux endroits de la culture, de la politique, de l’économie ou de la démographie ? Les années à venir seraient probablement porteuses de réponses qu’une multitude d’hommes et de femmes espèrent positives.
————————————
À quatre-vingts ans, le théologien suisse livre quelques pensées vigoureuses sur la vie en général et la foi en particulier.
Hans Küng, Faire confiance à la vie, Paris, Seuil, 2010, 346 p.
Hans Küng surprend toujours. Estampillé « rebelle » à son corps défendant, interdit d’enseigner en faculté de théologie catholique depuis 1979 à cause de ses positions audacieuses et controversées, le théologien publie un livre d’une toute autre facture que ses précédents. Faire confiance à la vie (Ce que je crois, dans sa version originale allemande) est une œuvre de maturité. L’auteur y propose, à travers nombre d’éléments autobiographiques, une spiritualité et une sagesse de la vie qui traitent de la confiance, du sens, de la souffrance, de la raison d’être, de l’art d’exister… Cet ouvrage, alliant la joie de croire à celle de vivre, s’adresse à des personnes « en recherche », insatisfaites de leur foi traditionnelle ou voulant en rendre compte d’une manière renouvelée.
Un questionnement existentiel
« Ma spiritualité se nourrit d’expériences quotidiennes… Elle est éclairée cependant par des connaissances scientifiques… ». Küng n’emprunte pas les chemins de la foi sans avoir entamé un questionnement existentiel qui concernerait croyants et athée. Les sciences humaines et exactes éclairent sa compréhension du monde et contribuent à élaborer son propre point de vue sur la vie, car « comment croire en Dieu si je ne puis m’accepter moi-même ? ». Ainsi, l’étape fondamentale d’une confiance critique et prudente est dépeinte par le théologien comme une base du vivre ensemble des humains. Ceux-ci sont invités à la joie de vivre à travers la contemplation de la nature ou l’humour, mais surtout par le biais de certains principes éthiques : la non-violence (respect de la vie), la solidarité (contre l’exploitation), la tolérance, le refus du mensonge, l’égalité. Ces normes qui devraient constituer une éthique mondialisée, trouvent leurs assises dans les enseignements de toutes les religions et dans les principes séculiers humanistes.
Une foi qui parachève le sens
Pour Küng, il appartient à chacun « d’inventer le sens de sa vie », de s’engager pour une cause caritative, social, politique, ecclésiale afin de se réaliser. Cependant, cet effort humain ne se parfait que lorsqu’il est parachevé par le « grand » sens qui transcende l’aujourd’hui en ouvrant l’homme à Dieu, « sens définitif et ultime ». Respectant toutes les expériences religieuses, mais écartant tout inclusivisme théologique, le théologien s’imagine les convictions et attitudes critiques qu’il aurait eues s’il était né musulman, hindou ou bouddhiste. Ce qui ne l’empêche pas d’expliquer le sens de sa foi chrétienne. Celle-ci n’implique nullement la vénération d’une autorité, d’une tradition ou d’une herméneutique quelconques, mais se fonde « exclusivement [sur] le Christ réel, historique ». Suivre le Nazaréen engage l’homme sur les chemins d’une « libératrice spiritualité de la non-violence, de la justice, de la charité et de la paix », et ouvre ses horizons à la vie éternelle. Et même si, au moment de la mort, le néant se présentait en maître, Küng réactualise pour nous le pari pascalien : « j’aurais, quoi qu’il arrive, dit Küng, mené une vie meilleure et plus remplie de sens que sans cet espoir ».
Antoine Fleyfel
06.01.2011
Imam à Drancy et président de la Conférence des imams de France, Hassen Chalghoumi veut réconcilier la France et l’islam.
Pour l’islam de France, Hassen Chalghoumi, éditions Le Cherche-Midi.
Hassen Chalghoumi est un imam controversé dans les milieux musulmans de France, jusqu’au sein de sa propre communauté à Drancy (Seine-Saint-Denis). Prôner le dialogue judéo-musulman, s’opposer au port de la burqa, dénoncer l’influence des Frères musulmans et plaider en faveur d’un « islam français républicain » ne font pas forcément l’unanimité.
Pour l’islam de France est un ouvrage qui mêle autobiographie et débat d’idées. Mieux travaillé et écourté, son message aurait sans doute gagné en clarté et le lecteur aurait pu s’épargner les nombreuses répétitions et les longs développements qui rappellent un certain style oral oriental. Toutefois, notre « imam républicain de France » avance certaines propositions qui méritent d’être examinées.
INTÉGRATION
Chalghoumi s’assigne la double tâche de « faire sortir de la mosquée tout ce qui nuit à l’islam et aux Français » et de « faire rentrer la mosquée dans le troisième millénaire et l’intégrer dans la conscience tranquille de notre France ». L’imam-type, « citoyen de la République » et autorité morale, y joue un rôle central et s’oppose aux « imams de la haine ».
Cette intégration passe par deux médiations principales : la condamnation d’un islam « obscurantiste » et le rapport nouveau avec la République. L’islamisme reçoit toutes les foudres de l’imam drancéen qui s’attaque en particulier à l’Iran, aux Talibans et à certaines « ambassades ». Localement, Chalghoumi accuse l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), issue de la mouvance des Frères musulmans, d’être source d’extrémisme, d’islamisme, d’affairisme, de propagande et de manipulation de la femme…
Opposé au port de la burqa, l’auteur s’appuie sur le Coran pour plaider en faveur de l’égalité des sexes et écarter la polygamie. Ainsi, un « islam de France » devrait naître, fruit d’un effort commun de l’islam et de la République : « Que l’État sécurise le culte musulman et que les musulmans sécularisent leur religion. »
OUVERTURES
Deux ouvertures majeures sont à relever : le dialogue interreligieux et la relecture de la foi. L’auteur, impliqué dans le dialogue judéo-musulman et surnommé par ses détracteurs « l’imam des juifs », condamne fermement l’antisémitisme et refuse d’amalgamer les occupants de la Palestine et les juifs de France.
Le dialogue entre les religions devrait s’effectuer localement, sans dépendre uniquement du passé ou des évènements du Moyen-Orient. Les propositions « dogmatiques » de Chalghoumi s’éloignent quant à elles un peu du discours sunnite traditionnel. En plus de plaider pour la liberté de conscience et de formuler un balbutiement de pluralisme théologique (« un Dieu, plusieurs Messagers »), l’imam évoque la contextualité de l’islam : « Universel, il est valable partout, mais dire qu’il ne doit s’adapter à aucun lieu ni à aucune culture est du pur délire ».
Cet ouvrage avance donc des idées intéressantes. Mais, encore une fois, l’argumentaire aurait mérité d’être resserré et moins manichéen. Il aurait aussi gagné à s’appuyer sur des références religieuses musulmanes contemporaines faisant autorité.
Antoine Fleyfel
25.11.2010
Sur fonds de problèmes financier, structurel et identitaire, auxquels viennent s’ajouter des tensions entre les Églises copte et grecque-orthodoxe, le Conseil œcuménique des Églises du Moyen-Orient (CEMO) traverse actuellement une crise majeure. Simple essoufflement institutionnel ?
Le 28 avril 2010, Guirgis Saleh (copte orthodoxe), secrétaire général du Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO), élu pour un deuxième mandat de 4 ans en 2007 comme représentant de la famille orthodoxe orientale, annonçait aux chefs des 27 Églises membres la décision de son Église de quitter le CEMO.
Le pape Chenouda III, chef de l’Église copte orthodoxe, avait pris cette décision en réaction aux « insultes » adressées à un évêque copte, Anba Bishoy, membre du conseil exécutif du CEMO et Secrétaire du Saint Synode de l’Église copte orthodoxe. En se retirant du CEMO, l’Église copte orthodoxe laisse un grand vide, puisque presque deux-tiers des chrétiens vivant au Moyen-Orient sont des fidèles de cette Église.
De quelles « insultes » parle-t-on ici ? Lors d’une réunion du conseil exécutif du CEMO, à Aman en Jordanie le 20 avril 2010, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, aurait jugé que Guirgis Saleh « paralysait l’effort œcuménique » et lui aurait demandé de démissionner. Expliquant que le Conseil était devenu un « club privé » copte, le patriarche aurait aussi accusé l’évêque Bishoy de manquer de « loyauté et de dévouement » à la cause du CEMO.
Les tensions entre les deux Églises, copte et grecque-orthodoxe, ne sont pas nouvelles. Guirgis Saleh rejette quant à lui ces accusations et considère les revendications de Théophile III comme illégales. Il explique par ailleurs que le patriarche grec de Jérusalem s’était absenté en 2009 d’une réunion très importante, et avait déjà envoyé une lettre demandant la démission du conseil financier et du secrétaire du CEMO. Ambiance…
Fondé en 1974, le CEMO est la seule instance œcuménique au monde dont l’Église catholique est membre (depuis 1990). Son règlement intérieur stipule : « Le Conseil est composé des quatre familles ecclésiales du Moyen-Orient : orthodoxe, orthodoxe orientale, évangélique et catholique, lesquelles croient en Jésus-Christ comme Dieu et sauveur selon les Écritures. […] Le Conseil tire ses pouvoirs des Églises chrétiennes membres réunies et ne se considère pas comme organe suprême les supplantant » (art. 3, 2).
HERETIQUE
Vingt-sept Églises (26 actuellement) constituent le CEMO (Voir document joint). L’Église assyrienne, dite des deux conciles, est la seule Église orientale qui ne fut jamais admise au Conseil à cause du refus des coptes. Ces derniers considèrent, depuis le Concile d’Éphèse en 431 et la – tristement – célèbre querelle entre Cyrille d’Alexandrie et Nestorius, que l’Église assyrienne demeure « hérétique ».
Un dialogue théologique a eu lieu au niveau du CEMO en 1990, ce qui était une avancée considérable, et les catholiques voulaient introduire les Assyriens dans leur famille puisqu’il était impossible administrativement de créer une cinquième famille. On était sur le point d’aboutir à une solution, mais au dernier moment, les positions se sont confessionnellement durcies.
Le CEMO a vu le jour dans un contexte très problématique. La guerre libanaise (1975) l’a par exemple obligé à déplacer ses bureaux de Beyrouth à Chypre pendant presque vingt ans, la guerre israélo-palestinienne, les régimes totalitaires, les tensions religieuses et confessionnelles, une région traditionnelle et pauvre, la guerre irako-iranienne, l’occupation du Kuwait, les deux guerres du Golf, les deux intifada n’ont pas non plus facilité les choses.
Ainsi, dès sa naissance, le CEMO a du relever beaucoup de défis. Et il y a souvent réussi. Au niveau du dialogue de charité, une grande et rapide avancée a eu lieu et le Conseil a joué un rôle très important pour établir des relations fraternelles : il a été un espace pour la rencontre des Églises, laquelle s’est traduite par des réussites dans les domaines spirituel et humain.
Le CEMO s’est engagé pour la cause palestinienne, pour la reconstruction du Liban, pour l’urbanisme des régions défavorisées, pour les droits de l’homme (et ceux de la femme !), pour les chrétiens en Irak, etc. Mais au niveau théologique, rien de très innovant n’a eu lieu excepté le dialogue mené entre l’Église assyrienne et l’Église copte orthodoxe en 1990 évoqué plus haut. À part cela, plusieurs formations et recherches théologiques comparées ont eu lieu, ainsi que des études pour parler de la Trinité aux musulmans et la rédaction de textes éthiques sur le dialogue avec l’islam, le respect et l’acception de l’autre.
Trois problèmes ont gravement nuit au CEMO ces dernières années : un problème financier, un problème structurel et un problème identitaire. Comme le Conseil Œcuménique des Églises (COE) et beaucoup d’organisations œcuméniques, le CEMO a subi les conséquences de la crise financière mondiale récente. Il n’a plus de ressources, parce que les « partenaires » qui le subventionnent ont décidé d’arrêter de le financer. Ceux-ci sont principalement des Églises et des organisations réformées originaires des pays germaniques et nordiques. Les Églises membres payent seulement des abonnements symboliques qui n’ont jamais dépassé les 2% du budget total (certaines n’ont même jamais payé). Les partenaires voulaient que les Églises assument au moins 10% des charges financières. Structurellement, un surplus d’employés a étouffé le Conseil (88 employés avant les restrictions récentes pour un peu plus d’un million de dollars de budget).
CRISE IDENTITAIRE
Quant à la crise identitaire, elle est encore plus grave que le problème financier qui ne paralyse qu’extérieurement, puisqu’elle ébranle la raison même de l’existence du conseil. Un haut responsable du CEMO témoigne :
« Le Conseil n’existe pas sans les Églises à qui il a beaucoup donné. Mais que lui ont-elles donné en retour ? Elles lui ont souvent donné des gens incompétents, elles lui ont infligé de dures conditions par des comportements plus communautaires qu’ecclésiaux, elles ne l’ont pas aidé financièrement lorsqu’il y a eu une crise, elles ont récupéré les partenaires pour leurs projets personnels. Si chacune des Églises opte pour un œcuménisme particulier, à quoi bon ? Est-ce que les Églises sont prêtes à se sacrifier quelque part au service de l’œcuménisme et de la collégialité ? ».
Certains préconisent de redéfinir l’identité du CEMO de manière à bannir tout recroquevillement confessionnel et de remettre la collégialité au centre des préoccupations. Il faudrait, dit-on encore, que les Églises prennent conscience de leur mission qui ne se résume pas par une survie du christianisme oriental, mais à un témoignage commun du Christ. C’est pour cela que le Conseil serait un besoin et que les Églises ne peuvent pas s’engager dans l’œcuménisme sans lui puisqu’il est justement le signe de leur collégialité et de leur unité espérée.
Le même responsable du CEMO ajoute que « le Conseil ne peut plus continuer comme il était, parce qu’il a perdu son efficacité, il a été dépassé. Il nous faudrait un Conseil qui rende la collégialité aux Églises, parce que lorsqu’elles sont ensemble, elles sont plus fortes et leur témoignage est plus puissant. Il faudrait que les Églises l’appuient moralement et financièrement. Elles doivent choisir la collégialité et non le renfermement. Il est exigé des chefs des Églises un grand éveil et du courage. Il faut que les partenaires regagnent confiance ». La responsabilité des Églises catholiques est très grande à tous ces égards l’année prochaine, parce que ce sera à leur tour d’offrir au Conseil un nouveau secrétaire.
Pas de doute, donc : l’œcuménisme au Moyen-Orient traverse une épreuve décisive. Les Églises orientales sauront-elles la traverser ensemble, sans attendre d’hypothétiques avancées au niveau mondial ? Oseront-elle prendre l’initiative, pour un jour abandonner leurs vieilles querelles et devenir enfin cette Église des Arabes tant attendue, témoin de l’amour du Nazaréen sur une terre qui ne cesse de souffrir ?
Antoine Fleyfel
18.10.2010
Tous les christianismes moyen-orientaux antiques et un certain nombre d’Églises occidentales sont représentés au Liban. Cela fait du Pays des Cèdres une terre qui possède l’une des plus grandes densités œcuméniques au monde.
Les querelles dogmatiques – notamment christologiques – plus que millénaires, sources des plus grandes divisions entre les chrétiens durant des siècles, sont aujourd’hui dépassées. Pour autant, les relations entre les différentes Églises demeurent complexes. Trois ecclésiastiques locaux, Mansour Labaky (1), Paul Rouhana (2) et Gabriel Hachem (3) nous ont aidés à y voir plus clair.
PÂQUES
Sur le plan pastoral et humain, la diversité chrétienne au Liban est vécue positivement. Le brassage entre communautés est très fort, notamment grâce aux écoles et aux mariages mixtes. Depuis la guerre du Liban, on parle d’un « camp chrétien », solidaire face à plusieurs défis communs sur les plans social, politique et culturel.
« Il est de la plus grande importance, explique Paul Rouhana, de développer l’œcuménisme pastoral. Toutes nos Églises sont apostoliques, elles ont beaucoup de choses en commun : le sacerdoce, la Bible, la liturgie… On vit ensemble sur cette terre. »
Mansour Labaky assure dans le même esprit « qu’au quotidien, il n’y a aucune différence entre les chrétiens ». La logique des systèmes ecclésiastiques, en revanche, réaffirme régulièrement les distinctions. Pour peu que le dialogue théologique et le droit canonique stagnent, les croyants, qui ignorent les raisons des divisions ecclésiales et les « boucheries théologiques », selon l’expression de Mansour Labaky, peuvent donc se retrouver en porte-à-faux.
Le besoin d’une pastorale œcuménique concrète du mariage et de la catéchèse se fait particulièrement sentir. Paul Rouhana évoque aussi un problème emblématique qui scandalise beaucoup de chrétiens locaux : la date de la fête de Pâques, différente selon les calendriers retenus par les Églises :
« À la suite de Vatican II, les catholiques orientaux ont théoriquement le droit de décider de fêter Pâques en même temps que les autres chrétiens. Malheureusement, depuis 45 ans, rien n’a été fait en ce sens. Le blocage est patent. Il n’y aurait pourtant pas de mal à ce que les catholiques fêtent Pâques en même temps que les orthodoxes. Le christianisme libanais aurait besoin de quelques initiatives de ce genre. »
Gabriel Hachem souligne lui aussi l’importance de l’œcuménisme pastoral et rappelle qu’un « niveau très intéressant concernant les protocoles pastoraux a été atteint. Le dernier a été signé en 1996 ( les accords de Charfeh (4) ) et portait sur les mariages mixtes, sur le catéchisme œcuménique commun et sur l’identité confessionnelle des enfants. » Depuis… rien.
Sur le plan théologique, les Églises du Liban « sont d’abord des petites entités qui dépendent d’autres Églises mondiales », précise Paul Rouhana. Elles ne peuvent que répercuter des décisions qui sont prises à un niveau supérieur. Leur principale contribution au dialogue œcuménique se manifeste par la présence de théologiens libanais au sein de certaines commissions théologiques internationales.
Gabriel Hachem évoque certaines initiatives locales, comme les échanges de professeurs, de bases de données de bibliothèques et de revues entre les facultés de théologie. Les Églises orientales catholiques sont quant à elles pour l’essentiel soumises aux décisions romaines.
Le Conseil des Églises au Moyen-Orient (CEMO), la seule instance œcuménique au monde dont l’Église catholique est pleinement membre, souffre par ailleurs de problèmes financiers, structurels et spirituels, ce qui ne facilite pas les choses. Gabriel Hachem rappelle que lorsque ce Conseil a été fondé en 1974, « l’espoir était qu’on puisse s’engager à un niveau local dans un dialogue théologique œcuménique qui contribuerait au progrès du dialogue international ».
Un espoir déçu, apparemment. Car si le mouvement œcuménique semble avancer rapidement au niveau des rencontres et de ce qu’on appelle le « dialogue de charité », les freins s’enclenchent très vite lorsqu’on aborde les questions doctrinales : « C’est à ce moment-là qu’on a tendance à se replier sur son identité confessionnelle, et c’est là qu’on a l’impression qu’il y a une stagnation œcuménique. »
Entre rencontre concrète allant de soi et rapports théologiques limités, les Églises du Liban vivent donc une situation paradoxale. Le temps des concessions au service du « ministère de l’unité » ne serait-il pas venu ? Gabriel Hachem s’avoue sceptique : « Les chefs des Églises ne sont pas prêts à ce genre de démarche qui exige beaucoup de courage. »
MARONITES
L’Église maronite (catholique) est le partenaire principal de toutes les Églises au Liban, non seulement parce que le plus grand nombre de chrétiens libanais sont maronites, mais aussi en raison du grand rôle politique qu’elle continue de jouer. Si elle ne fournit pas actuellement de contribution significative dans le cadre du dialogue théologique œcuménique, elle essaie tout de même de repenser sa situation à la lumière des défis qu’affrontent ensemble tous les chrétiens libanais.
Ces défis se résument surtout à des mutations religieuses souvent inquiétantes et à des problèmes d’émigration chrétienne accélérée, d’économie et d’instabilité politique. Deux grands événements incarnent la réflexion qu’a entamée l’Église maronite ces deux dernières décennies : le Synode pour le Liban qui a été réuni à son initiative et qui s’est clôturé par l’Exhortation apostolique pour le Liban de Jean-Paul II en 1997, et le Synode patriarcal maronite (5) en 2006.
« L’Exhortation apostolique pour le Liban, analyse Paul Rouhana, incarne une prise de conscience après la guerre. Il fallait tendre la main aux musulmans. Le Synode s’inscrit dans cette ligne. »
Ces deux événements rendent les « chrétiens du Liban beaucoup plus fort lorsqu’ils parlent. On sent qu’il y a un discours qui commence à s’entendre chez eux, un discours de rationalité, un discours de réalisme, un discours d’acceptation de l’autre, de dialogue et de convivialité ». Gabriel Hachem salue lui aussi l’entreprise synodale mais s’interroge sur sa réception concrète, aussi bien par le clergé que par la population en général.
PROPHÈTES
Les Églises du Liban sauront-elles s’impliquer d’avantage dans une entreprise œcuménique et interreligieuse audacieuse qui inaugurerait une nouvelle ère de présence et de témoignage ? C’est l’une des grandes questions du moment. Les chrétiens orientaux et les assemblées qui se réunissent ces temps-ci savent qu’il leur faudra y répondre. Reste un autre problème, bien réel, que souligne Paul Rouhana : « Il n’y a plus de figures charismatiques susceptibles de porter efficacement ces idées. » Et Mansour Labaky de confirmer : « Nous n’avons plus de prophètes maronites.»
———————————————————
1. Chorévèque maronite, auteur de plus de 200 hymnes chantées par tous les chrétiens orientaux à travers le monde et fondateur de plusieurs associations religieuses, dont Lo Tedhal.
2. Moine maronite, spécialiste en œcuménisme et doyen de la Faculté Pontificale de Théologie à l’Université Saint-Esprit de Kaslik.
3. Prêtre grec-catholique, spécialiste en œcuménisme et responsable au Conseil des Églises du Moyen-Orient.
4. « Accord catholique-orthodoxe sur trois questions pastorales importantes (Charfeh, 1996) », Les lieux de communion, Jean Corbon, éd. Cerf, 2009, p. 637-648.
5. Site web du Synode : http://www.maronitesynod.com
Antoine Fleyfel
14.10.2010
Nombre de partisans du sacerdoce marié se sont réjoui de la « brèche » qui aurait été ouverte par Anglicanorum Cœtibus, la constitution apostolique de Benoît XVI publiée le 9 novembre 2009. Elle annonçait la mise en place d’une structure destinée à accueillir au sein de l’Église catholique des fidèles et institutions de tradition anglicane. Le théologien suisse Hans Küng, qui s’est exprimé dans plusieurs journaux européens, considère les nouveaux ordinariats créés par la Congrégation pour la doctrine de la foi comme une « mini-Église anglicane unie », dotée d’un clergé marié qui sera considéré comme étant « de seconde zone » (Le Monde, 28.10.2009). Un jugement sévère, qui mérite analyse. Un éclairage sur cette question peut être donné à partir de la situation des Églises catholiques orientales, presque toutes « unies », c’est-à-dire conservant leur rites propres tout en faisant partie de l’Église catholique, et dotées pour la plupart d’un clergé marié souvent objet de discriminations.
Une nouvelle forme d’uniatisme ? La déclaration de Balamand, adoptée en 1993 par la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe, considère l’uniatisme comme une « méthode du passé » qui « ne saurait être un modèle de l’unité ». On pourrait pourtant se demander en lisant Anglicanorum Cœtibus si l’Église romaine n’élaborerait pas un nouveau genre d’uniatisme. Un argument de taille s’oppose d’emblée à cette interprétation : ce n’est pas l’Église romaine qui a provoqué le départ de certaines communautés anglicanes. C’est surtout la Traditional Anglican Communion qui a demandé à rejoindre l’Église catholique. En cela, le Saint Siège ne peut être accusé de prosélytisme ou d’incitation à l’uniatisme.
Et pourtant. Les communautés anglicanes reçues posséderont « une personnalité juridique publique de plein droit (ipso jure) » (AC, I, 3) qui n’est pas sans rappeler le statut canonique « sui iuris » des Églises orientales catholiques presque toutes uniates. Bien sûr, le statut « ipso jure » suppose, au plan juridique, l’assimilation des ordinariats anglicans à un diocèse, ce qui n’est pas le cas pour les Églises « sui iuris », patriarcales pour la plupart. Mais l’autonomie, au moins rituelle, reste de mise et le Saint-Père demeure la référence ultime dans les deux cas.
Anglicanorum Cœtibus maintient aussi le centralisme romain par le biais de liens hiérarchiques étroits et ne relève en rien de l’esprit de collégialité épiscopale prôné par les Églises orthodoxes et anglicanes en référence à l’ecclésiologie du premier millénaire. La constitution dogmatique Lumen Gentium promulguée lors du Concile Vatican II est bien citée dans le texte d’Anglicanorum Coetibus, mais pour rappeler que l’uni?que Église du Christ subsiste dans l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre… Pour que les autres Églises soient pleinement Églises, il faudrait donc qu’elles se soumettent au pape dans le cadre d’une ecclésiologie qui dépend plutôt du second millénaire. Singulière conception de l’œcuménisme.
Des prêtres de seconde zone ? Anglicanorum Cœtibus n’innove par ailleurs en aucune matière en ce qui concerne le sacerdoce catholique marié. Les exceptions qu’elle permet sont pratiquées depuis plusieurs siècles par les Églises orientales catholiques, dans le cadre de leurs territoires patriarcaux. Au contraire, la Constitution effectue une double régression : l’une par rapport à la discipline de nombre d’Églises orientales catholiques où le statut du prêtre marié est canoniquement « normal », et l’autre par rapport à la discipline anglicane qui autorise le mariage d’un prêtre célibataire.
Les Églises orientales catholiques ont eu des rapports divers avec le sacerdoce marié. Certaines, dans une perspective de romanisation poussée, ont éradiqué, ou presque, cette discipline, telles les Églises syro-malabare, arménienne catholique et syriaque catholique. D’autres comptent toujours un nombre considérable de prêtres mariés, comme les Églises maronite, grecque melkite et ukrainienne catholique, ce qui n’exclut pas les tendances de beaucoup d’évêques latinisants en leur sein qui veulent favoriser le modèle latin de célibat sacerdotal. Il existe souvent, surtout en Orient, de fortes discriminations à l’endroit du clergé marié : on lui confie rarement des postes clefs dans le cadre des diocèses, et on le conçoit plutôt comme villageois. Et même si l’admission d’hommes mariés au sacerdoce ne relève pas d’une dispense canonique, des évêques compliquent leur réception, et certains séminaires ont été créés spécialement à leur attention, dans le but surtout de les séparer des séminaristes célibataires, lesquels reçoivent une formation réputée supérieure. Cette discrimination atteint son apogée lorsque ces prêtres mariés émigrent dans les pays occidentaux où, en principe, ils n’ont pas le droit de célébrer les sacrements, même auprès de leurs propres communautés ecclésiales. Quelques très rares exceptions sont faites à cette règle pour des raisons dites « humaines » et au cas par cas : un très petit nombre de prêtres mariés a donc reçu l’autorisation de célébrer les sacrements, auprès de sa communauté orientale « délocalisée », et bien sûr le plus discrètement possible.
Si, selon les droits particuliers de certaines Églises sui iuris, le presbytre peut être célibataire ou marié, la création d’ordinariats (équivalent du diocèse) pour les anglicans n’affecte en rien le droit canonique latin. La voie régulière qui s’applique aux anglicans unis reste celle du célibat : « l’ordinaire [NDLR : l’évêque] n’admettra en règle générale (pro regula) que les hommes célibataires à l’ordre des prêtres » (AC, VI, 2). Ceux-ci ne pourront pas se marier après leur ordination (règle en vigueur en Orient) comme la tradition anglicane les y autorise pourtant : « Les ministres célibataires se soumettront à la règle du célibat clérical » (AC, VI, 2). L’ordination d’hommes mariés serait ainsi une exception à la règle, possible seulement moyennant une autorisation spéciale du Saint Père, toujours au cas par cas, et « en fonction de critères objectifs approuvés par le Saint-Siège ». Les normes complémentaires de la Constitution ajoutent que ces ordinations répondent aux « nécessités de l’ordinariat ». Quelles se?raient ces nécessités ? S’il y a suffisamment de prêtres au service, l’ordination d’hommes mariés serait-elle toujours une option ?
Exception ? C’est dans ce cadre que l’on peut souligner, encore une fois, les aspects assimilateurs de la Constitution. Puisqu’il est difficile de passer outre la tradition du sacerdoce anglican marié, celui-ci n’est que toléré d’une manière exceptionnelle. Jusqu’au jour où il y aura peut-être suffisamment de prêtres célibataires ? Même chose pour les ordinaires (qui correspondent aux évêques) qui peuvent être prêtres mariés, comme ce sera le cas des ex-évêques anglicans mariés. L’exception vaudra-t-elle encore lorsqu’il y aura suffisamment d’ordinaires célibataires ? Par ailleurs, les notes complémentaires (nc) de la Constitution se chargent de confiner les exceptions à la règle du célibat dans le stricte cadre de l’ordinariat. Elles stipulent que « l’ordinaire ne peut accepter comme séminaristes que les fidèles qui font partie d’une paroisse personnelle de l’ordinariat ou ceux qui sont issus de la communion anglicane et ont rétabli la pleine communion avec l’Église catholique » (AC, nc, X, 4). On peut d’ailleurs se demander si ces prêtres mariés auront le droit de célébrer dans des paroisses latines, ou de concélébrer avec des prêtres latins. La constitution reste ambiguë sur ces questions, mais l’expérience des orientaux n’est pas encourageante.
In fine, même si Anglicanorum Cœtibus donne l’impression d’ouvrir une brèche sur la question du sacerdoce catholique marié, la réalité des choses, appréhendée à la lumière de l’expérience et de l’histoire des Églises orientales catholiques, suggère bel et bien le contraire. L’Église catholique a beau admettre de façon exceptionnelle l’existence d’un sacerdoce marié en son sein, celui-ci reste fortement discriminé et mis à l’écart. Considérer l’ordination sacerdotale d’hommes mariés, ex-prêtres anglicans, comme relevant de dispenses à la règle du célibat sacerdotal montre que, loin de vouloir abroger la règle disciplinaire du célibat sacerdotal, l’Église latine durcit encore sa position sur la question.
Antoine Fleyfel
28.01.2010
Cet article a paru dans le numéro Hors-série d’octobre 2009 de l’hebdomadaire Témoignage chrétien.
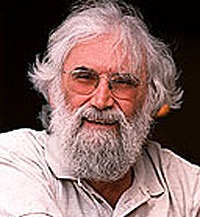
François d’Assise est souvent présenté comme un guide particulièrement efficace pour le chrétien en quête de spirituel et d’action caritative. Tout en honorant cet aspect du personnage, Léonardo Boff effectue une lecture plus élargie qui embrasse le message de François dans toute son étendue. Et en particulier vers d’autres dimensions humaines, elles aussi fondamentales : le politique et le social.
L’ouvrage de Boff, François d’Assise, force et tendresse (1), montre que la fameuse « option préférentielle pour les pauvres », qui a suscité tant de débat dans l’Eglise catholique, puise certains de ses éléments constitutifs chez le Poverello. Ce dernier a grandement inspiré la lecture théologique contextuelle effectuée par le théologien brésilien : François offre à Boff une compréhension de l’évangile, du contexte vécu et de toute réalité à partir des pauvres.
Pour Boff, la pauvreté est un problème « fondamentalement politique » ; combattre cette blessure suprême qui déshumanise et aliène l’être humain, ne se fait pas moyennant des condamnations et des paroles. Combattre la pauvreté s’effectue à partir d’une praxislibératrice, d’une lutte pour, à partir et avec les pauvres. L’actualité politique de l’option de François se situe donc dans le regard posé sur les pauvres à partir des pauvres, et non à partir du riche ou du puissant.
Paternalisme
Boff situe le message de François dans le cadre des attitudes historiques de l’Église à l’égard de la pauvreté. Tout en restant fidèle à la tradition de Jésus et en maintenant au cours des siècles « un souci très aigu des pauvres », l’Église a eu trois attitudes de base, correspondant en gros à trois époques.
Première époque : jusqu’à Constantin, elle était une Église des pauvres, principalement constituée de pauvres. Deuxième époque : De Constantin à Vatican II, les circonstances mènent l’Église à jouer un rôle politique, d’où une différenciation qui s’instaure entre les simples fidèles, la base, et les dirigeants. La hiérarchie ecclésiastique s’allie au pouvoir politique et noue une alliance qui donne naissance à ce qu’on appelle la chrétienté. « Dans cette structure nouvelle, les pauvres […] se trouvent dans une situation inférieure et marginale. Ce qui ne veut pas dire qu’on les oublie. […] Malgré de notables exceptions, on regardera le pauvre selon la perspective du riche : il apparaîtra comme un inférieur, un indigent, comme l’objet d’une action caritative… C’est la forme qui définira cette action de l’Église pratiquement jusqu’à Vatican II ». Cette attitude « d’assistantialisme » suit une logique paternaliste. Le pauvre est « un fils mineur et sans défense ». En régime de chrétienté, les évêques assistent les pauvres et plaident leur cause auprès des riches, lesquels ont le devoir de partager leur surplus. Mais le problème de la pauvreté change à l’époque moderne ; l’Église est dépassée par la nouvelle donne sociale et ses encycliques, « incapables de franchir la rampe des appels », restent « bien en deçà de la contribution marxiste dans l’élaboration et l’organisation des luttes libertaires du prolétariat ». L’Église de cette époque était une « Église pour les pauvres », et pas une « Église avec les pauvres, et moins encore une Église des pauvres ».
Conversion
Troisième époque : aux alentours du concile Vatican II, l’Église est amenée à vivre parmi les pauvres, surtout dans le « continent des pauvres » : « au lieu de voir le pauvre dans la perspective du riche, elle commence à voir le pauvre avec les yeux du pauvre ». C’est aux conférences des épiscopats d’Amérique du Sud de Medellín (1968) et de Puebla (1979) que « l’Église latino-américaine a fait une claire option préférentielle et solidaire en faveur des pauvres », une option-conversion qui lui permet de dépasser « une vision purement moraliste et assistantialiste pour assumer une perspective politique ».
Retour au saint d’Assise : au début du XIII° siècle, les mouvements aspirant à un retour à une pauvreté plus ou moins fantasmée foisonnent (Patarins, Vaudois, Albigeois…). Ce phénomène est, selon Boff, « peut-être le plus radical de toute l’histoire spirituelle du christianisme ». Il s’y effectue un passage de la « libéralité envers les pauvres » à la « vie avec les pauvres », et là est la source de « l’option préférentielle pour les pauvres ». François se distingue par le fait qu’il ne cherche pas à reproduire la vie des premiers chrétiens mais plutôt à suivre et imiter le Christ. Il ne s’oppose pas à l’Église hiérarchique. La vie du saint ressemble selon Boff aux étapes de l’histoire de l’Église : au début, François vivait pour les pauvres, sans changer de lieu social. Ensuite, en se rendant dans leur milieu et en les assistant, il vivait avec les pauvres. Une troisième conversion le mène à vivre « commeles pauvres, pourvoyant à leurs nécessités, d’abord par l’aumône, puis au moyen de son travail ». Il passe d’une classe sociale à une autre. Il quitte le monde des grands dans lequel il vit et celui de la hiérarchie ecclésiastique, pour devenir « un frère de tous, sans aucun titre hiérarchique ». C’est à partir des pauvres qu’il réorganise « toute sa façon de comprendre sa vie personnelle, Dieu, le Christ, le sens de la fraternité ».
Délivrance
François vit deux genres de pauvretés : la disponibilité totale vis-à-vis de Dieu et l’identification aux pauvres contre la pauvreté. Son option est une antithèse dialectique à la bourgeoisie de son temps, incarnation d’une mentalité capitaliste, source d’injustices et d’appauvrissement. Le renoncement du saint aux richesses du monde est une « expropriation » qui délivre de « l’appropriation » capitaliste. Là où le capitalisme procure la sécurité, porte préjudice au prochain, blesse, exploite, rabaisse la valeur humaine… l’esprit franciscain procure la liberté par rapport à autrui, la délivrance du désir d’avoir raison et de dominer : « Être exproprié, c’est être petit, servir le royaume de Dieu, se convertir. C’est la meilleure façon de marcher à la suite du Christ ». Cette antithèse au capitalisme trouve en son centre une valorisation radicale de « l’union fraternelle avec les plus petits et les derniers, et surtout avec le Serviteur souffrant, Jésus-Christ ». La pauvreté devient le chemin à suivre pour atteindre une fraternité humaine entière. Cette exigence est radicale au point que « pour aider les pauvres, il vaudrait même la peine de dépouiller de ses bijoux et de son or la statue de la Vierge ». Les pauvres sont désormais le point central, et cela est une «incommensurable libération », une invitation adressée au monde actuel pour vivre d’une manière nouvelle la solidarité et l’engagement. Boff sait bien que l’exemple de François ne peut être suivi par une société entière, mais seulement par des individus ou des petites communautés. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une manière nouvelle d’affronter la situation de la pauvreté, un leitmotiv, une puissance spirituelle qui se concrétise dans un vécu social et politique, puisque « le pauvre est considéré comme une manifestation de la divinité ».
François est donc une figure majeure de libération, parce qu’il renverse les concepts et pousse à une véritable praxis politico-sociale. Cette vision pousse à ne pas lire la situation des pauvres du point de vue des riches. Boff se réjouissait au début des années 1980 de ce que l’Église post-conciliaire, qui avait osé adopter en Amérique latine les réflexions de la théologie de la libération, soit délivrée des contraintes que la chrétienté avait imposées. Son renoncement à sa charge sacerdotale en 1992 et tous les démêlés qu’il a pu avoir avec la hiérarchie lui auront-ils fait changer d’avis sur ce sujet ?
Que devient Leonardo Boff ?
Son site Internet leonardoboff.com consultable en anglais, espagnol et portugais, contient beaucoup d’informations sur ses activités. Il y affirme avoir changé de tranchée, mais pas de combat. Boff se considère toujours comme un théologien de la libération ; il écrit, enseigne et donne des conférences dans ce sens.
Boff concrétise depuis des années des réflexions écologiques qu’il avait déjà formulées dans son livre sur François d’Assise. Résidant dans une région sauvage dite « écologique » à Petrópolis, le théologien et sa femme militent pour les droits de l’homme dans le cadre d’un nouveau paradigme écologique.
Antoine Fleyfel
01.10.2009
(1) Leonardo BOFF, François d’Assise, force et tendresse. Une lecture à partir des pauvres, Cerf, Paris, 1986, 217 p. Toutes les citations sont tirées de cet ouvrage.
|
|